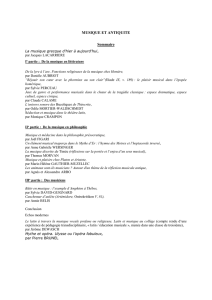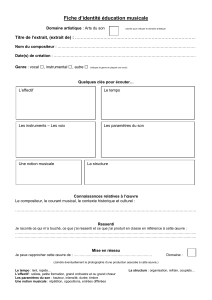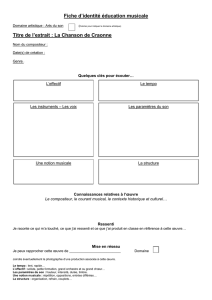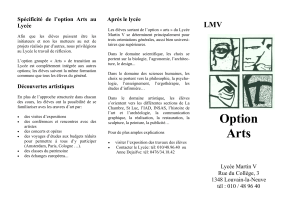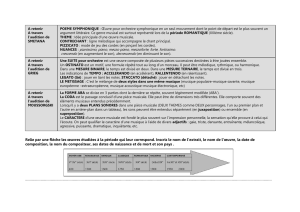Musique et procès de sens

théories
et pratiques
sémiotiques
volume 25 numéro 2
automne 1997

2
PROTÉE paraît trois fois l'an. Sa publication est parrainée par le Département des arts et lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce départe-
ment regroupe des professeurs et chercheurs en littérature, en arts visuels, en linguistique, en théâtre, en cinéma, en langues modernes, en philosophie,
en enseignement du français et en communication. PROTÉE est subventionnée par le Fonds pour la Formation de Chercheurs et l’Aide à la Recher-
che, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la Fondation de l’UQAC, le Programme d’aide institutionnelle à la recherche (Fonds
institutionnel de recherches), l’Institut de recherches technolittéraires et hypertextuelles et le Département des arts et lettres de l’UQAC.
Le comité d’évaluation du Fonds pour la Formation de Chercheurs et l’Aide à la Recherche (FCAR) du ministère de l’Éducation du Québec a attribué
à PROTÉE la note A+ pour son excellence et sa diffusion internationale. Le Fonds FCAR a aussi accordé à
Protée
une subvention accrue pour les
trois prochaines années. L’équipe scientifique, administrative et artistique de
Protée
remercie les instances et le personnel du Fonds FCAR, sans lequel
rien ne serait possible.
Mode de PAIEMENT: Chèque (tiré sur une banque canadienne)
ou mandat-poste libellés en dollars canadiens.
ABONNEMENT (3 numéros/année)
TPS et TVQ non incluses pour la vente au Canada.
INDIVIDUEL (version imprimée)
Canada : 29$ (15$ pour les étudiants)
États-Unis : 34$
Autres pays : 39$
INSTITUTIONNEL
Canada : 34$
États-Unis : 44$
Autres pays : 49$
CHAQUE NUMÉRO (version imprimée)
Canada : 11,25$ (6$ pour les étudiants*)
États-Unis : 13,25$
Autres pays : 14,25$
* le tarif étudiant n'est pas appliqué en kiosque
INDIVIDUEL (version électronique)
Canada : 12$ (7$ pour les étudiants)
États-Unis : 15$
Autres pays : 15$
INSTITUTIONNEL
Canada : 15$
États-Unis : 17$
Autres pays : 19$
CHAQUE NUMÉRO (version électronique)
Canada : 7$ (4$ pour les étudiants)
États-Unis : 8$
Autres pays : 9$
Comité de rédaction :
Jacques-B. BOUCHARD, Université du Québec à Chicoutimi
Mireille CALLE-GRUBER, Queen’s University
André GERVAIS, Université du Québec à Rimouski
Bertrand GERVAIS, Université du Québec à Montréal
Johanne LAMOUREUX, Université de Montréal
Richard SAINT-GELAIS, Université Laval
Jean-Pierre VIDAL, Université du Québec à Chicoutimi
Rodrigue VILLENEUVE, Université du Québec à Chicoutimi
Comité Conseil international :
François JOST, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)
Eric LANDOWSKI, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Comité de lecture* :
Denis BELLEMARE, Université du Québec à Chicoutimi
Paul BLETON, Téluq
Marcel BOUDREAU, Université Laval
Enrico CARONTINI, Université du Québec à Montréal
Gilbert DAVID, Université de Montréal
Gabrielle FRÉMONT, Université Laval
Louisette GAUTHIER-MITCHELL, Université du Québec à Montréal
Jean-Guy HUDON, Université du Québec à Chicoutimi
Suzanne LEMERISE, Université du Québec à Montréal
Pierre MARTEL, Université de Sherbrooke
* La revue fait aussi appel à des lecteurs spécialistes selon les contenus
des dossiers thématiques et des articles reçus.
Administration: PROTÉE, 555, boul. de l'Université, Chicoutimi (Québec), Canada G7H 2B1, téléphone: (418) 545-5011, poste 5396, télécopieur: (418) 545-5012.
Adresse électronique : [email protected]. Distribution : Diffusion Parallèle, 1650, boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, Québec, J7E 4H4, (514) 434-2824. PROTÉE
est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP). Les textes et illustrations publiés dans cette revue engagent la responsabilité de leurs
seuls auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l’accord de l’auteur pour leur libre publication.
PROTÉE est indexée dans Argus, Klapp, Ulrich’s International Periodicals Directory, OXPLUS et dans le Répertoire de la vie française en Amérique. PROTÉE bénéficie également
d'un site électronique – l’
Espace Protée
(http://www.uqac.uquebec.ca/dal/protee.htm) – à l’intérieur du
Site électronique international de sémiotique
(http://www.uqac.uquebec.ca/
dal/semiotique.htm). L’impression de PROTÉE a été confiée à l’Imprimerie LT Ltée de Chicoutimi.
Directeur: Jacques-B. Bouchard. Adjointe à la rédaction: Michelle Côté. Secrétaire à l’administration : Maude Dumont-Gauthier. Assistant à la diffusion:
Jean-Pierre Vidal. Assistant à l’administration: Rodrigue Villeneuve. Assistant à la rédaction: Fernand Roy.
Responsables du présent numéro: Ghyslaine Guertin et Jean Fisette.
Page couverture: Portrait d’Erik de Jean-Pierre Séguin, 1997 (huile sur toile, dimensions variables, objets et tablette de métal).
Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada.
ISSN-0300-3523

3
théories et pratiques sémiotiques
volume 25, numéro 2 automne 1997
Musique et procès de sens
Hors dossier
SUR LES TRACES DE L’OUBLI.
La mémoire au cinéma et le travail du spectateur /
Diane Turcotte
99
LA GÉNÉRATION DE LA RUPTURE:
le récit d’émancipation féminin des années 70 en France /
Françoise Parouty-David
106
R
ÉSUMÉS
/ A
BSTRACTS
116
N
OTICES
BIOGRAPHIQUES
118
Présentation /
Ghyslaine Guertin et Jean Fisette
4
DE LA SÉMIOLOGIE GÉNÉRALE À LA SÉMIOLOGIE MUSICALE.
L’exemple de
La Cathédrale engloutie
de Debussy /
Jean-Jacques Nattiez
7
LIEUX ET ATTRIBUTS DE LA MUSIQUE AU TEMPS DES ENCYCLOPÉDISTES /
Claude Dauphin
21
DU PLAISIR DE LA MUSIQUE: sens et non-sens.
Michel-Paul Guy de Chabanon (1730-1792) /
Ghyslaine Guertin
37
JEAN-PIERRE SÉGUIN
présenté par
Jean-Pierre Vidal:
La déférence ironique
44
MAURICE RAVEL: DU TEXTE AU PARATEXTE /
Danièle Pistone
55
UNE GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE.
Au-delà des frontières du système tonal /
Stéphane Roy
61
REGARDS CROISÉS DE L’ESTHÉTIQUE ET DE L’ETHNOMUSICOLOGIE /
Monique Desroches et Ghyslaine Guertin
77
FAIRE PARLER LA MUSIQUE... À propos de
Tous les matins du monde
/
Jean Fisette
85
Portrait d’Erik est une œuvre
originale de Jean-Pierre Séguin
produite spécialement pour illustrer
la page couverture de ce numéro.
Ce dossier a été préparé sous la responsabilité
de Ghyslaine Guertin et Jean Fisette

4
La musique signifie-t-elle? Et si oui, de quelle façon?
Cette question hante la réflexion sur l’esthétique depuis la plus haute Antiquité, touchant
toutes les formes artistiques, allant des arts plastiques à la production littéraire, en incluant
évidemment la musique. La signification dont il est question ici pose une question trop abrupte
pour qu’une réponse puisse être apportée directement; la réflexion qui est ainsi amorcée passe par
la médiation d’une notion voisine, celle de mimésis, cette articulation qu’Aristote plaça naguère au
centre de sa Poétique et que la tradition occidentale a incessamment replacée au cœur de toutes ses
poétiques, sous sa formulation latine d’imitatio. Et si cette question de la mimésis semble s’inscrire
avec grâce au cœur des arts visuels ou encore dans la portée du regard de la poésie et du récit, la
musique semble, par contre, opposer une forte résistance à ce postulat d’une capacité imitative qui
représenterait un incontournable, une nécessité théorique, tel un noyau dur. On comprend que
la réflexion fondant la modernité dans les arts ait opposé à cette notion de mimésis cette autre
notion qui lui est, sinon contradictoire, du moins divergente, celle de sémiosis.
La question posée au début devient plus complexe, appelant à des nuances infinies; on
pourrait vraisemblablement la reformuler ainsi: si la musique, à la différence des arts visuels ou
littéraires par exemple, n’a pas un accès immédiat à quelque forme de représentation, de quelle
façon arrive-t-elle à signifier? Puis, si la musique signifie quelque chose, c’est-à-dire si elle se
donne un référent à propos duquel elle énonce des propositions, cet objet peut-il être autre chose
qu’elle-même? Les premiers théoriciens de la musicologie ont répondu par une position de
principe affirmant péremptoirement l’autotélisme du langage musical, inaugurant ainsi la
position d’une modernité formelle qui devait, par la suite, émigrer dans les autres formes de
l’activité artistique. Qu’en est-il aujourd’hui ? En ces temps où l’on déborde la modernité, cette
question devait être posée à nouveau.
En faisant appel aux collaborateurs de ce numéro de Protée, nous leur soumettions cette
question en assortissant la présentation de quelques voies de réponse, voire de quelques
suggestions. De façon plus précise, nous proposions que la signification se définit assez
simplement dans les relations que la musique entretient avec d’autres formes symboliques,
chacune des représentations devenant l’interprétant des autres. La totalité virtuelle de ce réseau
de représentations-interprétants constitue un ensemble sémiosique insaisissable exhaustivement
et donc ouvert sur des possibles encore insoupçconnés; c’est précisément pour cette raison que
ce réseau est porteur de significations. Notre titre «Musique et procès de sens» désigne ce
caractère ouvert, dynamique et, à la limite, polémique de la question de la signification de la
musique.
Ce que nous proposons au lecteur, ce sont des contributions qui nécessairement adoptent
différents points de vue. Une lecture minutieuse de ces textes révèle cependant qu’au-delà de la
Musique et procès de sens

5
grande diversité entre les postulats ou les hypothèses qu’ils avancent, les objets qu’ils analysent et
les problématiques qu’ils construisent, les questions fondamentales qu’ils abordent demeurent les
mêmes.
Par exemple, le débat sur la capacité représentative de la musique pourrait constituer un fil
pour la lecture de ce numéro: si ce fut là le cœur de discussions animées dans la France des
Lumières, cette même question se retrouve autant dans le traitement que Pascal Quignard suggère
d’apporter aux pièces pour viole de Monsieur de Sainte-Colombe au XVIIe siècle que dans la
problématique de la construction de la musique atonale du XXe siècle.
Cette question apparaît également fondamentale dans les réflexions plus théoriques
qu’effectuent certains textes du numéro sur le thème de la sémiologie musicale ainsi que sur celui
de la rencontre inopinée de l’esthétique et de l’ethnomusicologie. D’une façon moins abstraite,
les rencontres du texte et de la musique chez Ravel viennent relancer, sous un autre aspect, ce
même débat.
Le texte de Jean-Jacques Nattiez quant à lui pose la question d’une façon directe: la musique
est-elle une sémiotique? Et la réponse qu’il donne est on ne peut plus claire: il propose une
explication détaillée du modèle ternaire célèbre, fondé par Jean Molino, où s’enchaînent les
positions stratégiques des analyses poïétique et esthésique, puis celle du niveau neutre. L’un des
caractères intéressants de cette modélisation c’est que malgré l’apparente proximité avec le
modèle de la communication, ce sont en réalité les modalités d’existence des objets appartenant à
l’ordre symbolique qui y sont interrogées. Cette modélisation est mise à l’épreuve sur La
Cathédrale engloutie de Debussy.
Claude Dauphin explore dans son texte les Lieux et attributs de la musique au temps des
Encyclopédistes. Il met en scène l’un des débats les plus ardus qu’ait connus le Siècle des Lumières,
où s’opposaient deux conceptions contradictoires, l’une revendiquant une spécificité française
articulée autour d’une capacité représentative de la musique, comme en fait foi l’œuvre de Jean-
Philippe Rameau, alors que l’autre, soutenue particulièrement par Jean-Jacques Rousseau, en
appelait à l’expérience italienne et définissait l’expression des sentiments comme la seule
figuration qui serait accessible à la musique, comme si celle-ci ne pouvait se donner comme objet
qu’une vie intérieure faite des mouvements pulsionnels de l’affect. Ce débat fut central dans la
France prérévolutionnaire et, curieusement, en adoptant une perspective historique, on a
l’impression de se trouver devant cet autre débat qui, un siècle plus tard, allait opposer les
Modernes aux Romantiques. À vrai dire, les questions actuellement posées sur la musique et sur
les conditions de la signification ne nous semblent pas non plus éloignées de ce débat.
Ghyslaine Guertin nous fait part d’une découverte importante des dernières années, soit un
essai de musicologie (si l’on peut se permettre cet anachronisme) dû à un philosophe compositeur
violoniste du XVIIIesiècle qui s’était engagé lui aussi dans le débat sur la capacité représentative de
la musique, Michel-Paul-Guy de Chabanon. Le texte de Mme Guertin nous permet de découvrir
quelques prises de position extrêmement modernes: l’oreille est le seul fondement du plaisir de la
musique ou, pour reprendre une formulation inverse, la musique plaît indépendamment de toute
imitation pour la raison bien simple que l’oreille [...] comme la vue, l’odorat, le toucher possède ses
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%