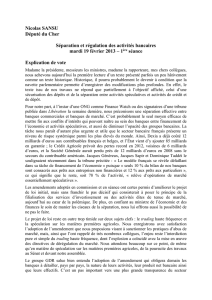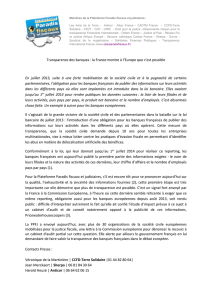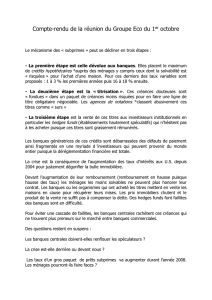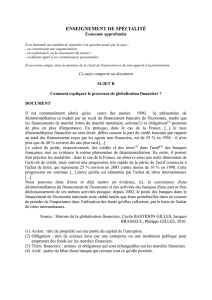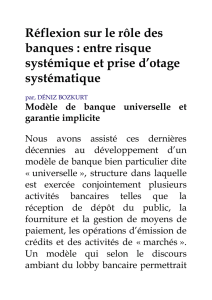Conférence_sociale_Note de contribution du Secours Catholique

106, rue du Bac – 75341 Cedex 07 - Paris
FS/BS/AB/egd - 255
Paris, le 5 juillet 2012
Note de contribution en réponse à la sollicitation adressée par M. Michel SAPIN,
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
au Secours Catholique en date du 28 juin.
Objet : Préparation de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012.
1. Développer l’emploi, et en priorité l’emploi des jeunes.
1.1 Éviter la précarisation voir la disparition de l'emploi en particulier dans les PME et
les activités artisanales.
Cette situation est très souvent due aux conditions de rémunération accordées par les
grands donneurs d'ordres aux sous-traitants. Les petites entreprises ont également des
difficultés à résister parce qu'elles n'assurent pas les conditions de continuité et les garanties
d’achèvement que demandent les donneurs d'ordres. Par ailleurs, on constate que les
mécanismes de reprise d'entreprises fondés sur les techniques de LBO (leverage buy out)
conduisent à la destruction d'entreprises à travers la vente par appartements moyens visés
pour réaliser de fortes plus-values.
Le développement des groupements d'entreprises, tel qu'il se développe dans le monde
artisanal ou dans le secteur de la consommation offre une bonne solution pour préserver des
unités de production bien implantées dans les territoires.
1.2 Favoriser le lien entre insertion et entreprise.
Des expérimentations ont lieu en ce sens dans la région Rhône-Alpes pour permettre à des
personnes en grande difficulté de prolonger leur période d'insertion dans des chantiers afin
de mieux réaliser leur entrée sur le marché du travail. Cette expérimentation permet de
réunir deux acteurs économiques qui n'ont pas souvent l'occasion de se retrouver : les
structures d'insertion et les entreprises. Il faudrait développer ce type de démarche qui peut
intéresser plusieurs milliers de personnes qui, à l'issue de leur parcours d'insertion, ne
trouvent pas de débouchés.
1.3 Réussir la transmission d'entreprise.
La formule de la coopérative ouvrière (SCOP) ne doit pas être utilisée essentiellement pour
la reprise d’entreprises défaillantes mais au contraire pour permettre à des chefs d'entreprise
de transmettre celle-ci à leurs salariés, évitant de ce fait un démantèlement particulièrement
préjudiciable.

Note de contribution du Secours Catholique
Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012
2
1.4 Mieux connecter deux dispositifs : le contrat de génération et les emplois d’avenir.
Nous proposons que des séniors en contrats de génération dans le secteur marchand ou
ESS soient mis à disposition d'association ou SIAE pour une part de leur temps de travail,
dans le cadre du mécénat de compétence afin de soutenir des associations ou structures
IAE dans leur développement.
Cela créerait un lien entre acteurs de l’économie classique et acteurs de l’économie sociale
sur les territoires. Les rencontres « agir pour l’insertion » de Paris et Lyon ont mis en
évidence l’ignorance qu’ont les entreprises classiques des atouts et potentiels des structures
IAE. Les séniors, dans le cadre du contrat de génération, seraient de bons ambassadeurs
d’un rapprochement profitant aux deux parties, sur des questions de recrutement, de
marchés à passer respectant telle ou telle clause sociale, d’alternance entre le « milieu
protégé » de la SIAE et le cadre de travail en entreprise.
Sur le reste de leur temps de travail, ils assureraient le tutorat du jeune recruté dans le cadre
du contrat de génération dans leur entreprise. En plus d'agir sur l'emploi il me semble que ce
travail contribuerai à la dynamique générale de cohésion sociale, de recréation de sens dans
l'entreprise marchande et pourrait être assimilé à de l'expérimentation managériale comme
cela se réfléchi dans certaines grandes entreprises aujourd'hui.
2. Réunir les conditions du redressement productif.
2.1 Soutenir les TPE ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
La question fondamentale est aujourd'hui celle de la dotation en fonds propres. Les capitaux
actuellement disponibles pour l'investissement en capital de risque veulent, devant la montée
des risques encourus, des rémunérations qui ne peuvent être fournies par ces entreprises.
Trop souvent pour pallier le manque de fonds propres, il est fait appel à des prêts qui sont
toujours des fonds remboursables. La faiblesse des fonds propres ne permet pas aux
entreprises de faire face aux aléas de la conjoncture et aux échéances de remboursement
des prêts.
Les structures de garantie sont trop tournées vers la garantie de prêt partant du principe que
l'investissement en capital introduisant la possibilité d'obtenir de fortes plus-values ne
nécessite pas de garantie.
L’Économie sociale et solidaire qui, par définition n'a pas vocation à rémunérer fortement les
capitaux investis, souffre particulièrement de la très grande difficulté à obtenir les fonds
propres nécessaires.
Pour redresser le tissu productif, l'obtention de fonds propres, et la rémunération raisonnable
de ceux-ci sont des conditions essentielles. Mais cela veut dire que les structures de
capitaux propres à vocation publique doit réviser leurs critères de rémunération.

Note de contribution du Secours Catholique
Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012
3
2.2 Changer le comportement des banques sur les Territoires
1
.
Pour cela, nous faisons une proposition de loi ou d'amendement à la loi bancaire pour
accroitre quantitativement et qualitativement l'investissement bancaire dans le
développement économique des territoires
Les bienfaits de l'économie territoriale doivent être rappelés.
Le maillage d'un territoire par des TPE et entreprises de type ESS, fournissant les biens et
services d'usage courant à ceux qui y vivent et y travaillent, est contributif au redressement
productif.
En effet ce maillage produit des activités, des emplois et de la richesse non dé-localisables,
contribue au développement et à l'entretien du lien social en lui fournissant son
indispensable substrat économique, est source d'innovation et d'émergence de l'économie
de demain, fertilise le terreau économique (activités de service et de sous-traitance, main
d'œuvre qualifiée, culture entrepreneuriale...) dont les PME, ETI et grandes entreprises qui
s'y implantent tirent une part importante des ressources de leur croissance et de leur
compétitivité sur les marchés extérieurs.
L'investissement des banques dans le développement économique local est nécessaire mais
reste insuffisant et inadéquat.
Pour naître, s'installer dans la durée et se développer, les TPE et entreprises de l'ESS ont
besoin d'accéder aux crédits et services bancaires. Or cet accès est à la fois insuffisant et
inadéquat.
Il est insuffisant comme le prouve le nombre de petites entreprises qui demeurent non
bancarisées trois ans après leur naissance et plus encore le nombre de projets d'entreprise
qui ne voient pas le jour ou ne survivent que quelques brèves semaines faute d'un
partenariat bancaire.
Cette carence est d’abord imputable à l'insuffisance de l'offre. Les banques sont réticentes à
proposer crédits et services à de petits projets car elles sont persuadées que l'intérêt sur un
petit prêt ne peut couvrir en même temps les coûts de l'instruction et du suivi du dossier et
un risque qu’elles ne savent pas évaluer. Cette réticence s’accroit considérablement avec la
crise et les difficultés des banques à s’autofinancer. En outre recherchant les économies
dans la centralisation les banques délestent progressivement les territoires de l’expertise en
agence.
Mais l'offre de crédit n'est pas seulement insuffisant, elle est aussi inadéquate, parce que le
produit offert est mal adapté aux besoins des petites entreprises en création ou en
développement : les critères d'évaluation du risque, les grilles d'analyse des besoins et
d'élaboration des réponses en crédits et services sont construits pour l'essentiel en référence
à une clientèle de PME établies de longue date. Quant aux cas plus particuliers de petites
entreprises ou porteurs de projets issus de quartiers urbains « difficiles » ou de territoires
ruraux « fragiles », l'offre bancaire sait mal prendre en compte la spécificité tant des besoins
que des potentialités d’une clientèle qui ressemble si peu à celle qu'elle a l'habitude de
traiter.
En outre des phénomènes d’auto-exclusion aggravent cette situation : anticipant la réticence
des banques, le porteur de petits projets est convaincu qu'aucune banque ne le suivra et
s'abstient de la solliciter.
1
Travail conduit dans le cadre du LABO de l’Economie Sociale et Solidaire

Note de contribution du Secours Catholique
Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012
4
Pour rapprocher l'offre et la demande de crédit et services bancaires, l'intermédiation
professionnelle mais surtout associative est à l'évidence incontournable.
Comment inciter les banques a intervenir plus, mieux et plus équitablement dans le
développement économique de tous les territoires ?
Accroître l'investissement de l'épargne collectée par les banques dans le développement
économique local résultera pour partie de la réforme bancaire distinguant les métiers de
banques de dépôt de ceux de banques d'affaires. Mais pour orienter massivement l'épargne
collectée vers le financement de l'économie réelle de tous les territoires, il faut des incitations
spécifiques : il est nécessaire que toutes les banques s’impliquent, qu’elles fournissent les
preuves de leur engagement et que cela entrainent pour elles des conséquences positives.
C'est l'objet de la présente proposition.
Celle-ci privilégie délibérément une démarche incitative plutôt que coercitive, des contraintes
d’usage plutôt qu’administratives. En tout état de cause aucune contrainte légale ou
administrative ne saurait justifier d’imposer aux banques de faire du crédit à perte.
En revanche, de nouvelles pratiques bancaires peuvent être induites en changeant les
règles du marché et en pariant sur les effets d'apprentissage d’un nouveau rapport aux
territoires, résultant des points suivants :
la nécessaire transparence, pour chaque territoire et pour chaque agence bancaire,
des circuits de collecte de l'épargne et de son réinvestissement dans le financement
des économies territoriales,
l'émulation entre les réseaux bancaires, des effets de réputation et de
responsabilisation des agences locales,
la mise en débat et la prise en compte de leurs résultats par leurs
partenaires usagers et institutionnels,
le développement de partenariats territoriaux construisant des relations de
confiance et de collaboration entre les banques, les collectivités locales, les
entreprises et les organisations professionnelles et associatives.
L'architecture du dispositif proposé.
1. Recenser à la même échelle géographique toutes les données
pertinentes pour l'analyse et les préconisations.
Devraient y figurer notamment les principales caractéristiques socio-économiques du
territoire, les données relatives à la création d'entreprise et celles de l'activité bancaire dans
le territoire, notamment concernant la collecte et l'affectation de l'épargne et, d'autre part, les
types et montants des crédits et services sollicités et consentis aux TPE et entreprises d'ESS
du territoire.
Les banques fournissent les données relatives à l'épargne qu'elles y ont collectées et à sa
destination ainsi que les types et montants des crédits et services accordés aux TPE et
entreprises d'ESS.
L'Etat, notamment la Banque de France, l'INSEE…. fournissent les données relatives aux
caractéristiques de la population (âge et revenu moyens...), aux activités économiques
(nombre d'emplois, nombre et types d'entreprises, services publics, présence bancaire...),
aux activités de création, reprise et développement de TPE et d'entreprises d'ESS (nombre
d'entreprises de chaque catégorie, taux de pérennité, nombre d'emplois à la création et dans
la durée...).

Note de contribution du Secours Catholique
Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012
5
Les autres partenaires, collectivités locales, organisations professionnelles et associatives
intervenant dans l'accompagnement de la création et du développement des petites
entreprises peuvent enrichir l’analyse grâce aux données relatives aux montants et aux
types d'aides apportées aux créateurs, repreneurs et développeurs de petites entreprises.
2. Analyser, publier et suivre l'évolution de l'investissement des banques
dans le développement économique des territoires.
Les banques signent un engagement de servir de manière responsable et non
discriminatoire tout public et sur tous les territoires, tant en matière de collecte de l'épargne
que d'octroi de crédits et services bancaires aux particuliers, aux TPE et aux entreprises
d'ESS, et d'en publier les résultats.
Un organisme national est créé, chargé d'assurer l'analyse, le reporting et le suivi des
actions menées pour accroitre quantitativement et qualitativement l'investissement des
banques dans le développement économique local. Il dresse et rend public un état
comparatif de l'importance et de la qualité de l'engagement des différents réseaux bancaires
dans l'appui au développement économique local, notamment sous forme de crédits et
services aux TPE et entreprises sociales Il évalue le nombre et la qualité des partenariats
d'intermédiation en faveur des TPE et les entreprises ESS noués par chaque réseau avec
les organisations professionnelles et associatives, mais aussi les marges de progrès de
chaque banque et rend public un rapport circonstancié.
Ce dispositif fera régulièrement l'objet d'un rapport élaboré et débattu au CESE, présenté au
parlement en séance publique et communiqué au gouvernement.
1
/
5
100%