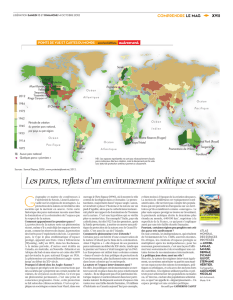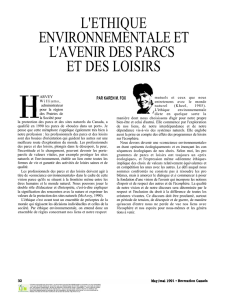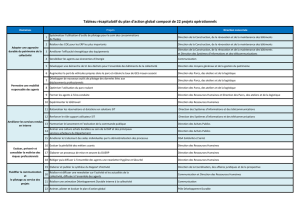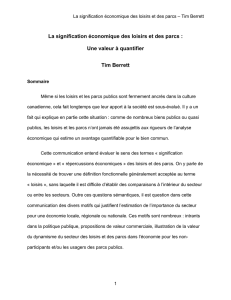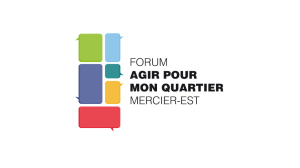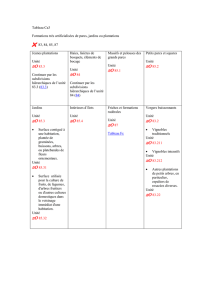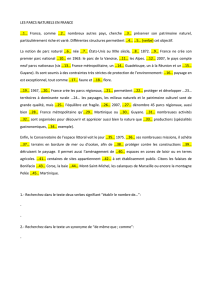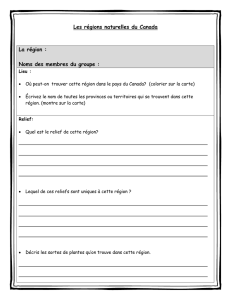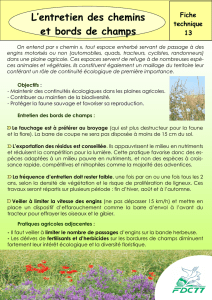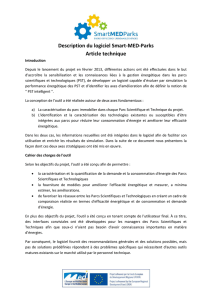Le Programme de suivi de l`intégrité écologique de Parcs Québec

Revue de diffusion des connaissances en sciences naturelles et en environnement
Tiré à part
Le Programme de suivi de
l’intégrité écologique de Parcs Québec
Patrick Graillon
Volume 133, numéro 3 – Numéro spécial
Colloque sur la recherche scientifique dans le
réseau québécois des parcs nationaux (Sépaq)
La connaissance au service de la conservation
Page 117-124


117
LE NATURALISTE CANADIEN, 133 NO 3 automne 2009
TRAVAUX APPLIQUÉS
Patrick Graillon (géographe, M. Env.) est coordonnateur à la
conservation de Parcs Québec à la Société des établissements
de plein air du Québec.
Introduction
Parcs Québec s’est engagé, au début des années 2000,
dans un processus de suivi de l’intégrité écologique. Un ques-
tionnement sur le maintien de l’intégrité écologique des
parcs nationaux a d’abord été évoqué par Parcs Canada dans
son Rapport sur l’état des parcs de 1997 (Parcs Canada, 1998),
à la suite des recommandations issues d’un groupe d’étude
de la vallée de la Bow, dans le parc national de Banff (Page et
collab., 1996). Ceci a mené, en 1998, à la mise en place d’une
commission sur l’intégrité écologique des parcs et au dépôt,
en 2000, d’un rapport sur la question (Agence Parcs Canada,
2000a, 2000b). Ce dernier affirme que les impacts des activi-
tés humaines affectent l’intégrité écologique des parcs natio-
naux du Canada. Dans la foulée de ces rapports, l’Agence
Parcs Canada a mis au cœur de ses priorités le maintien et
la surveillance de l’intégrité écologique (Major et Richard,
2002). À la lumière des conclusions de Parcs Canada, Parcs
Québec a aussi décidé de mettre en place un Programme de
suivi de l’intégrité écologique (PSIE) pour surveiller l’état de
l’intégrité écologique des parcs nationaux du Québec. Parcs
Québec s’est ainsi doté d’un outil dont le but est de s’assurer
que la gestion et l’utilisation des parcs permettent le maintien
de l’intégrité écologique à long terme. Le PSIE permet aussi
d’identifier des problématiques et d’agir rapidement, si la
situation l’exige et s’il est possible de le faire (Société des éta-
blissements de plein air du Québec (Sépaq), en préparation).
Les bases du PSIE ont été établies par le Service des parcs du
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) et la Sépaq. Le programme a ensuite
été développé et mis en œuvre par la Sépaq.
Le Programme de suivi de l’intégrité écologique
de Parcs Québec
Patrick Graillon
Résumé
En 2004, Parcs Québec a implanté un Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) qui, à l’aide d’indicateurs, vise
à identifier les changements de l’état de la santé des parcs de son réseau. Le programme se base sur la notion de « niveau »
d’intégrité écologique afin d’évaluer l’importance de l’activité humaine sur les processus écologiques naturels. Plusieurs
indicateurs sont utilisés pour tenter de cerner le mieux possible les paramètres définissant l’intégrité des écosystèmes
(qualité de l’eau, de l’air, de la flore et de la faune, impacts des infrastructures, pressions périphériques, etc.). Les indicateurs
ont été retenus en fonction de leur capacité à témoigner de l’influence des activités humaines sur les milieux naturels. Pour
aider à illustrer les changements mesurés, et, conséquemment, ceux du niveau d’intégrité écologique, un système de pon-
dération est utilisé. Il permet de ramener à une échelle commune les résultats des différents indicateurs et d’établir, par le
calcul d’une note, si le niveau d’intégrité global a tendance à s’améliorer, à se détériorer ou à rester stable. Pour assurer sa
pérennité, ce programme représente un compromis entre son efficience et sa validité scientifique. Ce programme est aussi
dynamique et perfectible. En 2009, la Sépaq produira un premier bilan quinquennal sur l’état du PSIE.
Au moment d’élaborer le PSIE, il n’existait aucun
programme de suivi de l’intégrité écologique spécifique des
parcs nationaux. Le PSIE a donc été conçu en se basant sur
diverses sources d’informations disponibles, dont d’autres
types de suivis environnementaux, et en utilisant des princi-
pes et des méthodes novatrices. C’est par l’application directe
de ces concepts sur le terrain et par leur évaluation constante
que les indicateurs retenus ont été validés, modifiés ou sim-
plement abandonnés. Le PSIE a d’abord été mis en place
dans les parcs nationaux du Mont-Mégantic et du Mont-
Saint-Bruno en 2003. Il a ensuite été adapté et implanté dans
l’ensemble des parcs du réseau de Parcs Québec en 2004.
Le PSIE a été développé dans le but de donner un
portrait de l’état des parcs aux gestionnaires de la Sépaq.
Puisque cette dernière s’est vu confier par le gouvernement
le mandat de gérer les territoires eux-mêmes, c’est l’échelle
spatiale des parcs, pris individuellement, qui constitue le
champ d’application du PSIE. Le programme sert donc à
donner des informations sur le territoire lui-même, là où
les gestionnaires ont un pouvoir d’action direct. Le PSIE est
avant tout un outil permettant à un parc de se comparer à
lui-même. Il ne cherche alors pas à évaluer la structure ou
à se comparer aux autres parcs, aires protégées et milieux
naturels, mandat relevant des paliers gouvernementaux res-
ponsables de l’aménagement du territoire.

118
LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA
TRAVAUX APPLIQUÉS
L’intégrité écologique
Dans le cadre du PSIE, on considère qu’un écosys-
tème est intègre lorsqu’il possède toutes ses caractéristiques
naturelles de base (espèces, habitats, milieux géophysiques,
etc.) et que les processus écologiques qui s’y déroulent (évo-
lution, croissance, reproduction, migration, érosion, etc.)
fonctionnent normalement (adapté de Parcs Canada, 1998).
Cette assertion sous-tend que les facteurs pouvant modifier
cet état de fonctionnement naturel ont une origine anthropi-
que bien que l’être humain soit une espèce vivante au même
titre que toutes les autres. Le PSIE tente donc de caractériser
l’influence des activités anthropiques sur les processus écolo-
giques dits naturels (soustraits de l’influence humaine).
Reconnaître l’interrelation entre l’intégrité écologi-
que et les impacts des activités humaines mène à une question
fondamentale : pour un territoire donné en un temps donné,
comment devraient être les écosystèmes qui s’y trouvent
pour être considérés écologiquement intègres ? Répondre
à cette question suppose la connaissance parfaite des carac-
téristiques primitives (exemptes d’influences humaines)
qu’auraient naturellement le territoire et les processus écolo-
giques normaux qui y prennent place. Il faudrait aussi maîtri-
ser l’historique des perturbations anthropiques ayant eu une
influence sur les écosystèmes au fil du temps. Comme il est
très difficile d’obtenir toutes ces connaissances sur le milieu,
répondre à cette question s’avère pratiquement impossible.
L’approche de Parcs Québec
En 2002, Parcs Québec a mis en place un comité de
suivi de l’intégrité écologique afin de développer le PSIE et
de définir les orientations de celui-ci. Pour résoudre le pro-
blème de définitions de points de repère, le comité a utilisé
la notion de «niveau» d’intégrité écologique. Ce concept
représente une mesure relative qui varie en fonction de l’im-
pact des activités humaines. Ainsi, plus un écosystème est
affecté par des perturbations anthropiques, plus son niveau
d’intégrité écologique est bas. La notion de niveau permet de
comparer la situation d’un écosystème dans le temps et d’éta-
blir la tendance de cet état. Pour les gestionnaires des parcs,
il est nécessaire d’établir un niveau d’intégrité écologique
de référence. Ce niveau de référence est propre à chacun des
suivis pour chacun des parcs. Il est obtenu lors du premier
relevé d’un indicateur. C’est à partir de ce niveau de référence
qu’il sera possible de définir si la situation s’améliore ou se
détériore, et à quel degré. Le défi des gestionnaires des parcs
consiste donc à maintenir ou améliorer le niveau d’intégrité
écologique tout en assurant l’accessibilité de ces territoires
protégés.
Puisque le niveau d’intégrité écologique d’un écosys-
tème ne se mesure pas directement, il faut l’évaluer à partir
d’autres éléments qui, eux, sont plus facilement mesurables,
c’est-à-dire des indicateurs environnementaux. Si l’on
observe un changement dans les paramètres mesurés par un
indicateur, on peut alors supposer une variation du niveau
d’intégrité écologique. Pris dans leur ensemble, les différents
indicateurs permettent d’avoir une meilleure vue d’ensemble
du niveau d’intégrité écologique d’un territoire à un temps
donné. Ces indicateurs sont de différents types. Il s’agit de
caractéristiques physiques ou chimiques du milieu, de suivis
d’espèces ou de groupes d’espèces, ou encore du suivi de
l’impact environnemental de certaines infrastructures. Les
indicateurs sont regroupés en deux grandes classes, soit ceux
qui suivent la qualité des habitats (bio-indicateurs) et ceux
qui suivent les composantes de l’activité humaine affectant
le territoire.
Sélection des indicateurs
Des travaux de la Société de la faune et des parcs du
Québec (Girard, 2000 ; Crête, 2002 ; Société de la faune et
des parcs du Québec, 2003), de Parcs Canada (Woodley,
1991 ; Agence Parcs Canada, 2005, 2007) et du National Park
Service des États-Unis (National Park Service, 2009) ont
servi (et servent toujours) de référence au comité d’intégrité
écologique pour choisir, adapter et bonifier les indicateurs et
les méthodologies qui composent le PSIE (tableau 1).
Les indicateurs retenus répondent à plusieurs critè-
res : 1) ils reposent sur une hypothèse ou un postulat de base
confirmant le lien entre les changements pouvant affecter
l’état des écosystèmes et l’influence des activités humaines ;
2) les mécanismes qui induisent le changement d’état doi-
vent être connus ; 3) les changements observés doivent être
représentatifs de modifications écologiques du milieu, et
4) les changements doivent être mesurables par des métho-
des réalisables avec les ressources disponibles.
Les méthodes retenues pour faire les suivis ont été
sélectionnées et, le cas échéant, modifiées, afin d’obtenir un
maximum de rigueur scientifique en fonction des capaci-
tés de réalisation. On peut ainsi ignorer une méthode très
pertinente, mais trop onéreuse, pour privilégier une façon
de faire plus simple, qui permet tout de même de manière
satisfaisante de répondre à la question fondamentale du
programme de suivi, à savoir si la variation de valeur des élé-
ments mesurés témoigne d’un changement positif ou négatif
du niveau d’intégrité écologique.
Puisque les réalités biologiques et géographiques des
territoires sont très variables, les parcs ne suivent pas néces-
sairement tous les mêmes indicateurs ou ne les suivent pas
tous de la même manière. En outre, certains parcs font des
suivis qui leur sont propres à cause de situations uniques à
leur territoire. Ces suivis concernent particulièrement les
indicateurs sur la qualité de l’eau, la répartition de la faune,
la situation des espèces à statut particulier et la qualité des
habitats exceptionnels ou sensibles. Le tableau 2 présente
des exemples de ces indicateurs spécifiques mis en place dans
les parcs.
Dans le choix des méthodologies, le PSIE tire profit,
lorsqu’il est possible de le faire, des recherches et travaux
effectués par d’autres partenaires. Par exemple, les infor-
mations sur les précipitations acides proviennent des

119
LE NATURALISTE CANADIEN, 133 NO 3 automne 2009
TRAVAUX APPLIQUÉS
Tableau 1. Liste des indicateurs retenus pour le programme de suivi de l’intégrité écologique du réseau québécois des
parcs nationaux.
Classe Paramètres vérifiés Indicateurs et exemples de suivis Fréquence
des suivis
Qualité de l’habitat
L’air
Le degré d’acidité des précipitations
Stations de mesure du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
ou mesure du pH des lacs
Annuel
La concentration d’ozone troposphérique
Stations de mesure du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec Annuel
Les émissions issues de la combustion du bois
Inventaire du bois de chauffage acheté, s’il y a lieu Annuel
L’eau
L’état de la faune benthique
Calcul de l’indice biologique général normalisé 3 ans
Le degré d’eutrophisation des lacs
Calcul de la cote trophique Variable
La qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau
Calcul de l’indice de qualité biophysique ou suivi des eaux de baignade Variable
La faune et la flore
La propagation des plantes vasculaires non indigènes
Échantillonnage par quadrats d’espèces prédéfinies 2 ou 4 ans
Les espèces exotiques envahissantes
Calcul d’un indice d’envahissement basé sur une liste faunique et floristique d’espèces exotiques
envahissantes
2 ans
Le maintien des processus écologiques naturels
Calcul d’un indice des perturbations d’origine anthropique Annuel
La déprédation
Calcul d’un indice de l’importance des cas de déprédation Annuel
La répartition de la faune
Divers suivis d’espèces fauniques indicatrices ; chacun des parcs suit trois espèces différentes Variable
Les ressources
renouvelables
exploitées
L’état de la ressource halieutique
Calcul du rendement optimal soutenu des lacs pêchés Annuel
Les éléments
écologiques sensibles
La situation des espèces à statut particulier
Divers suivis d’espèces préoccupantes ou en péril ; chacun des parcs suit deux espèces différentes Variable
La qualité des habitats exceptionnels ou sensibles
Divers suivis d’habitats particuliers; chacun des parcs suit deux habitats différents Variable
Activités humaines
Les infrastructures
La densité des infrastructures
Calcul d’un indice relatif à la quantité des infrastructures 2 ans
La fragmentation du territoire
Calcul de l’indice de dissection du paysage 5 ans
L’emprise des sentiers
Suivi de la dégradation issue de la fréquentation des sentiers Annuel
L’état des sites de camping
Calcul d’un indice de dégradation des sites Annuel
La qualité des aménagements reliés aux berges
Calcul d’un indice de dénaturalisation occasionnée par les aménagements sur les berges Variable
La zone périphérique
L’utilisation des terres en zone périphérique
Calcul d’un indice d’occupation du sol obtenu par imagerie satellitaire 5 ans
La qualité des habitats fauniques
Calcul du succès de chasse au gros gibier en périphérie Annuel
La gestion
administrative
Le temps consacré à la protection
Calcul du temps consacré à la protection du territoire Annuel
Le contact éducatif avec les visiteurs
Calcul des heures-contacts d’interprétation Annuel
Les baux, servitudes et droits acquis
Calcul d’un indice de préjudice à la mission, issu des baux, servitudes et droits acquis dans les parcs Annuel
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%