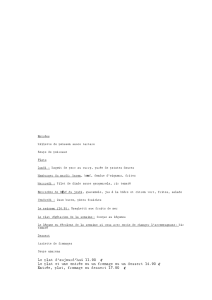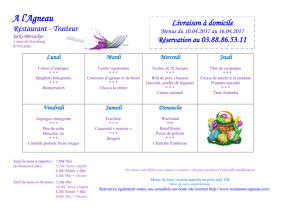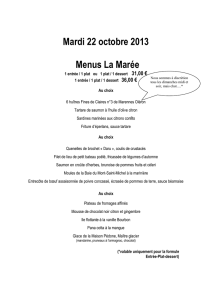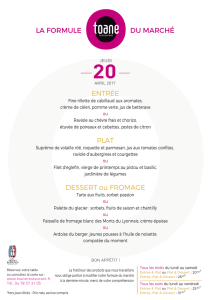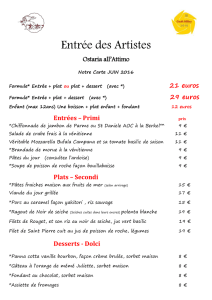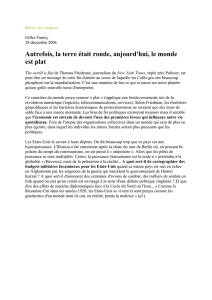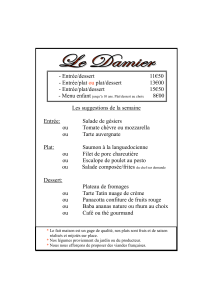Chasses Royales autour d`un plat

« ’ » 105
Un cavalier désarçonné est représenté au premier
plan de la gravure, tel qu’il est reproduit au centre du
plat (fig.4)
Les monarques Européens aimaient se faire
représenter sous le prétexte de ce sport princier par
excellence qu’était la chasse à courre.
François 1er, après son retour de Madrid où
l’empereur Charles Quint le retenait prisonnier après
la défaire de Pavie en 1527, passa à la postérité en
faisant ériger un fabuleux relais de chasse au milieu
« Chasses Royales autour d’un plat »
(Suite)
Edouard Williamson
L’article paru en 2010 dans le numéro 19 de la revue
Sèvres soulevait beaucoup de questions. Sa parution
engendra une moisson de réponses.
Chevauchant un cheval représenté « en majesté »
on reconnaît le Roi Louis XIV chassant en forêt de
Compiègne. Il est coiffé de la grande perruque bouclée
en vogue à Versailles sous son règne (fig.2).
Une colline à l’arrière plan sommée de tours,
reproduite sur le plat, borde la rivière de l’Oise (fig.3).
1. Nevers plat de chasse daté de 1758, peint par Claude Guillaume Bigourat.

revue de la société des amis du musée national de céramique106
de la forêt de Chambord qui tient presque du conte de
fées.
Charles Quint quant à lui fit tisser à Bruxelles
en mémoire de son grand-père la célèbre tenture
des « Chasses de Maximilen » d’après des cartons
de Bernard van Orley (1491–1541) peintre à la cour
de Marguerite d’Autriche, fille de l’empereur
Maximilien de Habsbourg, et gouvernante des Pays
Bas. Cette magnifique tenture tissée en fils de laine,
soie, or et argent représentant les chasses à la cour de
Brabant fut ensuite acquise par Mazarin qui la vendit
à LouisXIV en 1665.
L’original, aujourd’hui conservé au musée du
Louvre, comporte 12 tapisseries représentant les mois
de l’année où figurent de nombreux personnages
animés, chassant dans la forêt de Soignes près de
Bruxelles.
A l’instar du château de François 1er, Auguste le
Fort, contemporain de Louis XIV, fit élever en Saxe un
immense et magnifique relais de chasse à Moritzburg
aux environs de Dresde, où sont conservés les plus
grands trophées et dont les terrasses sont ornées de
sculptures de piqueux sonnant de la trompe (fig.6).
Louis XV, orphelin dès l’âge de deux ans, après 7
ans passés auprès de la Duchesse de Ventadour fut
élevé par le Duc de Villeroy qui lui communiqua une
passion dévorante pour la chasse.
Tout jeune encore il fit commander en 1733 par
l’intermédiaire du Duc d’Antin, directeur des
2. « La Chasse Royale » estampe de Nicolas de Larmessin (1645-1725), adaptée d’une gravure de Jacques Callot.
3. l’Oise.
4. Cavalier désarçonné.

« ’ » 107
Bâtiments du Roy, une tenture le représentant
à la chasse, devenue sous son règne un véritable
cérémonial de cour que représenta brillamment Jean
Baptiste Oudry en croquant sur le vif les scènes de
chasse, qui donnèrent ensuite lieu au tissage en fils
de laine et soie dans les ateliers de Monmerqué aux
Gobelins de la tenture comportant 9 tapisseries des
« Chasses de Louis XV », conservée au château de
Compiègne. Il est aussi probable qu’Oudry connaissait
les œuvres de ses prédécesseurs tels que « La Chasse
Royale » de Nicolas de Larmessin.
Ayant hérité d’une passion similaire, Louis XVI
se fit représenter à la chasse en lieu et place de son
grand-père sur 9 plaques en porcelaine destinées à
être insérées entre les lambris de la « Salle à manger
Nouvelle » des appartements du Roi à Versailles.
Sur le modèle exact des Chasses de Louis XV
d’Oudry, elles furent peintes à Sèvres autour de 1780
par de grands artistes tels que Nicolas Dodin, Charles
Etienne Legay, Philippe Castel, Charles Eloi Asselin.
Notre plat est daté de 1758, soit l’année de la mort
d’Oudry, survenue 3 ans après la fin du tissage de la
tenture des chasses de Louis XV.
Bien que directement inspiré de la gravure de
Larmessin, il est tentant de penser que le peintre du
plat ait voulu « actualiser » son décor réalisé près de
75 ans plus tard. On pourrait en tous cas le penser à la
vue des représentations du Roy (fig7).
Celui-ci en effet a perdu sa grande perruque bouclée
au profit de celle que portait la cour au milieu du
esiècle, et tend le bras droit en pointant de l’index,
comme Louis XV dans la tenture d’après Oudry, alors
que la main droite de Louis XIV dans la gravure de
Larmessin tient une canne pointant vers le sol.
6. Moritzburg. 7. Détail de la tapisserie représentant Louis XV aux Rochers
Franchard en forêt de Fontainebleau.
5. Le Roy : Interprétation de la gravure, car il s’agit ici de Louis XV.

revue de la société des amis du musée national de céramique108
L’auteur tient à exprimer sa vive reconnaissance à
Monsieur Maxime Préaud, conservateur général du
département des estampes et photographies de la
Bibliothèque nationale de France, qui communiqua
l’estampe ayant servi de modèle au peintre du
plat, ainsi qu’à Monsieur Jean Rosen, directeur
de recherches au CNRS qui a identifié le peintre et
l’attribution du plat.
Edouard Williamson
Administrateur de la Société des Amis du Musée
National de Céramique, Sèvres – Cité de la céramique
Infime détail ? Sans aucun doute mais qui pourrait
peut être conduire à émettre l’hypothèse que le
peintre du plat, dont le talent est exceptionnel, ait
connu l’œuvre d’Oudry. Peut être même avait-il été
apprenti dans l’atelier de ce dernier ? Il lui aurait fallu
pour cela jouir de bonnes relations.
Alors qui était ce peintre, et à quel centre peut-on
attribuer ce plat ?
D’après les recherches de Jean Rosen il s’agirait de
Claude Guillaume Bigourat (1735–1794) filleul de
Claude Guillaume Prisye de Chazelles, fondateur de
1751 à Nevers de la manufacture de faïences « la Fleur
de Lys » qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 1758, date de
notre plat. (voir Gabriel Montagnon 1987, p. 101)
On peut donc aussi attribuer à Nevers le superbe
Plat représentant la « Pêche à l’Épervier » lui faisant
pendant, conservé au Musée des Arts Décoratifs de
Bordeaux, de dimensions identiques et peint de la
même main, telle que le démontre l’image ci jointe
gracieusement envoyée par le musée que je remercie
vivement, et sur lequel on reconnaît les bateaux de
Loire ainsi que le célèbre Pont de Nevers sommé en son
centre d’une croix.
8. Nevers « La pêche à l’épervier » par C.G.Bigourat, Bordeaux, Musée des Arts Décoratifs.
1
/
4
100%