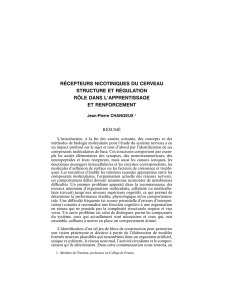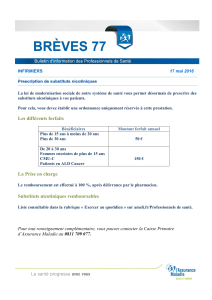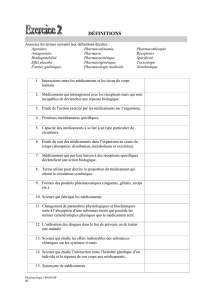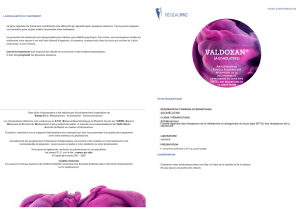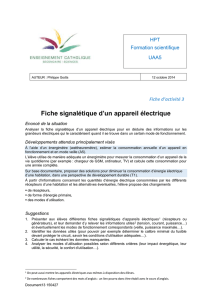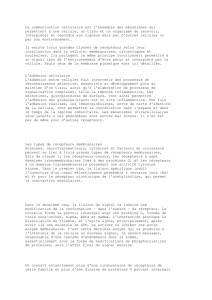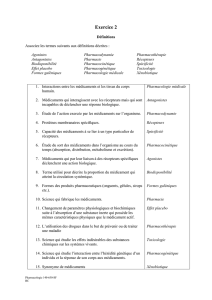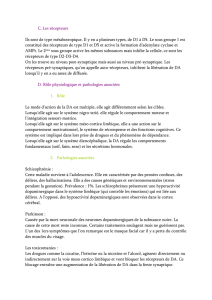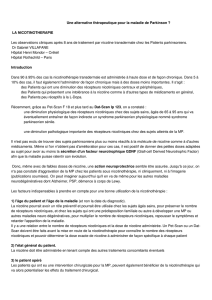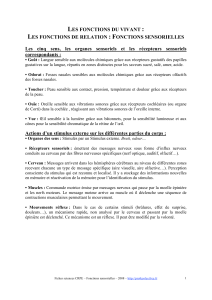Les récepteurs nicotiniques

PHARMACOLOGIE
114
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
es récepteurs nicotiniques ont été les premiers récep-
teurs à être isolés et purifiés, bien avant que l’on ait
pu le faire pour d’autres récepteurs. En effet, l’organe
électrique du poisson torpille est formé d’amas de cellules élec-
triques issues d’un tissu embryonnaire identique à celui du
muscle squelettique, et qui est riche en récepteurs nicotiniques.
La caractérisation des sous-types de récepteurs cholinergiques
a été initialement fondée sur l’activité pharmacologique de deux
alcaloïdes, la nicotine et la muscarine. Ainsi, la classification
des récepteurs s’est établie bien avant que les structures chi-
miques de ces agonistes naturels ne soient déterminées.
Les très grandes différences d’activité des antagonistes (l’atro-
pine sur les récepteurs muscariniques, la d-tubocurarine sur les
récepteurs nicotiniques) laissaient supposer l’existence de nom-
breux récepteurs. Il a été prouvé ultérieurement que tous les
récepteurs nicotiniques n’étaient pas identiques. On distingue
ainsi les récepteurs nicotiniques des synapses neuroneuronales,
les récepteurs nicotiniques trouvés à la jonction neuro-
musculaire et les récepteurs du système nerveux central.
STRUCTURE DU RÉCEPTEUR NICOTINIQUE
Le récepteur nicotinique est constitué de cinq sous-unités
arrangées autour d’un pseudo-axe de symétrie. Il appartient
au groupe des récepteurs polymériques de la membrane plas-
mique incluant un canal ionique (hétéro-oligomère glyco-
protéique transmembranaire). Ce groupe de récepteurs, outre
les récepteurs nicotiniques, comprend les récepteurs A de
l’acide gamma-aminobutyrique (GABA A), les récepteurs
5-HT3de la sérotonine, le récepteur de la glycine et les récep-
teurs des acides aminés excitateurs. Les récepteurs nicoti-
niques sont des éléments clés dans la transmission choliner-
gique, que ce soit au niveau de la jonction neuromusculaire
des muscles striés, de la synapse des ganglions du système
autonome périphérique, ou dans différentes régions du
cerveau.
Parmi les cinq sous-unités, une des sous-unités αest présente
en double, alors que les trois sous-unités β,γet δsont présentes
en simple (figure 1). Les gènes des différentes sous-unités sont
portés par des chromosomes différents. Ainsi, le récepteur est
un pentamère qui a une masse moléculaire d’environ 280 000.
En microscopie électronique, il est visible comme une protéine
transmembranaire de 11 nanomètres de long en forme de rosette
de 8 nanomètres de diamètre. La cavité centrale est un canal
ionique qui, au stade de repos, est imperméable aux ions ; son
diamètre est d’environ 6,5 angströms.
Les récepteurs nicotiniques
The nicotinic receptors
!
M. Bourin*
*E.A.3256 “Neurobiologie de l’anxiété et de la dépression", faculté de méde-
cine, BP 53508, 44035 Nantes Cedex.
RÉSUMÉ.
Les récepteurs nicotiniques sont constitués de cinq sous-unités arrangées autour d’un pseudo-axe de symétrie. Ils existent sous une
grande variété de sous-types liée à la diversité des gènes codant les sous-unités. Parmi les nombreux sous-types de récepteurs nicotiniques
exprimés dans le cerveau des mammifères, les types α4, β2 et α7 sont les plus souvent rencontrés ; ils sont à la fois pré- et postsynaptiques.
Les récepteurs nicotiniques sont impliqués dans des fonctions cognitives complexes telles que l’attention, l’apprentissage, la consolidation de
la mémoire, etc.
Il existe des preuves que la perte des récepteurs nicotiniques est corrélée à la sévérité de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, il semblerait que
le peptide β-amyloïde module directement les récepteurs nicotiniques, permettant de penser que les modulateurs allostériques pourraient entrer
en compétition avec ce peptide.
Mots-clés :
Récepteurs nicotiniques - Maladie d’Alzheimer - Sous-unités α- Peptide β-amyloïde.
ABSTRACT.
The nicotinic receptors are comprised of five sub-units arranged around a pseudo-axis of symmetry. A large variety of sub-types
exist, linked to the diversity of genes coding sub-units. Among the numerous sub-types of nicotinic receptors expressed in the brain of mam-
mals, types α4, β2, and α7 are the more often detected and are expressed both pre- and postsynaptically. The nicotinic receptors are implica-
ted in complex cognitive functions such as attention, learning, memory foundation, etc.
Evidence demonstrates that nicotinic receptor loss is correlated to the severity of Alzheimer’s disease. Also, it seems that the β-amyloid peptide
directly modulates the nicotinic receptors, suggesting that allosteric modulators may compete with this peptide.
Key-words :
Nicotinic receptors - Alzheimer’s disease - αsub-units - β-amyloid peptide.
L

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
115
PHARMACOLOGIE
Les récepteurs nicotiniques existent sous une grande variété de
sous-types : cette hétérogénéité est due à la diversité des gènes
codant pour les sous-unités des récepteurs. Seize gènes codant
pour les sous-unités (α1 à α9, β1 à β9, γ,εet δ), qui dérivent
d’un ancêtre commun, ont été clonés chez les vertébrés. Seules
les sous-unités αpossèdent un pont disulfure entre les résidus
cystéines du domaine N-terminal extracellulaire.
Les sous-unités ont cependant quelques traits structuraux com-
muns : un domaine N-terminal important, quatre séquences
transmembranaires putatives (M1-M4), une boucle intracellu-
laire de longueur variable dépendant de la sous-unité, rejoi-
gnant le troisième et le quatrième domaine transmembranaire
(qui est très important pour la régulation des récepteurs), et une
courte séquence extracellulaire C-terminale (figure 2).
L’analyse de la séquence des acides aminés des sous-unités
indique que les récepteurs nicotiniques peuvent être subdivisés
en trois sous-familles. La première est formée des récepteurs
nicotiniques des muscles squelettiques et de l’organe électrique
du poisson torpille, qui a une composition α1, β1 γ1 et δ1 dans
la forme fœtale et α1, β1, εet δ1 dans la forme mature. Ces
récepteurs nicotiniques sont sélectivement reconnus et bloqués
par l’α-bungarotoxine isolée du venin de cobra. Les récepteurs
nicotiniques neuronaux ont aussi une structure pentamérique
formée de la combinaison de α2, α3, α4 et α6 avec des sous-
unités β2 ou β4 et quelquefois aussi des sous-unités α5 ou β3.
La troisième sous-famille est constituée de récepteurs nicoti-
niques qui se lient à l’α-bungarotoxine et sont formés par les
sous-unités α7, α8 ou α3. Le site de liaison de l’acétylcholine
est situé dans le domaine extracellulaire N-terminal, à l’inter-
face entre les sous-unités αet les autres types de sous-unités.
Actuellement, la classification des récepteurs est fondée sur les
propriétés pharmacologiques des différentes sous-unités, en
fonction des caractéristiques structurales du complexe (essen-
tiellement αet β).
Parmi les nombreux sous-types de récepteurs nicotiniques qui
sont exprimés dans le cerveau des mammifères, les types α4,
β2 et α7 sont les plus souvent rencontrés. Ils sont à la fois pré-
et postsynaptiques (1).
Le sous-type de récepteur α7 possède des propriétés très
différentes de celles du récepteur α4-β2, notamment une sen-
sibilité plus grande aux ions Ca++ ainsi qu’une désensibilisation
très rapide, une activation par la choline et un blocage par
l’α-bungarotoxine (figure 3).
Figure 1. Section sagittale du récepteur nicotinique. Figure 2. Organisation transmembranaire d’une sous-unité d’un
récepteur nicotinique.
Figure 3. Représentation schématique du récepteur nicotinique α7.
Localisation :système nerveux central (SNC), présynaptique. Fonc-
tion : régulation d’un canal Ca
++
; rapidement désensibilisé après
stimulation par les agonistes ; stimule la libération d’acétylcholine,
de glutamate, de sérotonine, de noradrénaline.

Du fait de sa sensibilité à la choline, le récepteur de type α7
peut être chimiquement excité même après que l’acétylcholine
ait été clivée par les cholinestérases.
Le récepteur de type α7 peut ainsi répondre non seulement aux
événements synaptiques, mais aussi au changement de volume
dans les rapports de concentration entre l’acétylcholine et la
choline. Une désensibilisation rapide du récepteur α7 et une
période réfractaire appropriée peuvent être des prérequis à une
réponse de type tardif. Du fait de sa perméabilité, le récepteur
α7 peut produire des réponses métabotropiques dans la cellule
excitée, ce qui inclut le contrôle par le Ca++ de la libération du
transmetteur ainsi que la stimulation de la transcription du gène
et celle de la biosynthèse protéique.
Très récemment, les premières études électrophysiologiques
des interneurones du cortex cérébral humain ont été publiées
(2). Elles ont montré que les récepteurs nicotiniques α4-β2 et
α7 sont localisés sur les régions somatodendritiques des inter-
neurones humains, démontrant ainsi leur capacité à moduler la
libération de GABA. Cela tend à prouver que les récepteurs
nicotiniques pourraient être impliqués dans les mécanismes
inhibiteurs et désinhibiteurs du cortex (figures 4, 5, 6, 7).
∆
En conclusion, les sous-types de récepteurs α7 sont essentiel-
lement présynaptiques, génèrent des courants Ca++ rapides, et
participent à la libération du glutamate, de la 5-HT et de l’acé-
tylcholine. Les récepteurs de sous-type α4-β2 sont pré- et post-
synaptiques, et participent à la stimulation neuronale induite
par l’acétylcholine.
LOCALISATION DES RÉCEPTEURS NICOTINIQUES
L’innervation cholinergique cérébrale s’effectue à partir de cinq
régions majeures :
"le cerveau antérieur basal, qui innerve le cortex et l’hippocampe ;
"le diencéphale, qui donne naissance à des circuits locaux et
innerve le cortex ;
"le striatum, qui, lui aussi, donne naissance à des circuits locaux ;
"le tronc cérébral, qui innerve le thalamus, le cerveau anté-
rieur basal et le cortex cérébelleux ;
"la moelle épinière qui innerve les muscles crâniens et les
muscles somatiques ainsi que les glandes sécrétoires.
Le système est largement interconnecté, conduisant à la coor-
dination de l’excitabilité neuronale et à différents sous-systèmes
cholinergiques (3).
116
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
PHARMACOLOGIE
Figure 4. Représentation schématique du récepteur nicotinique de
sous-type α,β,γet δ.Localisation :jonction neuromusculaire, post-
synaptique. Fonction : contraction des muscles squelettiques.
Figure 5. Représentation schématique du récepteur nicotinique de
sous-type α,βX Y Z, où X,Y et Z sont δ γ α1 β1. Localisation : gan-
glions du système nerveux autonome (SNA), postsynaptique. Fonc-
tion : régulation du système nerveux autonome (SNA), favorise la
libération des catécholamines des médullo-surrénales.
Figure 6. Représentation schématique du récepteur nicotinique de
sous-type α4-β2. Localisation :système nerveux central (SNC), pré-
ou postsynaptique. Fonction : peut être impliqué dans la migration
neuronale durant le développement cérébral ; diminue dans le cor-
tex cérébral dès le début de la maladie d’Alzheimer.
Figure 7. Distribution des sous-unités dans les récepteurs nicoti-
niques selon leur localisation.

Les récepteurs nicotiniques sont essentiellement localisés dans
plusieurs aires corticales, la substance grise périaqueducale, les
noyaux gris centraux, le thalamus, l’hippocampe, le cervelet,
la rétine (4). Le cortex contient les sous-unités α3, α4, β2 et
β4, qui sont inégalement distribuées parmi les différentes
couches. L’hippocampe contient les sous-unités α3, α4, α5,
α7, β2, β3 et β4. Le cortex auditif contient les sous-unités α7.
La rétine contient les sous-unités α2, α5, α6, α7, et β2. Le cor-
tex occipital contient les sous-unités α2, α3, α4, α6, α7, α8,
β3, β4 et β2. L’ensemble de ces travaux ont été effectués par
Jones et al. (5) et Vailati et al. (6).
Les sous-types de récepteurs ont une localisation pré- et post-
synaptique dans le système nerveux (7). Il est possible que
les récepteurs nicotiniques, dans les mêmes régions céré-
brales, puissent être localisés sur différents domaines du neu-
rone. Les connaissances actuelles de la distribution régionale
des sous-types de neurones, qui sont essentiellement fondées
sur les études d’hybridation in situ, sont encore insuffisantes
pour définir les circuits neuronaux dans lesquels les récep-
teurs nicotiniques sont impliqués, et une immunolocalisation
plus précise des différentes sous-unités est nécessaire. Il
convient aussi d’étudier la localisation des sous-unités d’une
manière plus critique, parce qu’il devient évident qu’elle varie
dans le cerveau de différentes espèces animales ; par exemple,
il n’y a pas de sous-unité α8 dans le cerveau humain, et
les sous unités α3 et α5 sont différemment exprimées et
localisées dans le cerveau des rongeurs et dans le cerveau
humain (8).
Une autre source de perplexité est la distribution non neuro-
nale des récepteurs nicotiniques qui ont été trouvés dans
les kératinocytes, les cellules musculaires, les tissus
lymphoïdes et les cellules neurosécrétoires. Leur rôle dans
ces tissus n’a pas été élucidé, mais un grand nombre d’hypo-
thèses sont avancées quant à leur implication dans les
conditions pathologiques.
LES FONCTIONS DU RÉCEPTEUR NICOTINIQUE
Depuis les tout débuts de la pharmacologie, on sait que les
récepteurs nicotiniques jouent un rôle important dans la trans-
mission ganglionnaire et contrôlent les fonctions du système
nerveux autonome (9), mais leur rôle au niveau cérébral reste
encore mal connu. On sait que les récepteurs nicotiniques sont
impliqués dans des fonctions cognitives complexes et variées
telles que l’attention, l’apprentissage, la consolidation de la
mémoire, l’éveil, la perception sensorielle, mais aussi le
contrôle de l’activité locomotrice, celui de la perception de la
douleur ainsi que celui de la température corporelle (4).
La plupart des données obtenues proviennent d’études com-
portementales réalisées en utilisant la nicotine et des antago-
nistes des récepteurs nicotiniques aussi bien chez l’homme que
chez l’animal, mais aussi des modèles pathologiques mettant
en évidence une “dénervation” nicotinique, c’est-à-dire les
pathologies dégénératives.
On pense généralement que la majorité de ces effets sont dus aux
récepteurs nicotiniques présynaptiques, qui modulent la libéra-
tion d’un grand nombre de neurotransmetteurs (voir ci-dessus).
Cependant, les récepteurs postsynaptiques jouent aussi des rôles
importants, celui le plus clairement démontré étant le contrôle
de la transmission ganglionnaire et de la transmission choliner-
gique rapide dans l’hippocampe et le cortex sensitif.
Les données expérimentales indiquent que différents sous-types de
récepteurs nicotiniques sont impliqués dans les diverses fonctions
précédemment décrites. La transmission ganglionnaire est essen-
tiellement régulée par le sous-type α3 (α5) - β4, et la délétion
génique de α3 et β2 induit un phénotype corrélé à une diminution
de la transmission ganglionnaire. Le contrôle de la douleur est essen-
tiellement exercé grâce aux sous-types α4-β2 (10). La libération
de la dopamine, à partir des neurones dopaminergiques, est par-
tiellement contrôlée par un sous-type qui contient la sous-unité α4
(mais possiblement aussi la sous-unité α6) (7), alors que la libéra-
tion de glutamate est sous la dépendance du sous-type α7 (11).
Le sous-type β2 chez les souris est important quant au contrôle
de la libération présynaptique du GABA (12) et la réponse à la
nicotine des neurones dopaminergiques mésencéphaliques. Le
sous-type β3 peut contrôler l’activité motrice par le biais de la
libération de dopamine dans le striatum et dans d’autres aires
du système nerveux central (SNC) dans lesquelles les récep-
teurs contenant la sous-unité β3 sont exprimés aux niveaux pré-
synaptiques ou préterminaux des neurones.
Les récepteurs nicotiniques semblent être aussi impliqués dans
la survie neuronale. Ainsi, des souris âgées dont on a enlevé par
sélection génétique les sous-unités β2 (souris knocked out β2)
montrent une hypotrophie du néocortex, une perte des neurones
de l’hippocampe et une astro- et microgliose (cela ressemble à
une maladie neurodégénérative). Le corrélat fonctionnel de ces
altérations histopathologiques est le fait que les animaux perdent
l’apprentissage spatial. Ces observations semblent bien corrélées
aux données épidémiologiques montrant que la stimulation chro-
nique des récepteurs nicotiniques par l’utilisation du tabac
entraîne une protection dans le développement de la maladie de
Parkinson (13). D’autre part, des études in vitro ont montré que
l’exposition à la nicotine protège les neurones en culture de la
neurotoxicité induite par différents agents. Une participation plus
générale des récepteurs nicotiniques dans le développement céré-
bral est probable, parce qu’ils sont exprimés très tôt lors de la vie
fœtale (14), et leur implication dans la pousse axonale (15) sug-
gère qu’ils pourraient être impliqués dans la mise en forme et la
maintenance de l’intégrité du circuit neuronal. La confirmation
du rôle central des récepteurs nicotiniques dans la physiologie
cérébrale est due au fait que l’expression des différentes sous-
unités est régulée pendant le développement (figure 2).
RÉCEPTEURS NICOTINIQUES ET PATHOLOGIE
Il existe désormais beaucoup d’études, aussi bien autoradio-
graphiques que histochimiques dans des tissus d’autopsie (16),
ainsi que des images radiographiques de patients, qui montrent
que la perte des récepteurs nicotiniques est corrélée à la sévé-
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
117
PHARMACOLOGIE

rité de la maladie d’Alzheimer (17). Par ailleurs, des études
récentes montrent que les sous-types de récepteurs nicotiniques
peuvent être impliqués dans certaines autres maladies. Par
exemple, l’épilepsie frontale nocturne est due à une mutation
de la sous-unité αqui diminue la fonction du sous-type de
récepteurs α4-β2 (18), et la diminution du seuil de sensation
chez les schizophrènes semble être corrélée à une expression
anormale de la sous-unité α7 (19). Chez les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer, ce sont les sous-unités α4 qui sem-
blent être les plus affectées, alors que le nombre de récepteurs
contenant la sous-unité α3 paraît inchangé ; quant aux récep-
teurs possédant une sous-unité α7, il n’est pas clair s’il existe
ou non une diminution de leur nombre (20).
Une étude récente donne une autre dimension à l’importance des
récepteurs nicotiniques. En effet, il a été montré que, chez le rat,
le peptide β-amyloïde (1-42) module directement les récepteurs
nicotiniques (21). Les auteurs ont trouvé que ce peptide β-amy-
loïde inhibe les cellules entières aussi bien que les courants des
récepteurs nicotiniques des interneurones hippocampiques en
bloquant les canaux ioniques des récepteurs nicotiniques à des
concentrations extrêmement basses (100 nM). Cette inhibition
semble spécifique pour la séquence peptidique, et son amplitude
dépend du sous-type de récepteur exprimé. Ainsi, l’inhibition
chronique de ces récepteurs par le peptide β-amyloïde pourrait
expliquer les déficits cognitifs de la maladie d’Alzheimer.
Un autre aspect important au plan physiopathologique est la
dépendance induite par la nicotine, sachant qu’il existe des
récepteurs nicotiniques au niveau des terminaisons présynap-
tiques des neurones dopaminergiques dans le nucleus accum-
bens ; on peut penser qu’il y a, comme avec les autres sub-
stances addictives, une relation très forte avec le
neurotransmetteur du “plaisir” qu’est la dopamine.
MODULATION DE L’ACTIVITÉ DES SOUS-TYPES
DE RÉCEPTEURS α7 PAR LES LIGANDS ALLOSTÉRIQUES
L’activité de beaucoup de récepteurs canaux tels que les récep-
teurs nicotiniques est sujette à la modulation par des ligands
autres que l’agoniste naturel. Deux exemples sont bien connus :
c’est la modulation du récepteur glutamatergique NMDA par
la glycine (22) et celle du récepteur GABA A par les benzo-
diazépines et les stéroïdes (23). L’existence d’un tel site de
modulation allostérique a récemment été mise en évidence sur
les récepteurs nicotiniques de sous-type α7 (figure 8).
Des molécules telles que la galantamine, la physostigmine et
la codéïne peuvent faciliter l’action de l’acétylcholine sur les
récepteurs nicotiniques. Cette modulation permet à chaque
molécule d’acétylcholine d’avoir une meilleure fixation sur les
sous-unités αdu récepteur nicotinique, et facilite aussi la libé-
ration d’acétylcholine (quand le récepteur stimulé est présy-
naptique). Du fait que les récepteurs nicotiniques sont aussi
présents sur les terminaisons présynaptiques de plusieurs autres
neurotransmetteurs, cette action modulatrice induite par la
galantamine (ou les autres modulateurs) entraîne la libération
des autres neurotransmetteurs.
Comme il a été vu précédemment, un des déficits choliner-
giques les plus importants dans la maladie d’Alzheimer
consiste en la diminution du nombre de récepteurs nicotiniques
dans l’hippocampe et dans le cortex. Ce déficit est le résultat
d’une diminution de la sensibilité de ces récepteurs pour l’acé-
tylcholine, qui, de ce fait, altère non seulement la dépolarisa-
tion postsynaptique, mais aussi la libération présynaptique
d’acétylcholine ainsi que l’entrée du Na+dans les cellules. À
l’heure actuelle, l’approche la plus habituelle pour traiter le
déficit cholinergique dans la maladie d’Alzheimer est l’utili-
sation des inhibiteurs des cholinestérases, qui diminuent la
métabolisation de l’acétylcholine dans les synapses. De ce fait,
un plus grand nombre de récepteurs muscariniques et nicoti-
niques peuvent être activés. Un des modulateurs allostériques
du récepteur nicotinique est la galantamine ; cette action de la
galantamine est du même type que celle des benzodiazépines
sur les récepteurs GABA A en termes de modulation allosté-
rique, mais pas, bien sûr, en termes d’activité pharmacolo-
gique. L’action de la galantamine sur les récepteurs nicoti-
niques humains a été mise en évidence dans les études
électrophysiologiques utilisant des couches minces de cerveau
humain (2). Les trois sous-types de récepteurs nicotiniques
humains sont sensibles à l’activité de la galantamine, mais sur-
tout les sous-types α7 et α4.
118
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
PHARMACOLOGIE
Figure 8. Représentation schématique du récepteur nicotinique AC
(acétylcholine), AL (anesthésiques locaux), stéroïdes, AAr (acide
arachidonique).
 6
6
1
/
6
100%