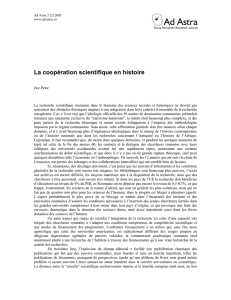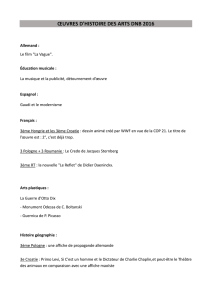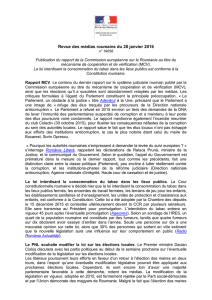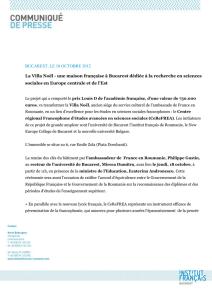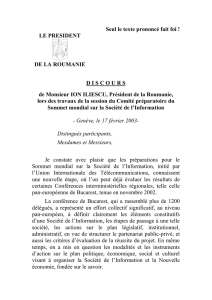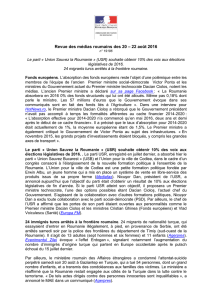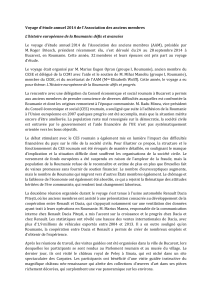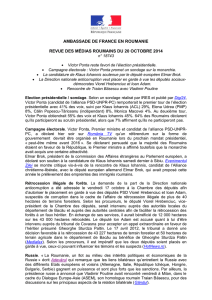Traian SANDU Les Roumains dans l`entre-deux

Traian SANDU
Les Roumains dans l’entre-deux-guerres
La modernisation contrariée
Dans les actes du colloque L’Europe centrale du traité de paix de Saint-Germain-en-Laye à la
Deuxième Guerre mondiale du 21 mai 2005, organisé par la Ville de Saint-Germain et les
Amis du Vieux Saint-Germain.
Avant d’évoquer l’histoire d’un pays, donc de jouer au chroniqueur averti, il faut
s’interroger sur notre propre approche des événements du passé, donc sur l’historiographie.
En France, la Roumanie apparaît comme un espace privilégié en raison de l’influence
politique et culturelle exercée à l’époque de Napoléon III, puis dans l’entre-deux-guerres et
même à l’époque de De Gaulle. Ces fameuses affinités fondées aussi sur la latinité de la
langue roumaine, ont façonné une certaine sympathie qui se ressentit sur la manière d’écrire
l’histoire.
Trois manières d’aborder le passé ont dominé successivement l’historiographie
roumaine et française :
- la 1ère exalte les hauts-faits nationaux, donc privilégie les événements politiques
et militaires, de préférence valorisants, même si les moments de malheur peuvent aussi
renforcer la cohésion nationale et déculpabiliser l’opinion des mauvais choix effectués par les
dirigeants. Cette approche nationaliste insiste sur la particularisme défensif de la Roumanie
(îlot de latinité et bouclier de la Chrétienté contre les invasions, alors qu’en réalité cette
latinité ne s’est dégagée qu’au début du XIXe avec la fixation des langues nationales dans
cette région et que les pays roumains ont surtout tenté de préserver un peu d’autonomie en
entrant dans les clientèles des puissances environnantes – les mêmes discours se retrouvent
chez les autres nations).
Cela n’empêche que ce retournement « héroïsant » de l’adaptabilité culturelle et de
l’opportunisme international domine l’historiographie roumaine et française, aussi bien au
XIXe après la réunification des provinces de Valachie et de Moldavie (carte n°1) entre 1859 et
1866 et l’obtention de l’indépendance par rapport au suzerain ottoman au Congrès de Berlin
en 1878 et 1881, qu’au XXe après l’annexion de la Bessarabie et de la Transylvanie, ou dans
les années 1960, 70 et 80, où le national communiste Ceausescu tentait de se donner une
légitimité autre que le coup de force soviétique et l’assise ouvriériste fort maigre encore dans
la Roumanie rurale de l’immédiat après-guerre.
- la deuxième tendance historiographique prend le contre-pied de la première en
comparant la Roumanie aux autres pays, ce qui fait ressortir les retards structurels, en
matière de développement économique (industrialisation, puis tertiarisation de la production),
d’équilibres sociaux (passage tardif des ordres féodaux des boyards à la société de classes
d’une bourgeoisie tardive), de culture politique moderne (absence démocratie, clientélisme).
Cette tendance critique s’est surtout développée lors de la dérive totalitaire de Ceausescu des
années 80.
- la troisième tendance se développe après 1989, comme un prolongement européiste
de la première tendance nationaliste et promue souvent par les mêmes historiens reconvertis :
elle insiste sur l’apport de la Roumanie à la civilisation du continent, voire de l’humanité,
pour justifier les intégrations euratlantiques aux nouvelles puissances dominantes.
Alors quel angle d’attaque adopter face à cette « offre » historiographique divergente ?
Le choix que j’opère consiste à articuler les deux premières approches, en évitant les
défauts de chacune d’entre elles : aux périodes de crise politique, notamment autour des deux

guerres mondiales et de leurs conséquences, il faut appliquer un traitement traditionnel,
événementiel, aux périodes de relative stabilité, s’interroger sur les tentatives de rattrapage.
Je n’oublierai néanmoins pas le titre initial de mon intervention, qui met la
modernisation du pays au centre des préoccupations de ses dirigeants. En effet, les périodes
de crise sont suivies de bouleversements globaux qui provoquent des réformes, voire des
révolutions d’ensemble que le regard englobant du géopoliticien ne peut ignorer. Ainsi, les
trois grandes périodes du XXe débutent par des crises (1916-1919 ; 1940-1947, 1989) qui
débouchent toutes sur de longues phases de modernisation spécifique, souvent impulsées par
la puissance dominante dans la région centre-européenne. La notion de modernité pose en
effet problème non seulement par son caractère importé – renvoyant à un modèle dominant
exogène -, mais également par la voie que la Roumanie, comme d’autres petits et moyens
pays de la région, emprunte pour atteindre cet objectif.
Considérant la période 1916 – 1940, qui correspond à l’extension territoriale
maximale (cf. carte n°1), la question porte sur la capacité à répondre au double défi lancé
dans toute l’Europe : la démocratisation exigée par les sacrifices des tranchées et le
décollage économique grâce aux ressources naturelles – céréales et pétrole – le tout dans un
contexte international délicat d’irrédentisme sur quasiment toutes ses frontières, et
notamment sur sa frontière orientale face à la puissance soviétique.
I/ La position internationale de la Roumanie.
Une des controverses historiques assez vaines liées à l’inscription de la Roumanie
dans le Premier conflit mondial porte sur son statut d’allié, qui lui a permis de figurer parmi
les grands bénéficiaires de l’ordre de Versailles.
En effet, la Roumanie n’est entrée en guerre qu’en août 1916, pour appuyer le flanc
sud de l’offensive Broussilov de juin, et contre des promesses territoriales très étendues au
détriment de l’Autriche-Hongrie. Sa rapide défaite suivie de l’occupation d’une grande partie
du territoire est autant due à l’ampleur de la contre-offensive des Centraux (ce qui a
effectivement soulagé Verdun) qu’au choix de Bucarest de s’emparer en priorité de la
Transylvanie, au lieu de s’attaquer plus sérieusement à la Bulgarie comme convenu avec
l’Entente, afin de tenter la jonction avec l’Armée de Salonique de Sarrail et d’obtenir le
matériel qui lui fit cruellement défaut.
L’année 1917 correspond d’abord aux combats d’arrêt de l’été sur les cols des
Carpates – transformés par l’historiographie roumaine en moments de gloire militaire
nationale, en sachant toutefois que la capacité retrouvée était largement due à la
réorganisation de l’armée par la mission du général français Berthelot – ainsi qu’à
l’écroulement du front oriental après la révolution d’octobre, qui aboutissent en mai 1918 à la
paix séparée de Bucarest, parallèle à celle de Brest-Litovsk.
C’est dans ce contexte qu’intervient paradoxalement le premier agrandissement
territorial par l’annexion de la Bessarabie, province russe à majorité roumanophone, où les
Moldaves l’emportent sur les russophones et sur les Ukrainiens et font appel aux troupes
roumaines en janvier 1918 : ni les Centraux, ni l’Entente n’ont intérêt à contrarier l’opération,
sans toutefois la reconnaître officiellement encore, donc l’union à la Roumanie est proclamée
le 9 avril 1918.
Le basculement de la Roumanie du côté de l’Entente s’effectue grâce à la propagande
des ententistes roumains, notamment à Paris (Conseil national de l’Unité roumaine) et en
Transylvanie, où les Roumains s’organisent dans le Conseil national roumain et participent au
démantèlement de l’Autriche-Hongrie (octobre-novembre 1918). La Roumanie rentre donc en
guerre le 10 novembre et ses troupes pénètrent en Transylvanie.

A la Conférence de la Paix, la France apparut comme le principal arbitre des questions
continentales. Clemenceau accepta de recevoir les revendications roumaines, eu égard à
l'application du principe des nationalités, à la présence de troupes roumaines en Bucovine et
en Transylvanie qu'elle convoitait, ainsi qu'en Bessarabie, et surtout à l'appui que cette armée
pouvait apporter à la France en Russie du sud contre les Soviets. En effet, dans le dispositif
français de revers en gestation, la Roumanie tenait, aux côtés de la Pologne, un rôle dans le
"cordon sanitaire" anti-bolchevik de Foch au cas où la Russie aurait tenté de faire sa jonction
avec l'Allemagne. Les délégués français soutinrent donc globalement les revendications
roumaines, sauf sur le Banat occidental, qui revint aux Serbes.
En réalité, la Roumanie fut d’un faible secours à la France dans son intervention dans
la guerre civile russe, puisque Bucarest, comme Varsovie, avait plutôt intérêt à la victoire des
Bolcheviks prêts à lâcher les marges de l’Empire plutôt qu’à un retour des Russes blancs. Elle
éluda donc un appui aux Blancs durant toute l’année 1919, qu’elle passa à combattre les
bolcheviks hongrois et à occuper Budapest plutôt que d’obéir aux injonctions françaises
d’intervention en Russie et de commandement unifié en Orient sous autorité française.
La Hongrie ne représentait en effet pas un danger pour la France, qui aurait souhaité
son intégration économique dans l'ensemble danubien, d'autant que ses dirigeants, dans
l'espoir d'éviter son démantèlement, avaient promis au Quai d'Orsay de se ranger dans la
sphère d'influence française. La Pologne l'aurait également souhaité, par espoir d'appui anti-
bolchevik, notamment au moment du danger maximal lors de la guerre russo-polonaise, en
août 1920. Mais le prix révisionniste était trop cher à payer et le traité de paix fut signé à
Trianon en juin 1920.
Toutefois, les rumeurs de ces négociations suffirent à inquiéter les petits vainqueurs
danubiens, qui amorcèrent leur union dès août 1920 au sein de la "Petite Entente" - trilatérale
Roumanie-Tchécoslovaquie-Yougoslavie. A partir de juin 1921, la France se rallie clairement
au système centre-européen restreint que représente la Petite Entente.
En somme, au printemps 1921, la France avait stabilisé sa politique centre-européenne
autour de la Pologne et de la Petite Entente, deux entités faiblement articulées par la
Roumanie, mais sérieusement divisées par le contentieux polono-tchèque.
La suite de l’évolution de la Roumanie sur l’échiquier européen démontra son faible
intérêt pour la France, notamment lors de la crise de la Ruhr de 1923, véritable mise à
l'épreuve de la solidité du lien franco-centre-européen. En effet, dès Gênes, les petits alliés
d'Europe centrale se préoccupaient de la mésentente croissante entre la France et l'Angleterre.
Ils craignaient que l'appui anti-allemand et anti-soviétique de la France fût insuffisant, en
raison de l'absence de l'unité de front avec la Grande-Bretagne, qui était favorable à une
politique conciliante envers les puissances vaincues ou marginalisées. Poincaré comprit alors
l’insuffisance du système centre-européen et se dirigea, dans les derniers mois de son mandat,
vers un rapprochement avec les Anglo-Américains et des tâtonnements avec l’Union
Soviétique, annonçant ainsi dès le début de 1924 la politique de Herriot de reconnaissance de
l’URSS et la politique de Briand de Locarno de rapprochement avec l’Allemagne sous égide
britannique. Dès lors, le traité franco-roumain de juin 1926, comme les autres traités que la
diplomatie de Briand signa avec les PECO, n’avait plus de réelle portée sécuritaire pour la
France, sauf de tenir en échec l’offensive de la modeste puissance de l’Italie mussolinienne, et
ce jusqu’en 1932-1933, lorsque ces alliances seront réactivées dans un autre but, à savoir
servir de pont stratégique à l’armée rouge dans un éventuel encerclement de l’Allemagne.
Au début de l'arrivée au pouvoir d'Hitler la France et l'Italie essayèrent de s'entendre
pour brider l'expansionnisme allemand vers l'est. Mussolini craignait qu'Hitler n'annexât

l'Autriche -limitrophe de l'Italie- et ne menaçât l'expansionnisme italien en Europe centrale. Il
prit l'initiative d'un "directoire à quatre" des grandes puissances européennes -France,
Allemagne, Italie et Angleterre. Son projet prévoyait des révisions territoriales en faveur de
ses clients centre-européens, l'Autriche et la Hongrie.
Mais au Quai d'Orsay, de nombreux fonctionnaires restaient attachés aux alliances
centre-européennes, au statu quo territorial et à la défense de la SDN, dont le projet
mussolinien rognait les prérogatives. Surtout, la Petite Entente et la Pologne réagirent
violemment: dès février 1933, la Petite Entente avait renforcé son unité et avait déclaré qu'elle
interdisait aux grandes puissances de disposer du territoire des petites sans leur consentement;
le Ministre des Affaires étrangères polonais, le colonel Joseph Beck, menaça même de se
rapprocher de l'Allemagne en cas de succès du Pacte à Quatre.
La France céda donc, et le texte finalement paraphé en juin 1933 confirmait l'autorité
de la SDN en matière de révision; la Petite Entente et la Pologne avaient ainsi ramené la
France à sa politique de revers traditionnelle. Mais pour assurer son efficacité, il fallait
renforcer le lien soviétique.
Les Etats limitrophes de l'Union Soviétique comprennent la nécessité de s'en
rapprocher: le Roumain Titulescu devient un chaud partisan de l'intégration de son pays à un
système franco-russe, qui aurait permis une pression conjointe sur l'Allemagne. Mais c'est de
Pologne que vinrent les premiers craquements: elle tenta de pratiquer une politique autonome
d'équilibre entre l'Union Soviétique et l'Allemagne; elle conclut donc également un pacte de
non-agression avec l'Allemagne en janvier 1934. La France ressentit mal ce geste, dont elle
n'avait pas été prévenue, même si Beck se voulait rassurant sur l'avenir des relations franco-
polonaises.
La réaction française fut menée par Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères à
partir de février 1934. Ce patriote est bien décidé de contrer l'Allemagne, quitte à nouer une
alliance avec l'Union Soviétique. Dans cette optique, l'Europe centrale est utile, mais
insuffisante: il faut l'ancrer de nouveau fermement à la France, ne serait-ce que pour fournir
un pont à d'éventuels mouvements de troupes soviétiques vers l'Allemagne. Pour cela,
Barthou entreprend "la tournée des petits alliés" en avril, puis en juin 1934; à Bucarest, il
assista avec satisfaction à la Conférence des ministres des Affaires étrangères de la Petite
Entente, car la Roumanie et la Tchécoslovaquie venaient de reconnaître l'Union Soviétique
quelques jours auparavant.
Barthou négociait en même temps un pacte oriental avec l'Union Soviétique, la
Pologne et l'Allemagne. Comme prévu, les deux dernières refusèrent d'y adhérer en septembre
1934: l'Allemagne ne pouvait accepter une politique qui l'annihilait, notamment en Europe
centrale; la Pologne refusait de choisir entre Allemagne et Union Soviétique, et craignait le
passage des troupes soviétiques sur son territoire.
Mais l'assassinat de Barthou et du roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille, le 9
octobre 1934, par des terroristes croates, sonne le glas d'une politique extérieure ferme fondée
sur des alliances de revers, même si l'Europe centrale n'en représente plus l'élément essentiel.
Pierre Laval, le successeur pendant quinze mois de Barthou, est un pacifiste de vieille
date, qui tient à éviter de provoquer l'Allemagne par un rapprochement trop marqué de
l'Union Soviétique. C'est ainsi qu'il tenta d'abord de renouer avec l'Italie, malgré la
Yougoslavie, pour contenir l'Allemagne. Lors de son voyage à Rome de janvier 1935, Laval
et Mussolini furent d'accord pour maintenir l'indépendance de l'Autriche et pour reconcilier
leurs clients centre-européens, mais la France recula lorsque Mussolini, par la suite, voulut en
obtenir un ferme traité d'alliance.
La politique soviétique fut grevée par la Pologne: Laval enleva du projet de traité de
Barthou l'automaticité de l'assistance militaire franco-soviétique. Le traité signé en mai 1935

n'inspire alors plus une grande confiance à Moscou, même s’il est complété le même mois par
un traité tchéco-soviétique destiné à assurer le passage des troupes soviétiques : celui-ci n’est
toutefois possible que si la Pologne ou la Roumanie autorisent ce passage : comme Varsovie
s’y refuse absolument, c’est Bucarest qui entame, sans grand enthousiasme, des négociations
en ce sens.
Laval n'est donc pas parvenu à définir une politique centre-européenne française.
Ainsi, Hitler put facilement éclater le lien entre la France et l'Europe centrale en
remilitarisant la Rhénanie, en mars 1936. En effet, le secours que la France pouvait apporter à
l'Europe centrale dépendait de sa capacité à franchir en toute sécurité le Rhin, démilitarisé en
Allemagne par le traité de Versailles. Or, entre 1930 et 1934, la France se dote de la ligne
Maginot, barrière défensive qui contredit le principe diplomatique d'alliance de revers, fondé
sur l'intervention conjointe en Allemagne. Et lorsque Hitler occupe militairement la Rhénanie
sans rencontrer de véritable résistance française, les pays d'Europe centrale comprennent
l'ampleur du fossé stratégique qui s'est creusé entre la France et eux. Titulescu, partisan du
traité roumano-soviétique permettant le passage de l’armée rouge, est limogé en août.
L'Allemagne possédait un autre atout en Europe centrale: la pénétration commerciale.
Mais la Roumanie ne céda que très difficilement à Hitler son atout pétrolier, ne faisant que
des concessions au goutte à goutte jusqu’en mai 1940, lorsque la défaite de la France et
l’imminence de l’application du pacte Molotov-Ribbentrop à la Roumanie l’obligèrent à
choisir le camp allemand, ce qui ne lui épargna pas la débâcle territoriale.
Voilà donc pour la situation internationale de la Roumanie entre les deux guerres.
J’aborde maintenant le second aspect de cette période, qui relève de la modernisation
des structures du pays.
II - Une modernité imposée par la guerre
Une fois les crises militaires ouvertes passées, ce pays devient un laboratoire des
idéologies et des pratiques politiques nouvelles. Ainsi, la société traditionnelle encore
puissante, en retard de plus d'un demi-siècle sur les évolutions occidentales, peut-elle résister
à la question des minorités générée par les annexions, à une démocratisation brutale qui donne
le suffrage universel aux masses paysannes, à l'industrialisation, au socialisme encouragé par
la proximité offensive de la Russie des Soviets ?
La première dimension de l’étude présente le choc d’une guerre longue et dévastatrice
sur des structures socio-politiques traditionnelles : l’irruption du facteur populaire souligne le
rôle de la guerre comme source de démocratisation et génère des bouleversements nationaux,
sociaux et politique. La réaction des sociétés fut brutale : si la tentation communiste se révéla
forte aux deux extrémités de la période, ce fut l’élaboration d’un fascisme sui generis, pseudo-
religieux et pseudo-agraire, qui marqua un espace où les dictatures traditionnelles, revigorées
par un vernis fascisant, finirent malgré tout par s’imposer à une société civile encore rurale et
soumise à l’État et à ses attributs d’ordre -monarchie, Églises et armée.
A/ La guerre, source imparfaite de démocratisation
1/le choc de la guerre : la fin des sociétés traditionnelles
Le recensement roumain de 1930 livre des proportions d’environ 80% de ruraux,
malgré l’annexion des régions occidentales issues du démembrement de l’Autriche-Hongrie,
plus modernes, mais équilibrées par l’annexion de la Bessarabie russe à dominante agricole.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%