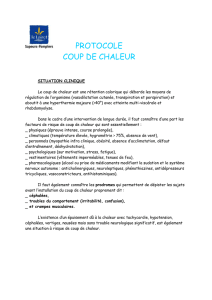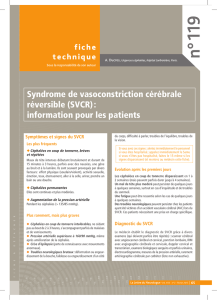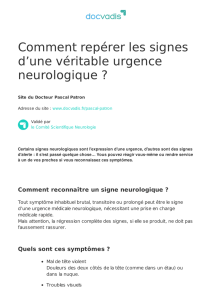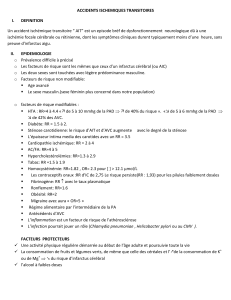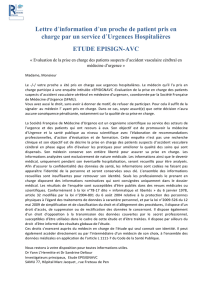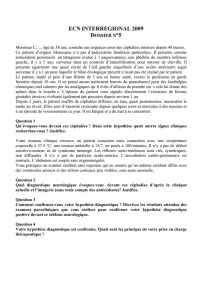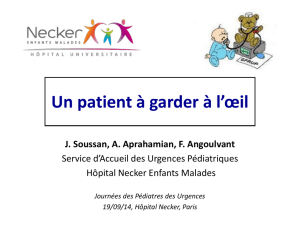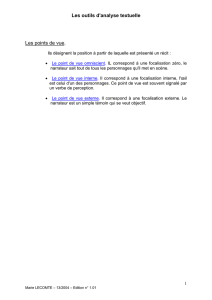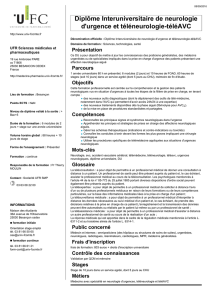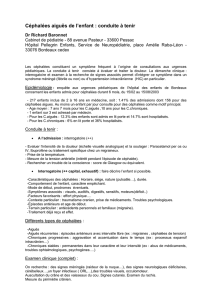LES URGENCES NEUROLOGIQUES

J. Neuroradiol.
, 2004,
31
, 244-251
© Masson, Paris, 2004
Monographie
LES URGENCES NEUROLOGIQUES
C. LUCAS
(1)
, J.-P. PRUVO
(2)
, P. VERMERSCH
(1)
, B. PERTUZON
(2)
, L. DEFEBVRE
(1)
, X. LECLERC
(2)
,
D. LEYS
(1)
(1) Clinique Neurologique,
(2) Service de Neuroradiologie, Hôpital Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.
R
ÉSUMÉ
Les urgences neurologiques constituent une activité conséquente dans les services d’accueil des centres hospitaliers. Les
pathologies rencontrées sont très diverses et sont susceptibles d’entraîner une morbi-mortalité non négligeable si la prise
en charge médicale n’est pas optimale dès les premières heures. Nous détaillerons dans cet article les urgences neurologiques
les plus fréquemment rencontrées et où le recours aux examens neuroradiologiques est souvent demandé, tels les accidents
vasculaires cérébraux, les pertes de connaissance, les crises convulsives, les céphalées, les états confusionnels, les troubles
de vigilance, le syndrome méningé et la paralysie faciale. Nous n’avons pas traité le syndrome médullaire aigu (exclus de
cet ouvrage) et les troubles aigus visuels (traités dans un autre chapitre).
Mots-clés :
urgences, neurologie, accident vasculaire cérébral, épilepsie, céphalées.
S
UMMARY
Neuroimaging emergencies
Neurological symptoms are a very frequent cause of consultation in emergency units and require consultation with neuro-
logists and neuroradiologists. The most frequent diagnoses are stroke syndrome, seizure, headache, confusion, meningitis and
meningo-encephalitis, and facial palsy. The morbidity and mortality of neurological emergencies are strongly related to prompt
medical management of the patients which often requires neuroimaging studies. The most common neurological emergencies
will be reviewed.
Key words:
emergency, neurological, stroke, headache, seizure.
Les urgences neurologiques sont très fréquentes
dans l’activité hospitalière avec 518 interventions
(médiane à 17/j, extrêmes : 8-37) sur un mois aux
urgences médicales du CHRU de Lille [4]. Moulin
et al.
[6, 7] avait évalué à 1 679 interventions sur
11 421 entrants (14,7 %) l’activité annuelle neurolo-
gique aux urgences du CHRU de Besançon. La
diversité des pathologies rencontrées avec une
implication pronostique immédiate nécessite une
expertise, donc une participation « séniorisée » pour
la prise en charge des patients dès l’urgence avec
implication forte du plateau technique et notam-
ment neuroradiologique.
Nous détaillerons ci-dessous par ordre de fré-
quence les principales urgences neurologiques ren-
contrées en pratique quotidienne (à l’exclusion du
syndrome médullaire aigu), et notamment celles où
un avis neuroradiologique peut être sollicité, parfois
de façon abusive.
ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX
(AVC)
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’affec-
tion neurologique la plus fréquente en hospitalisa-
tion [3, 10] et une grande urgence médicale.
L’hospitalisation rapide dans une structure adaptée
constitue un facteur essentiel du pronostic.
Les AVC se répartissent en 2 types : 80 % sont
ischémiques, 20 % hémorragiques.
Identifier l’AVC
C’est principalement l’interrogatoire du patient,
de son entourage, ou des deux qui suggère la nature
vasculaire du tableau neurologique [12]. La nature
vasculaire d’un déficit neurologique est quasi cer-
taine lorsque 4 critères cliniques sont réunis : installa-
tion brutale, caractère focal du déficit neurologique :
les symptômes et les signes peuvent s’expliquer par
une seule lésion anatomique, caractère « défici-
taire » des symptômes (par exemple : hémiplégie,
aphasie, hémianopsie), et non pas « positif » (par
exemple : paresthésies, crise focale, scotome scin-
tillant), intensité d’emblée maximale. Si l’association
de ces 4 éléments cliniques est hautement évocatrice
d’un AVC, l’une ou l’autre de ces caractéristiques
peut manquer. Dans ces circonstances la plus grande
prudence s’impose avant de retenir un diagnostic
d’AVC, et l’imagerie joue un rôle encore plus crucial.
Les nuances cliniques n’ont pas de valeur indivi-
duelle et ne permettent pas de se dispenser d’une
imagerie.
Lorsque l’IRM encéphalique est disponible en
urgence, son utilisation est alors hautement souhai-
table. Dans l’ischémie cérébrale, en combinant
l’IRM de diffusion et de perfusion en phase précoce
de l’ischémie cérébrale, il est théoriquement possible
de séparer la zone supposée nécrosée détectée en
diffusion, de la zone hypoperfusée détectée en per-
fusion au sein d’une même région anatomique qui
Tirés à part :
C. L
UCAS
, à l’adresse ci-dessus.
e-mail : [email protected]
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 18/05/2010

LES URGENCES NEUROLOGIQUES
245
représente une véritable zone à risque, cible de toutes
les mesures thérapeutiques en phase aiguë. L’angio-
graphie par résonance magnétique (ARM) permet
d’identifier une éventuelle occlusion artérielle intra-
crânienne grâce aux séquences en « temps de vol ».
Dans l’hémorragie cérébrale, les séquences T2 écho
de gradient ont une bonne sensibilité pour détecter
les hémorragies. Lorsque l’IRM encéphalique n’est
pas disponible en urgence, le scanner sans injection
de produit de contraste est l’examen de première
intention pouvant être normal ou montrer des signes
précoces d’infarctus ou une hyperdensité spontanée
lors d’une hémorragie intra-parenchymateuse.
Déterminer la cause de l’AVC
Pour l’ischémie cérébrale, les principales causes
sont athéroscléreuse, cardioembolique, « lacunaire »
(fibrohyalinose des artères perforantes), puis les
autres causes définies (dissections artérielles cervi-
cales, angeïtes…), enfin les causes inconnues (sou-
vent chez le sujet jeune).
Dans une hémorragie lobaire, les 3 hypothèses
diagnostiques principales sont la rupture d’une mal-
formation vasculaire anévrysmale ou angiomateuse,
une thrombose veineuse cérébrale ou une angio-
pathie amyloïde. Elles justifient une exploration
angiographique (conventionnelle ou par résonance
magnétique) dans les premières heures ou une IRM
selon l’orientation clinique.
Dans une hémorragie cérébrale profonde chez un
sujet non hypertendu, ou chez un sujet jeune, ou en
cas de récidive une IRM s’impose à la recherche
d’une lésion focale à l’origine de l’hémorragie
(cavernome, angiome, tumeur…).
« MALAISES », PERTES DE CONNAISSANCE
ET CRISES CONVULSIVES [8]
La première étape diagnostique consiste à déter-
miner s’il y a eu perte de connaissance ou non. En
cas de perte de connaissance, on détermine la durée
de celle-ci.
« Malaise » et lipothymie
Le « malaise » est un épisode aigu, régressif,
caractérisé par un trouble de conscience ou de vigi-
lance (perte de connaissance brève ou lipothymie)
avec ou sans hypotonie, qui peut être responsable
de chute. Parmi les malaises, on distingue la lipo-
thymie, qui se manifeste par une sensation de perte
de connaissance imminente à début et fin progres-
sifs. Une même affection peut se traduire soit par
une syncope, soit par une lipothymie selon l’impor-
tance et la durée de la baisse du débit sanguin céré-
bral. Une lipothymie est donc à prendre charge de
la même façon qu’une syncope.
Crise partielle simple
Certaines crises partielles simples, notamment
temporales, peuvent se traduire par un « malaise »
sans perte de connaissance.
Accident ischémique cérébral
Une ischémie dans le territoire vertébro-basilaire
peut également être responsable d’un « malaise »
avec vertige ou sensation vertigineuse, céphalées
postérieures, nausées, flou visuel ou diplopie.
Diagnostic différentiel du « malaise » :
l’ictus amnésique
La symptomatologie consiste en un oubli à mesure
isolé, conduisant le patient à poser les mêmes ques-
tions de façon itérative. Sont évocateurs du diagnos-
tic : le terrain (sujet âgé de plus de 50 ans), les facteurs
déclenchants (inconstants : variation importante de
température, effort physique intense, émotion), un
début brutal, une durée de quelques heures (6 heures
en moyenne, toujours inférieure à 24 heures). L’exa-
men clinique est normal en dehors de l’amnésie anté-
rograde. Il n’y pas de trouble de la vigilance. Une
anxiété est fréquemment retrouvée car le patient est
conscient de son trouble. Si la symptomatologie est
typique, on peut se passer d’examens complémentai-
res au moins dans le contexte de l’urgence.
Perte de connaissance
Elle est caractérisée par une suspension de la
conscience de durée brève (quelques secondes à
quelques minutes). L’incapacité à se souvenir et à
décrire ce qui s’est passé lors de tout ou partie de la
perte de connaissance est parfois difficile à mettre en
évidence, notamment en cas de trouble d’origine
psychiatrique.
Syncope
C’est une perte de connaissance brève (quelques
secondes à quelques minutes), de début et fin
brusques, associée à une chute (résolution brutale du
tonus musculaire) en rapport avec une diminution
soudaine du débit sanguin cérébral. Elle peut être
précédée d’une lipothymie. Lors de la perte de
connaissance le patient est pâle, son pouls est faible
voire imprenable, la pression artérielle est faible : il
s’agit d’un état de mort apparente. Le patient peut
perdre ses urines. Si la syncope est prolongée, des
mouvements convulsifs peuvent survenir (syncope
convulsive).
Traumatisme crânien
Un traumatisme crânien peut être responsable
d’une perte de connaissance. Si l’examen clinique
réalisé à l’entrée montre des signes de focalisation
neurologiques, on demandera un scanner cérébral
en urgence à la recherche d’un hématome sous-dural
ou extra-dural. En l’absence de signes de focalisa-
tion, il est indiqué d’hospitaliser le patient pour une
surveillance de 24 heures. On réalisera un scanner
cérébral en urgence si au cours de cette surveillance
apparaissent des signes de focalisation neuro-
logiques ou un trouble de la vigilance.
Accident vasculaire cérébral
Un accident ischémique transitoire ne peut être
rendu responsable d’une perte de connaissance si
elle est isolée.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 18/05/2010

246
C. LUCAS et al.
Crise généralisée ou crise partielle complexe
Toutes les crises d’épilepsie généralisées entraînent
une perte de connaissance à l’exception des crises
myocloniques qui sont trop brèves. Par définition,
les crises partielles complexes s’accompagnent d’une
rupture de contact.
Crise épileptique
Une crise épileptique est la manifestation clinique
de l’hyperactivité paroxystique d’un groupe de neu-
rones dont le corps cellulaire est situé dans le cortex
cérébral. Elle peut se traduire par des phénomènes
moteurs, sensitifs, sensoriels, végétatifs, psychiques
ou par une modification de l’état de vigilance, selon
la région corticale impliquée. On retiendra en faveur
du diagnostic de crises épileptiques : le caractère
paroxystique, une progression logique de la crise à
partir du premier signe (« signal symptôme »), à
forte valeur localisatrice, le caractère stéréotypé de
la sémiologie d’une crise à l’autre. La répétition de
crises épileptiques constitue une épilepsie. Les étio-
logies en sont d’une grande diversité. Devant des
crises partielles (secondairement généralisées ou
non), on évoque une cause localisée : processus
expansif, séquelle d’accident vasculaire cérébral,
lésion post-traumatique, abcès, séquelle d’encépha-
lite, dysplasie. Devant des crises généralisées on
évoque : une cause toxique (encéphalopathie alcoo-
lique, iatrogène…), une maladie métabolique, une
maladie neurodégénérative.
Classées en fonction de l’âge de début et de leur
caractère généralisé ou partiel, elles comportent
principalement, d’une part, les épilepsies générali-
sées idiopathiques : convulsions néonatales familia-
les bénignes, épilepsie myoclonique bénigne du
nourrisson, épilepsie-absence de l’enfant, épilepsie-
absence de l’adolescence, épilepsie myoclonique
juvénile, épilepsie avec crises tonico-cloniques du
réveil, épilepsies photosensibles et, d’autre part, les
épilepsies partielles idiopathiques : épilepsie par-
tielle bénigne à pointes centro-temporales (ou épi-
lepsie à paroxysmes rolandiques), épilepsie partielle
bénigne de l’enfant à paroxysmes occipitaux, épilep-
sie provoquée par la lecture.
Une IRM est toujours réalisée après une première
crise survenant chez un sujet âgé de plus de 20 ans.
Avant 20 ans, l’imagerie ne sera pas réalisée si on a
suffisamment d’arguments en faveur d’une cause idio-
pathique. La réalisation de l’imagerie sera accélérée
s’il existe un début focal à la crise ou si l’EEG montre
des signes de focalisation électriques. Un scanner
cérébral sans injection ou idéalement une IRM sera
demandé en urgence en présence de : fièvre (recher-
che d’abcès cérébral), signes de focalisation post-
critiques (recherche d’un processus expansif, d’un
accident vasculaire cérébral), traumatisme. On
demandera également une IRM en urgence en cas de
suspicion de thrombophlébite cérébrale.
LES CÉPHALÉES [5, 11]
Les céphalées sont un motif quotidien de consulta-
tion auprès du médecin urgentiste. L’essentiel est de
distinguer les céphalées primaires bénignes, les plus
fréquentes des céphalées symptomatiques d’une
affection organique et particulièrement neurologique.
L’interrogatoire est l’étape essentielle du diagnostic
afin de connaître le mode d’installation des cépha-
lées, son caractère habituel ou pas et leur profil évo-
lutif ce qui permet de distinguer les céphalées aiguës
brutales des céphalées chroniques paroxystiques et
des céphalées chroniques permanentes.
Cet interrogatoire est donc nécessairement long
mais c’est l’étape capitale du diagnostic qui va per-
mettre de distinguer les situations suivantes :
Céphalées aiguës brutales
C’est une urgence neurologique.
Hémorragie sous-arachnoïdienne
Céphalée d’installation brutale récente = suspi-
cion d’HSA ou d’hémorragie cérébro-méningée
(premier diagnostic à évoquer en terme de préva-
lence). La céphalée de l’hémorragie méningée est
décrite typiquement comme « un coup de tonnerre
dans le ciel serein » avec une céphalée très violente
à type de coup de poignard (souvent occipitale). En
cas d’hémorragie cérébro-méningée, il existera en
outre des signes de focalisation neurologique. La
suspicion de telles affections doit conduire à une
hospitalisation en extrême urgence pour réalisation
d’un scanner cérébral sans injection de produit de
contraste. À noter que le scanner cérébral est nor-
mal dans 5 % des hémorragies méningées à J0. Il
faut alors réaliser une ponction lombaire.
Thrombose veineuse cérébrale
Les céphalées sont le plus souvent progressives
avec possibles crises convulsives classiquement alter-
nantes (thrombose du sinus longitudinal supérieur)
puis signes de focalisation avec des troubles de la
vigilance de gravité variable qui sont liés à l’hyper-
tension intracrânienne du fait d’une stase veineuse
cérébrale avec possibilité d’infarctus veineux parfois
avec transformation hémorragique.
Les thromboses veineuses peuvent se révéler par
des céphalées aiguës évoquant l’épistaxis méningé.
L’absence de sang dans les espaces sous arachnoï-
diens au scanner puis à la ponction lombaire doit
faire évoquer ce diagnostic et faire réaliser une IRM.
Le traitement repose sur l’administration d’hépa-
rine à doses hypocoagulantes en urgence même s’il
existe des infarctus veineux hémorragiques en ima-
gerie et de la cause de la thrombose veineuse (si
contexte septique).
Encéphalopathie hypertensive
Cause rare de céphalée sévère récente et brutale.
L’encéphalopathie hypertensive s’accompagne fré-
quemment de troubles visuels bilatéraux et de crises
convulsives.
Dissection des artères cervicales
C’est la deuxième cause d’ischémie cérébrale chez
les patients jeunes avant 50 ans après les cardio-
pathies emboligènes. Des céphalées aiguës (et/ou de
cervicalgies) associées à des signes de focalisation
neurologique à début brutal chez un patient de
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 18/05/2010

LES URGENCES NEUROLOGIQUES
247
moins de 50 ans, sans cardiopathie, doit faire évo-
quer ce diagnostic et doit conduire à la réalisation
d’un scanner cérébral et d’un échodoppler cervical.
L’existence d’un syndrome de Claude Bernard
Horner douloureux est, jusqu’à preuve du contraire,
le témoin d’une dissection d’artère carotide interne.
L’existence d’une occipito-nuqualgie ou d’une cervi-
calgie associée à des signes de focalisation en fosse
postérieure est, jusqu’à preuve du contraire, liée à une
dissection d’artère vertébrale. Il s’agit de très grandes
urgences nécessitant un bilan neurovasculaire spécia-
lisé et la mise en route d’un traitement anti-thrombo-
tique (héparine en seringue autopulsée).
Céphalées post-traumatiques aiguës
Elles peuvent témoigner d’une hémorragie ménin-
gée, d’un hématome extra-dural ou sous-dural, d’une
contusion hémorragique cérébrale. La recherche de
signes de focalisation neurologique est impérative
ainsi que la prise en charge neurochirurgicale.
Céphalées par hypotension intra-crânienne
La fuite de LCR par un orifice dure-mèrien
(ponction lombaire ou à une brèche dure-mèrienne
post-traumatique) entraîne une hypotension du
liquide céphalorachidien avec des céphalées ayant
un net caractère postural. Les céphalées n’appa-
raissent qu’en orthostatisme et sont améliorées en
décubitus. Elles sont souvent sévères associées à des
nausées ou des vomissements. La station debout ou
assise prolongée est impossible.
Céphalées d’installation rapidement progressive
Avec signes d’hypertension intra-crânienne
Les céphalées peuvent être isolées. Elles sont
alors souvent à prédominance matinale ou en
seconde partie de nuit et sont aggravées par le décu-
bitus et les efforts. On peut également fréquemment
observer l’apparition d’une diplopie par paralysie du
VI. Elles peuvent être associées à un œdème papil-
laire visible au fond d’œil qui peut s’accentuer avec
diminution de l’acuité visuelle secondairement, et à
des troubles digestifs à type de nausées voire de
vomissements.
Le scanner cérébral est à réaliser en urgence à la
recherche d’un processus expansif (tumeur, abcès,
hématome sous dural chronique…). Si le scanner est
normal, il faut pratiquer une IRM cérébrale avec
séquence de flux veineux à la recherche d’une
thrombose veineuse cérébrale aseptique pouvant se
traduire uniquement par un tableau d’hypertension
intracrânienne. Si la neuro-imagerie est normale, il
faut alors effectuer une ponction lombaire avec prise
de pression du liquide céphalo-rachidien et égale-
ment cytologie du LCR pour éliminer les méningites
subaiguës et chroniques. Si la cytologie est normale
et si la pression du LCR est supérieure à 20 cm
d’eau, le diagnostic est alors celui d’une hyper-
tension intracrânienne dite « bénigne » (risque de
cécité bilatérale par névrite optique ischémique +++).
Avec fièvre et/ou syndrome méningé
Certaines méningites subaiguës ou chroniques ne
se traduisent pas par un syndrome méningé franc.
L’association céphalée + fièvre récente d’aggrava-
tion progressive, sans porte d’entrée infectieuse
évidente et avec imagerie cérébrale normale, doit
conduire à la réalisation d’une ponction lombaire.
Artérite temporale de Horton
Toute céphalée d’apparition récente chez un sujet
de plus de 60 ans doit faire évoquer l’artérite tempo-
rale de Horton qui s’accompagne d’une céphalée
dans 60 à 90 % des cas (il s’agit du symptôme le plus
fréquent).
ÉTATS CONFUSIONNELS ET TROUBLES
DE VIGILANCE [1]
La confusion est un syndrome révélant une souf-
france aiguë et diffuse du cerveau. Il existe toujours
une pathologie organique sous-jacente, à l’origine de
cette souffrance cérébrale. Les causes les plus fré-
quentes sont toxiques et métaboliques. Une atteinte
cérébrale focale, multifocale ou méningée peut éga-
lement être à l’origine d’un syndrome confusionnel.
La démarche diagnostique doit être systématique afin
de ne pas méconnaître la ou les causes à l’origine du
syndrome confusionnel. Le trouble de conscience se
rencontre dans le syndrome confusionnel et le coma.
Il en partage donc les étiologies.
Le début du syndrome confusionnel est habituel-
lement rapide, avec une évolution diurne fluctuante
et dont la durée est inférieure à 6 mois. Pour poser
un diagnostic de certitude, ces symptômes, qu’ils
soient légers ou marqués, doivent être présents dans
chacune des sections suivantes : altération de la
conscience et de l’attention, dans un continuum
allant de l’obnubilation au coma, perturbation glo-
bale de la cognition, troubles psychomoteurs
(
hypo
ou hyper activité, avec passage imprévisible de l’un
à l’autre), perturbation du cycle nycthéméral, troubles
émotionnels (par exemple humeur dépressive,
anxiété ou peur, irritabilité, euphorie, apathie ou
perplexité anxieuse).
Il faut pouvoir établir un diagnostic étiologique de
façon urgente, quand le diagnostic de syndrome
confusionnel est posé. L’enquête étiologique ne doit
toutefois pas retarder les premiers soins nécessaires à
un syndrome confusionnel. L’interrogatoire prend
toute son importance à ce moment du diagnostic.
L’examen clinique doit être minutieux et systéma-
tique portant sur tous les appareils. Ne doivent tout
particulièrement pas être oubliés : la présence d’un
fécalome par le toucher rectal, la présence d’un globe
vésical, l’examen de la cavité buccale.
Dès l’arrivée du patient, les examens suivants
sont réalisés à la recherche : trouble hydroélectro-
lytique (natrémie, hématocrite, protidémie, urée
et créatinine, calcémie, ionogramme urinaire),
trouble glycémique, osmolarité, gaz du sang, syn-
drome infectieux : (numération formule sanguine,
CRP), dysfonctionnement hépatique ou pancréa-
tique (ASAT et ALAT,
γ
GT, bilirubine libre et
conjuguée, ammoniémie amylasémie, lipas
émie),
dysfonctionnement cardiaque (électrocardiogramme),
toxique (HbCO, alcoolémie, benzodiazépines, barbi-
turiques, tricycliques dans le sang).
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 18/05/2010

248
C. LUCAS et al.
D’autres examens (radios de thorax, ASP, gaz du
sang, scanner cérébral…) pourront être demandés
en fonction du contexte clinique.
Chez le patient âgé ou dément, les signes de la
pathologie à l’origine du syndrome confusionnel
sont souvent frustres et le patient peut avoir du mal
à expliquer ces douleurs. Ces symptômes peuvent
s’exprimer alors par une rupture dans le comporte-
ment antérieur et notamment par une agitation, sans
réel point d’appel clinique. Il est alors recommandé
de réaliser systématiquement le bilan paraclinique
minimal
(tableau I
).
PARALYSIE FACIALE
Les principaux éléments permettant de différen-
cier une paralysie faciale périphérique d’un déficit
facial central sont détaillés dans le
tableau II
.
L’anamnèse est importante, en particulier il faut
définir le mode d’installation (rapide ou progressif)
et les circonstances de survenue (traumatisme, syn-
drome infectieux…).
L’examen clinique doit être systématique et ne
doit pas négliger les autres nerfs crâniens, les voies
longues, l’inspection de la conque de l’oreille, l’exa-
men du tympan à l’otoscope, la palpation de la
région parotidienne.
Les examens complémentaires sont utiles selon le
contexte : scanner du rocher et du conduit auditif
interne,
scanner, voire IRM cérébrale, et la ponction
lombaire sont discutés au cas par cas,
certains exa-
mens biologiques apparaissent très utiles comme la
numération formule sanguine, la VS ou la CRP, la
glycémie à jeun et post-prandiale, des sérologies
(VIH, Lyme, coxsackie, herpès, syphilis, CMV, listé-
riose…), le dosage de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine ainsi que la radiographie pulmonaire,
L’EMG (avec mesure de la latence) n’a d’intérêt
qu’après le 5
e
jour où il permet le plus souvent d’éva-
luer le pronostic en terme de récupération (pronostic
réservé en cas de dénervation sévère et précoce).
POLYRADICULONÉVRITE AIGUË [2]
Nous ne traiterons succinctement que du syn-
drome de Guillain-Barré (SGB) qui est la polyradi-
culonévrite aiguë la plus fréquente. Il n’y a pas
d’indication neuroradiologique.
Le SGB est une démyélinisation rapide d’origine
probablement auto-immune des nerfs périphériques
qui se traduit par une paralysie débutant le plus cou-
ramment au niveau des membres inférieurs et
remontant en affectant les muscles de la respiration
puis les nerfs crâniens. Cette maladie est caractérisée
par sa rapidité d’évolution, la paralysie pouvant être
totale en moins de 24 heures. Les patients ressentent
initialement des paresthésies des extrémités. C’est
une très grande urgence neurologique.
Trois phases ont été identifiées : 1) phase d’exten-
sion des paralysies : la phase d’extension a une durée
de 12 jours (en moyenne), 2) phase de plateau : elle
peut durer de quelques jours à plusieurs mois, 3) phase
de récupération : elle est très hétérogène, des lésions
irréversibles peuvent persister.
Le diagnostic repose essentiellement sur des argu-
ments cliniques. La ponction lombaire est indispen-
sable à la recherche de l’augmentation du taux
d’albumine sans élévation du nombre de cellules
(dissociation albumino-cytologique).
L’électromyogramme montre des stigmates électro-
physiologiques de la démyélinisation.
Le traitement repose soit sur les immunoglobulines
polyvalentes soit sur les plasmaphérères.
MÉNINGITES — MÉNINGO-ENCÉPHALITES
[9, 13]
Méningites infectieuses
Les méningites correspondent à une inflammation
de l’arachnoïde, de la pie-mère et du liquide cérébro-
spinal (LCS). Ce processus inflammatoire s’étend
TABLEAU I. – Bilan diagnostique d’un syndrome confusionnel.
TABLE I. – Diagnostic work-up in patients with confusion.
Pathologies suspectées Examens paracliniques
Infection NFS, VS, CRP, BU, ECBU
Désordre métabolique Ionogramme, calcémie,
glycémie, urée, créatinine
Pathologie cardiaque Électrocardiogramme,
enzymes cardiaques : CPK
et troponine
Pathologies digestives Abdomen sans préparation,
transaminases, bilirubine
Pathologie pulmonaire Radiographie pulmonaire
TABLEAU II. – Diagnostic différentiel entre paralysie faciale
périphérique et déficit facial central.
TABLE II. – Differential diagnosis between peripheral
and central facial palsy.
Paralysie faciale
périphérique Déficit facial central
Atteinte de tous les muscles
innervés par le nerf facial. Muscles innervés par le nerf
facial supérieur épargnés.
Même intensité du déficit
à la mimique émotionnelle
et volontaire.
Moins apparente à l’émotion
qu’aux mouvements
volontaires (dissociation
automatico-volontaire), sauf
parfois dissociation inverse.
Suppression des réflexes
faciaux. Réflexes faciaux conservés
voire majorés.
Altération possible du goût. Préservation du goût.
Atteinte lacrymale possible. Absence d’atteinte
lacrymale.
Pas d’atteinte des membres
sauf lors des lésions
nucléaires protubérantielles
responsables de signes
sensitivo-moteurs contro-
latéraux à l’atteinte faciale
(syndrome alterne).
Présence fréquente d’un
déficit moteur des membres
ou de signe d’irritation
pyramidale.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 18/05/2010
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%