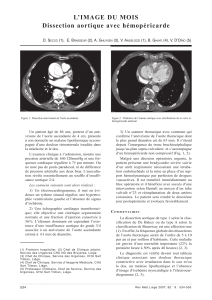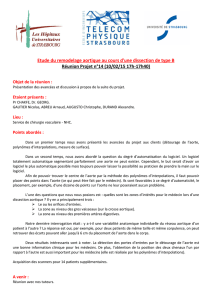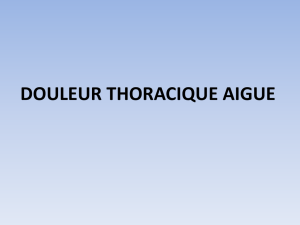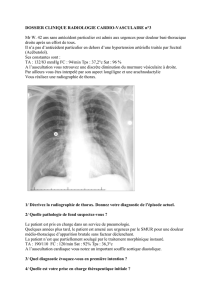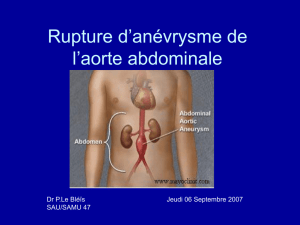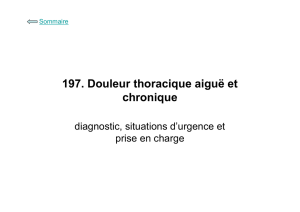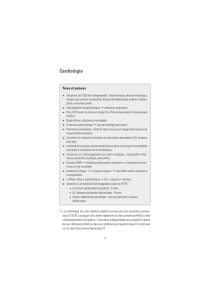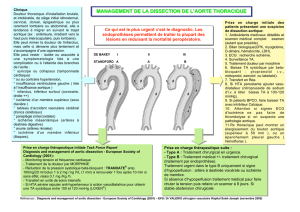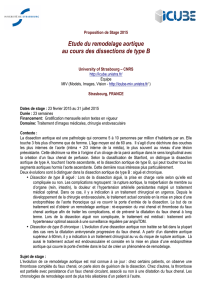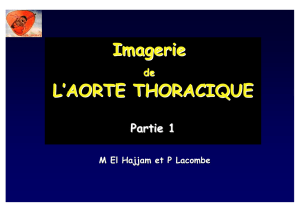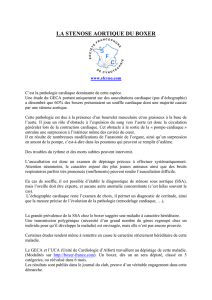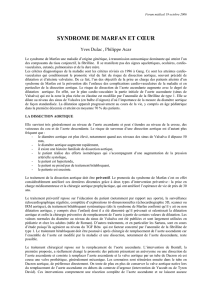Les syndromes aortiques aigus

Etiologie et classifi cation des syndromes
aortiques aigus. Organiser la prise en charge
àla phase aiguë
Dr Pascal Delsart. CHRU de Lille
Dissection aortique : A distance de la phase
aiguë, comment surveiller l’aorte
et quel traitement spécifi que proposer?
Pr Jean-Paul Beregi. CHU Nîmes
Quel traitement endovasculaire
et pour quelles indications dans les SAA?
Pr Hervé Rousseau. CHU de Rangueil
Coordination: Pr Jean-Paul Bounhoure
ISSN 0769-0819
Les syndromes Les syndromes
aortiques aigusaortiques aigus
n°349 – Février 2012
Quel est le risque neurologique
après chirurgie cardiaque depontage
aorto-coronaire ?
Dr Arnaud Maudière (Tours)
Zoom sur…Zoom sur…
FMC349v3.indd IFMC349v3.indd I 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

Editorial
Le Cardiologue 349 – Février 2012 III
Pr J.-P. Bounhoure
Syndromes aortiques aigus
Au sein des grandes urgences cardiologiques, parmi les syndromes douloureux thoraciques ma-
jeurs, les Syndromes Aortiques Aigus ( SAA ) s’individualisent par plusieurs traits caractéristiques :
- leur gravité immédiate, vu le risque de rupture aortique et de mort subite, implique une prise en
charge rapide par une équipe multidisciplinaire pour faire un bilan lésionnel exact, préciser le siège
de l’atteinte aortique , les risques évolutifs et fi xer les indications thérapeutiques ;
- actuellement, ils exigent un diagnostic précis fondé sur la pratique en urgence des diverses techniques
d’imagerie, angioscanner, échographie transœsophagienne, résonnance magnétique nucléaire ;
- si les indications chirurgicales s’imposent pour les atteintes de l’aorte ascendante, il faut souligner
les progrès indéniables du traitement médical et des techniques de thérapeutique endovasculaire
avec l’utilisation de stents grafts pour les SAA touchant l’aorte descendante.
Le terme de Syndrome Aortique Aigu, actuellement recommandé, regroupe diverses affections avec
une lésion initiale commune, une brèche intima-médiale. On décrit :
■ les hématomes intramuraux aortiques, considérés comme précurseurs d’une dissection,provenant
de la rupture des vasa vasorum de la média qui représentent 10 à 20% des SAA. Ils peuventprogres-
ser, entraîner un clivage de la média ou regresser et se résorber ;
■ les ulcères pénétrants, ulcérations plus ou moins profondes d’une plaque athéromateuse siégeant
électivement sur l’aorte descendante ;
■ les divers types de dissection aortique aiguë. Les classifi cations courantes des dissections sont ba-
sées sur le siège de la brèche initiale, constituant la porte d’entrée, clivant longitudinalement ou non
la média survenant au niveau de l’aorte ascendante (type A ) ou sur l’aorte descendante( type B).
Les études épidémiologiques récentes montrent que les SAA sont rares mais non exceptionnels,
avec un taux variant de 2 à 3,5 cas par an pour 100 000 habitants. La gravité est démontrée par les
études actuelles montrant que la mortalité est de 1 à 2 % par heure et de 50 % à la 72e heure pour
les dissections de l’aorte ascendante.
L’hypertension artérielle et des antécédents d athérosclérose et d’atteinte vasculaire sont fréquents chez
les sujets de plus de 65 ans. Une fragilisation de la paroi aortique est fréquente chez les sujets jeunes et
plusieurs anomalies génétiques avec fragmentation des fi bres élastiques, raréfaction des fi bres muscu-
laires lisses et dégénérescence kystique de la média sont des facteurs favorisant la survenue des SAA.
Les patients survivants après l’épisode aigu justifi ent une surveillance pour tenter de dépister les
risques de rupture secondaire, l’extension de la lésion aortique initiale, un syndrome d’ischémie
viscérale chronique lie à une compression par anévrysme ou faux chenal.
La surveillance des patients par les techniques d’imagerie actuelle est indispensable, l’épisode aigu
étant traité des complications ultérieures sont fréquentes.
Pour ce numéro réservé aux SAA, présentant d’excellentes mises au point, nous remercions les
auteurs qui ont déjà fait part de leur expertise sur ce sujet diffi cile et important :
Le Docteur Pascal Delsart et le Professeur Claire Mounier-Vehier présentent un article sur les étiolo-
gies et les classifi cations de ces affections en détaillant la prise en charge à la phase aiguë.
Le Docteur CJ. Roux et le Professeur Jean-Paul Beregi signent un article sur les modalités de la
surveillance et les risques de complications secondaires en montrant les risques d’une malperfusion
chronique de certains organes
Le Professeur Hervé Rousseau et son équipe qui ont une grande expérience des stents grafts, mon-
trent que s’il y a un consensus pour les dissections intéressant l’aorte ascendante le traitement
endovasculaire paraît actuellement donner des résultats favorables pour les dissections de type B.
Espérons que ces articles vous donneront satisfaction et nous vous souhaitons une lecture fruc-
tueuse.
■
FMC349v3.indd IIIFMC349v3.indd III 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

Une association unique
pour un nouvel horizon
HTA
essentielle*
SEVIKAR® 20mg/5mg, 40mg/5mg et 40mg/10mg, comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Olmésartan médoxomil 20mg et amlodipine 5mg
(6,944mg sous forme de bésilate d’amlodipine), olmésartan médoxomil 40mg et amlodipine 5mg (6,944mg sous forme de bésilate d’amlodipine) ou olmésartan médoxomil 40mg
et amlodipine 10mg (13,888mg sous forme de bésilate d’amlodipine) par comprimé pelliculé. DONNEES CLINIQUES*. Indications thérapeutiques. Traitement de l’hypertension
artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en
monothérapie. Posologie et mode d’administration*. Le comprimé doit être avalé avec une quantité suffisante de liquide (par exemple un verre d’eau). Le comprimé ne doit pas être
mâché et doit être pris au même moment chaque jour. Adultes. Un comprimé par jour. SEVIKAR® 20mg/5mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par
20mg d’olmésartan médoxomil ou 5mg d’amlodipine seuls. SEVIKAR® 40mg/5mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 20mg/5mg.
SEVIKAR® 40mg/10mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 40mg/5mg. Adaptation progressive de la dose de chacun des composants
recommandée avant de passer à l’association à dose fixe. Sujets âgés (65 ans et plus). Insuffisance rénale. Insuffisance hépatique. Population pédiatrique. Contre-indications.
Hypersensibilité aux substances actives, aux dihydropyridines ou à l’un des excipients. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. Insuffisance hépatique sévère et obstruction des
voies biliaires. En raison de la présence d’amlodipine, SEVIKAR® est également contre-indiqué chez les patients présentant: une hypotension sévère, un choc (y compris un choc
cardiogénique), une obstruction de la voie d’éjection du ventricule gauche (par exemple une sténose aortique de haut grade), une insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable
après un infarctus du myocarde en phase aiguë. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*. Patients présentant une hypovolémie ou une déplétion sodée. Autres
affections liées à la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Hypertension rénovasculaire. Insuffisance rénale et transplantation rénale. Insuffisance
hépatique. Hyperkaliémie. Lithium. Sténose des valves aortique ou mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Hyperaldostéronisme primaire. Insuffisance
cardiaque. Différences ethniques. Patients âgés. Grossesse. Autres précautions. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions*. Associations
déconseillées. Médicaments modifiant la kaliémie. Lithium. Grossesse et allaitement*. Grossesse. 1er trimestre: utilisation déconseillée. 2ème et 3ème trimestres: utilisation contre-
indiquée.
L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensineII est déconseillée au 1er trimestre de la grossesse. L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensineII est
contre-indiquée aux 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.
Allaitement. Utilisation déconseillée. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Fréquents : sensations vertigineuses,
fatigue, céphalées, œdème, œdème périphérique, œdème prenant le godet. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES*. Propriétés pharmacodynamiques*. Antagonistes
de l’angiotensineII et inhibiteurs calciques, code ATC: C09DB02. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES PHARMACEUTIQUES*. Durée
de conservation. 4 ans. Nature et contenu de l’emballage extérieur. NUMEROS D’AMM. SEVIKAR® 20mg/5mg. 3400938858266: 30comprimés. 3400938858495: 90comprimés.
SEVIKAR® 40mg/5mg. 3400938857894: 30comprimés. 3400938858037: 90comprimés. SEVIKAR® 40mg/10mg. 3400938857436: 30comprimés. 3400938857726: 90comprimés.
DATE DE PREMIERE AUTORISATION. 3octobre2008. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. SEVIKAR® 20mg/5mg et SEVIKAR®40mg/5mg: 16juin 2011. SEVIKAR® 40mg/10mg: 6 juin
2011. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE. Médicament soumis à prescription médicale. Liste I. PRIX. 26,94€ (30cp). CTJ: 0,90€ - 69,38€
(90cp). CTJ: 0,77€. Remb Séc Soc à 65%. Agréé Coll. TITULAIRE DE L’AMM/EXPLOITANT. DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - 1, rue Eugène et Armand Peugeot -
92500 Rueil-Malmaison - Tél.: 0155621460. *Une information complète est disponible sur le site Internet de l’Afssaps
(http://www.afssaps.sante.fr) ou peut être demandée auprès de notre laboratoire. SEV/MLA/06.2011
SEV/11/239/AP - Date de diffusion : octobre 2011
*Traitement de l’hypertension artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression
artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en monothérapie.
Olmésartan médoxomil - amlodipine
Comprimé pelliculé
40 mg / 10 mg40 mg / 5 mg20 mg / 5 mg
ap 210X270 oct2011 .indd 1 06/10/2011 16:34:58
FMC349v3.indd IVFMC349v3.indd IV 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

ÉDITEUR
CARDIOLOGUE PRESSE
13 rue Niepce – 75014 Paris
Tél.: 01.45.43.70.76 – Fax: 01.45.43.08.10
Email: [email protected]
Site web : www.cardionews.com
ÉDITEUR DÉLÉGUÉ
Régifax – 45-47 rue d’Hauteville – 75010 Paris
Tél.: 01.47.70.00.96 – Fax: 01.48.24.15.05
Directeur: Renaud Samakh
Publicité: François Bondu
Coordination de la rédaction: Renaud Samakh
Directeur artistique: Pascal Wolff
RÉDACTION
Président et directeur de la publication :
DrChristian Aviérinos
Directeur adjoint : Dr Serge Rabenou
Rédacteur en chef : Dr Christian Aviérinos
Comité scientifi que :
Pr Victor Aboyans
Pr Jean-Paul Bounhoure
Dr Thierry Denolle
Dr François Diévart
Dr Jean-Louis Gayet
Dr Robert Haïat
Pr Daniel Herpin
Pr Christophe Leclercq
Pr Jacques Machecourt
Dr Marie-Christine Malergue
Dr François Philippe
Dr Bernard Swynghedauw
Comité de lecture :
Dr Gérard Jullien
Dr Christian Ziccarelli
TARIF 2012 – 1 an, 10 numéros
France: 140 €
CEE (hors France): 160€
Tout autre pays: 275€
Prix « Spécial adhérent » au syndicat,
à jour de cotisation: 70€
Prix unitaire: 20€
Adhérent au Cessim et au SPEPS
Mensuel réservé au corps médical
Impression: Barbou Impressions
8, rue Marcel-Dassault, Bondy
RCS Bobigny B 572 188 357
Commission paritaire: 0114 G 81182
Dépôt légal: à parution
Les articles publiés dans la revue «Le Cardiologue» le
sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Tous
droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par
tous procédés réservés pour tous pays.
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992
interdit expressément la photocopie à usage collectif
sans autorisation des ayants droit. En application de
la loi du 11mars 1993, il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement la présente publication
sans autorisation de l’éditeur ou droits de reproduction
versés à celui-ci.
Le Cardiologue 349 – Février 2012 V
Sommaire
Les syndromes
aortiques aigus
IV Editorial
Syndromes aortiques aigus
Pr J.-P. Bounhoure. Toulouse
VI Etiologie et classifi cation des syndromes
aortiques aigus. Organiser la prise en charge
àla phase aiguë
Dr P. Delsart. CHRU de Lille
IX Dissection aortique : A distance de la phase
aiguë, comment surveiller l’aorte
et quel traitement spécifi que proposer?
Pr J.-P. Beregi. CHU Nîmes
XIV Quel traitement endovasculaire
et pour quelles indications dans les SAA?
Pr H. Rousseau. CHU de Rangueil
XVIII Zoom surZoom sur……
Quel est le risque neurologique
après chirurgie cardiaque depontage
aorto-coronaire ?
Dr A. Maudière. Tours
SEV/11/239/AP
-
Date
de
diffusion
:
octobre
2011
8
FMC349v3.indd VFMC349v3.indd V 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

VI Le Cardiologue 349 – Février 2012
Les syndromes aortiques aigus
SAA
Les Syndromes Aortiques Aigus (SAA) constituent une entité re-
groupant les différentes atteintes de la paroi aortique mettant en
jeu le pronostic vital des patients. Les recommandations de la société
européenne de cardiologie de 2001 avaient proposé une classifi ca-
tion basée sur l’atteinte de la paroi aortique. Les syndromes aor-
tiques aigus regroupaient alors la dissection aortique, l’ulcère péné-
trant, l’hématome intramural et les dissections traumatiques. Cette
description anatomopathologique est à mettre en parallèle avec les
descriptions morphologiques historiques de Debakey et de Stanford,
celles-ci distinguaient plus simplement les atteintes de l’aorte ascen-
dante (Type 1 et 2 de Debakey ou Type A de Stanford) des atteintes
de l’aorte descendante (Type 3 de Debakey ou Type B de Stanford).
Ces deux classifi cations ne sont pas à opposer, mais doivent toutes
les deux être connues et intégrées dans la réfl exion diagnostique.
Leur principal intérêt est de pouvoir organiser la prise de chaque
patient d’une manière simple et optimale en intégrant les données
anatomopathologiques et morphologiques.
Les SAA sont rares et leur prévalence réelle est surtout diffi cile à
estimer. Si l’on avance dans les différentes populations étudiées, une
incidence de 3 à 5 Patients/100 000 habitants, il ne faut oublier que
cette pathologie grave est responsable d’un grand nombre de décès
préhospitaliers, souvent sous la forme d’une « mort subite » rendant
diffi cile l’estimation correcte des données épidémiologiques. La créa-
tion d’un registre international sur la prise en charge des dissections
aortiques (IRAD: International Registry of Acute Aortic Dissection) a
permis d’obtenir rapidement des données épidémiologiques intéres-
santes concernant cette maladie rare et assez mal connue.
Ainsi, dans leur premiers travaux, 62,3 % des patients étaient hospi-
talisés pour un SAA de type A et 37,7 % pour un type B. Les patients
étaient en majorité des hommes de 60 à 65 ans, aux antécédents
d’hypertension artérielle dans 70 % des cas environ. Les patients
atteints d’un type B étaient légèrement plus âgés, la répartition entre
les deux sexes était égale. La proportion de patients atteints de syn-
drome de Marfan ou présentant un anévrysme aortique était plus
élevée pour le groupe de patients atteints de type A.
Ce registre a également montré que les dissections aortiques comme
les autres pathologies cardiovasculaires suivaient un rythme circa-
dien, avec une plus grande fréquence de survenue entre 18 heures et
0 heure et un pic saisonnier en hiver.
Défi nitions
La défi nition de la dissection aortique est une défi nition anato-
mopathologique. Il s’agit de l’association d’une déchirure de l’intima
à un clivage longitudinal de la média des aortes thoraciques et ab-
dominales et éventuellement de leur branche. Le caractère aigu de
l’événement est défi ni arbitrairement : il s’agit des patients dont les
symptômes ont débuté moins de 14 jours avant l’hospitalisation. Au-
delà, on parle de SAA chronique. La déchirure intimo-médiale se fait
à partir d’un orifi ce appelé « porte d’entrée », cette porte d’entrée
créée une nouvelle voie d’écoulement pour le sang encore appelé le
« faux chenal ».
Ce faux chenal peut ainsi progresser sous l’effet du fl ux sanguin
dans le sens antérograde ou rétrograde. Ce faux chenal est borgne,
même si quelques portes de sortie peuvent de se créer en raison
de la pression exercée sur ces parois fragilisées. Ce faux chenal va
grossir et va dans la majorité des cas comprimer le vrai chenal (lu-
Etiologie et classifi cation
dessyndromes aortiques aigus
Organiser la prise en charge à la phase aiguë
Dr P. Delsart. Lille
FMC349v3.indd VIFMC349v3.indd VI 27/02/12 10:2227/02/12 10:22
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%