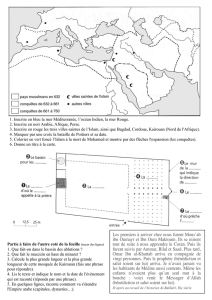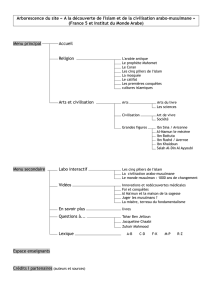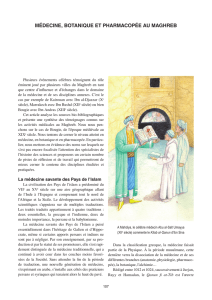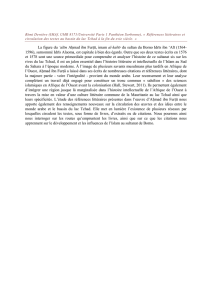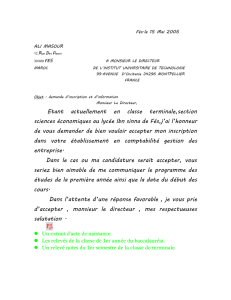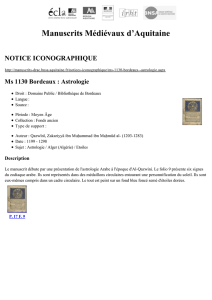Loi morale, loi politique : al

Charles Genequand
Loi morale, loi politique :
al-Fārābī et Ibn Bāğğa
Al-Fārābī ne s’exprime que rarement sur la loi ou les lois en tant que telles, c’est-à-dire
sur les lois positives. Le plus souvent, dans les passages politiques de ses ouvrages,
il se contente de mentionner la cité, excellente ou corrompue, ou les opinions de
ses habitants, sans donner davantage de détails sur les lois qui conditionnent ou
expriment leur conduite ou leurs principes. Les textes qui s’approchent le plus d’une
telle dénition se trouvent en particulier dans Taḥṣīl al-sa‘āda, mais ne dépassent
guère le cadre de principes généraux. Le passage suivant en offre un bon exemple :
Un aspect de la vertu délibérative (faḍīla kriyya) est ce par quoi on peut découvrir
ce qui est le plus utile en vue d’une n excellente commune à plusieurs nations,
à une nation ou à une cité dans une circonstance commune [...]. Cette vertu
délibérative est une vertu délibérative politique. Cette [n] commune peut être ce
qui est de nature à se maintenir en existence pendant une longue durée. D’autres
[ns] changent1 dans de courtes périodes. Mais la vertu délibérative, qui découvre
le plus utile ou le meilleur commun à plusieurs nations ou à une nation ou à une
cité, lorsqu’il est de la nature de ce qui est découvert de durer longtemps, ou de
changer dans une période courte, est la vertu délibérative politique. Lorsqu’elle
ne découvre que les choses communes à plusieurs nations, à une nation ou à une
cité qui ne changent que sur des âges ou de longues périodes déterminées, elle
ressemble davantage à la capacité législative (waḍ‘ al-nawāmīs)2.
La vertu délibérative dont il est ici question correspond précisément à l’intelligence
pratique qu’Aristote distingue de la théorétique au début du livre VI de l’Éthique
à Nicomaque (1139a 5-15) et qu’il nomme un peu plus loin φρόνησις. La même
1 Je retiens la lecture tatabaddal suggérée par Āl Yasin dans sa note 10, conrmée par mutabaddila à la l. 17.
La traduction que M. Mahdi donne de ce passage dans Mahdi Muhsin (1962), Alfarabi’s Philosophy of
Plato and Aristotle, translated with an introduction, Cornell University Press, New York, p. 28, me paraît
sujette à caution dans la mesure où elle fait porter l’alternative entre la longue durée et les courtes périodes
non sur la n excellente, mais sur « the events that affect them in common », ce qui est manifestement
erroné.
2 al-Fārābī Abū Naṣr (1981), Kitāb Taḥṣīl al-sa‘āda, éd. āl Yāsīn Ğa‘far, Dār al-Andalus, Beyrouth, p. 69,
8 – 70, 2.

Charles Genequand
Mélanges de l’Université Saint-Joseph 61 (2008)
492
distinction est reprise par al-Fārābī dans Al-Madīna al-fāḍila3 où il distingue deux
parties dans la faculté rationnelle (quwwa nāṭiqa) : une théorétique (naẓariyya) et
une pratique (‘amaliyya), ainsi que dans Al-Siyāsa al-madaniyya4. De même dans
Fuṣūl muntaza‘a5 il distingue ces deux facultés, et à l’intérieur de la partie pratique
une partie délibérative (krī) et une partie productive (mihnī). Au début de Taḥṣīl al-
sa‘āda, en revanche, on trouve parmi les quatre choses qui permettent d’accéder au
bonheur les vertus théorétiques et les vertus délibératives (faḍā’il kriyya), les deux
dernières étant les vertus morales (ḫulqiyya) et les arts productifs (ṣinā‘āt ‘amaliyya).
Aristote, quant à lui, distingue les vertus morales et les vertus intellectuelles (Éthique
à Nicomaque 1103a 3-10 ; 1138b 35 – 1139a 1), mais non des vertus qui seraient
propres à la partie théorétique et pratique respectivement, quoique tout son traité
montre que les vertus morales relèvent en un certain sens de l’intelligence pratique.
La position d’al-Fārābī paraît donc dans une certaine mesure plus cohérente que
celle d’Aristote, puisqu’il fait correspondre des vertus spéciques, théorétiques
et délibératives, aux deux parties de l’âme rationnelle. Il est vrai que l’on ne voit
plus très bien dès lors à quoi correspond la distinction entre vertus pratiques et
morales. Il est impossible de comparer de manière précise sa terminologie à celle
de la traduction arabe de l’Éthique à Nicomaque étant donné que cette dernière ne
nous a malheureusement pas été conservée pour le livre VI. La conséquence la plus
importante de la présentation personnelle qu’al-Fārābī fait de cette question est de
rattacher plus étroitement la législation à la philosophie morale ou pratique qu’à la
philosophie théorétique.
Une autre distinction que l’on trouve dans ce paragraphe est celle qui sépare la
vertu délibérative politique de la capacité législative. Aristote distingue également
dans l’intelligence pratique (φρόνησις) un aspect législatif et un aspect qu’il appelle
politique, qui est pratique et délibératif (1141b 23-27), et attribue une place éminente
au premier par rapport au second.
Ces quelques précisions permettront de mieux situer et comprendre le passage sui-
vant dans lequel al-Fārābī aborde de façon plus directe la question de la législation :
De même il est évident que lorsqu’on veut faire exister en acte les intelligibles des
choses volontaires que fournit la philosophie pratique, il faut stipuler les conditions
par lesquelles il est possible qu’elles existent en acte, et lorsque ces conditions ont
3 Cf. Walzer Richard (éd. et tr.) (1985), Al-Farabi on the Perfect State. Abū Naṣr al-Fārābī’s mabādi’ ārā’
ahl al-madīna al-fāḍila, A revised text with introduction, translation and commentary, Oxford University
Press, Oxford, p. 208, 2-3.
4 al-Fārābī Abū Naṣr (1986), Kitāb al-Siyāsa al-madaniyya al-mulaqqab bi-mabādi’al-mawjūdāt, éd.
najjar Fawzi, Dar al-Mashreq, Beyrouth, p. 33, 3.
5 Id. (1971), Fuṣūl muntaza‘a, éd. najjar Fawzi, Dar al-Mashreq, Beyrouth, p. 29, 5-7.

Loi morale, loi politique : al-Fārābī et Ibn Bāğğa 493
été stipulées, il faut les consigner dans les lois. Le législateur (wāḍi‘ al-nawāmīs)
est celui qui a la capacité, par l’excellence de sa délibération, de produire les condi-
tions par lesquelles elles vont exister en acte de manière à ce qu’on atteigne ainsi
le bonheur suprême. Il est évident que le législateur ne peut viser à découvrir leurs
conditions, ni à les concevoir préalablement par l’intellect, qu’il ne peut produire
les conditions par lesquelles il puisse guider vers le bonheur suprême ou concevoir
par l’intellect le bonheur suprême, qu’il n’est pas possible qu’il acquière ces intelli-
gibles et que par eux l’essence de la législation devienne premier commandement,
sans avoir préalablement maîtrisé la philosophie6.
Ce deuxième passage nous place à nouveau clairement dans le champ intellectuel
qui est celui de l’Éthique à Nicomaque : les choses volontaires, la philosophie
pratique, constituent par excellence l’objet de cet ouvrage. De même, la mention
du bonheur comme n de l’homme en constitue l’un des thèmes dominants. Mais la
seconde moitié du paragraphe semble immédiatement apporter un correctif à cette
manière de voir en afrmant la nécessité d’acquérir des intelligibles de ces notions
et de maîtriser la philosophie tout court, ce qui semble bien impliquer la philosophie
théorétique aussi. Toutefois, l’accent porte moins ici sur la philosophie, théorétique
ou pratique, ou sur une discipline quelle qu’elle soit, et particulièrement la législation,
que sur la personne qui la maîtrise et est capable de la mettre en œuvre, à savoir, dans
le cas qui nous occupe, le législateur. C’est à lui qu’il nous faut maintenant nous
intéresser. Le texte suivant est l’un des plus précis et détaillés :
Les chefs et dirigeants de cette cité sont de quatre sortes. L’un est le roi en réalité
(al-malik ‘alā al-ḥaqīqa), le premier chef, qui est celui en qui sont réunies six
conditions : la sagesse, le raisonnement parfait, le don de la persuasion, le don de
la suggestion (ǧūdat al-taḫyīl), la capacité à combattre en personne et l’absence de
tout défaut corporel l’empêchant de faire la guerre. Celui en qui toutes ces qualités
sont réunies est le modèle à suivre (dustūr) dans ses manières de vivre (siyar) et ses
actions, celui dont les préceptes et les recommandations sont acceptés ; il convient
qu’il gouverne selon ce qu’il pense et comme il veut. La deuxième [sorte] est qu’il
n’y ait pas d’homme chez qui toutes ces qualités soient réunies mais qu’elles soient
réparties dans un groupe de telle manière que l’un détermine le but, le deuxième
ce qui conduit au but, le troisième possède le don de la persuasion et le don de la
suggestion, qu’un autre possède la capacité de combattre, et que ce groupe dans son
ensemble occupe la place du roi ; on les appelle les chefs excellents et les vertueux,
et leur gouvernement s’appelle le gouvernement des vertueux. La troisième est que
ceux-ci n’existent pas non plus et que le chef de la cité soit celui en qui se trouve la
connaissance des législations et des traditions antérieures données par les premiers
imams et par lesquelles ils ont gouverné les cités. Il faut qu’il ait aussi le don de
discerner les lieux et les circonstances auxquelles il doit appliquer ces traditions
conformément au but des anciens ; qu’il ait ensuite la capacité de découvrir ce
6 al-Fārābī, K. Taḥṣīl al-sa‘āda, éd. āl Yāsīn, p. 91, 14 – 92, 2.

Charles Genequand
Mélanges de l’Université Saint-Joseph 61 (2008)
494
qui n’est pas explicité dans les traditions orales (maḥfūẓa) et écrites d’autrefois,
suivant par ce qu’il découvre le modèle des traditions antérieures. Ensuite qu’il
ait le don de l’intelligence et de l’intellect (ra’y wa-ta‘aqqul) pour les événements
qui surviennent successivement et n’ont pas été prévus dans les modes de vie
précédents et qu’il puisse ainsi préserver la prospérité de la cité, qu’il ait le don de
la persuasion et de la suggestion et la capacité de combattre. Celui-là est appelé
roi traditionnel (malik al-sunna) et son pouvoir royauté traditionnelle (sunnī). La
quatrième est qu’il n’y ait pas un homme en qui toutes ces qualités soient réunies
mais qu’elles soient réparties dans un groupe et qu’à eux tous ils occupent la place
du roi traditionnel. Ce groupe est appelé chefs traditionnels7.
Ce passage présente donc quatre formes de gouvernement manifestement rangées
en ordre décroissant de perfection. Le chef idéal est le premier qui réunit en lui les
six capacités qualiantes pour la fonction suprême. Bien qu’al-Fārābī ne le spécie
pas ici, ce chef correspond manifestement au prophète-philosophe possédant à la
fois la sagesse théorique et la capacité de l’exprimer en images à l’intention de
ceux qui ne sont pas à même de la saisir sous sa forme abstraite pure. Le caractère
saillant de cette conception du roi en vérité est la parfaite coïncidence en lui de la
Loi et du Législateur. Le législateur est l’incarnation de la loi. Il est la loi. On peut
donc le considérer comme prophète, même si cela n’est pas dit explicitement ici.
Au contraire, dans le troisième modèle, la loi est antérieure et extérieure au chef qui
ne fait que l’appliquer et l’interpréter. Ce type correspond à l’imam-calife de la loi
islamique8. En poursuivant l’analogie avec les institutions de l’islam, on dirait que
la quatrième catégorie correspond à la classe des ulémas. Seule la deuxième n’a pas
d’analogue évident en islam. Ces équivalences ne sont pas explicitées par al-Fārābī
mais clairement suggérées par le vocabulaire utilisé.
Cette coïncidence du législateur parfait et de la loi a une conséquence importante,
c’est qu’il n’y a pas de loi positive, ou plus exactement que la loi positive est une
sorte de loi dégénérée, un pis-aller. Al-Fārābī en est donc réduit à décrire ou expliquer
l’origine, le fonctionnement, l’application de la loi en se gardant de s’intéresser à
son contenu effectif. Dans les nombreux passages en particulier où il l’aborde en
relation avec le législateur, ce sont les conditions de sa production et de sa mise en
œuvre qu’il discute en tant que problème philosophique, non les lois concrètes et
positives. En revanche, lorsqu’il mentionne des lois particulières, comme dans le
Compendium des Lois, il se contente de poser leur existence comme un donné et
d’en tirer certaines conséquences quant à leurs effets, mais sans s’interroger sur leur
7 al-Fārābī, Fuṣūl muntaza‘a, éd. najjar, § 58, p. 66, 2 – 67, 12 = id. (1961), Fuṣūl al-madanī. Aphorisms
of the Statesman, éd. et tr. dunlop Donald M., Cambridge University Press, Cambridge, § 54.
8 On trouve une description plus détaillée de ses fonctions dans al-Fārābī Abū Naṣr (1968), Kitāb al-Milla,
in Mahdi Muhsin (éd.), Kitāb al-Milla wa-nuṣūs ukhrā, Dar al-Mashreq, Beyrouth, p. 49, 2-8.

Loi morale, loi politique : al-Fārābī et Ibn Bāğğa 495
origine ou le moyen d’en établir de bonnes et de justes. Ailleurs, il s’intéresse à la
manière dont elles doivent ou peuvent être utilisées ou mises en œuvre par l’orateur
et sur leur rôle dans le débat rhétorique9. Cet état de fait n’est pas très étonnant dans
le contexte de la civilisation islamique du xe siècle où l’existence de la šarī‘a est un
donné qui ne saurait être remis en cause. Proposer une législation ne peut consister
qu’en une répétition de la šarī‘a, ce qui est inutile, ou proposer une loi différente,
ce qui serait impie. Il serait donc plus exact de dire non pas que l’absence de loi
positive découle de la coïncidence de la loi et du législateur, mais qu’elle en est la
cause. Al-Fārābī ne fait que tirer implicitement la conséquence du contexte politico-
juridique dans lequel il vit.
Ces vues sont conrmées et complétées par un passage d’al-Siyāsa al-madaniyya10
qui dénit en des termes identiques le premier chef absolument, le roi en réalité
(ra’īs awwal ‘alā al-iṭlāq, al-malik fī al-ḥaqīqa) ainsi que le roi traditionnel, en
omettant les deux modes de gouvernement collectifs. La grande différence entre les
deux exposés est que celui d’al-Siyāsa al-madaniyya passe à peu près complètement
sous silence les deuxième et quatrième types, soit les royautés collectives, et surtout
que le chef y est avant tout caractérisé comme celui qui reçoit la révélation (yūḥā
ilay-hi) quand il s’attache à l’intellect agent, dont le mécanisme est alors précisément
décrit. S’il a un successeur de même niveau, ce dernier peut modier la šarī‘a. S’il
n’en a point, on reprend les lois écrites et orales (kutibat wa-ḥuẓat) pour gouverner
la cité, et ce chef est appelé malik al-sunna.
K. al-Milla11 parle du ra’īs awwal fāḍil qui exerce le métier royal (mihna
malakiyya), lié à la révélation (waḥī) qu’il reçoit de Dieu et qui lui permet de xer
les conditions šarā’iṭ du bon gouvernement. Il conclut12 :
« Il a été montré dans la science théorétique comment se produit la révélation de
Dieu Très-Haut à l’homme qui reçoit la révélation et comment naît en l’homme
la faculté qui vient de la révélation et de l’auteur de la révélation (mūḥī). Les
doctrines qui prévalent dans la religion (milla) excellente portent soit sur les choses
théorétiques soit sur les choses volontaires. Les choses théorétiques sont ce par quoi
l’on décrit » (à partir d’ici je paraphrase et résume fortement le texte arabe) : Dieu,
les rūḥāniyyūn, l’univers et ses parties, les corps premiers qui sont les principes de
tous les corps qui naissent et meurent, l’homme, l’âme et l’intellect et leurs rapports
9 Cf. al-Fārābī Abū Naṣr (1971), Kitāb al-Ḫaṭāba, in lanGhade Jacques et Grignaschi M. (éds.), Al-Fārābī :
Deux ouvrages inédits sur la Rhétorique. I- Kitāb al-Ḫaṭāba. II- Didascalia in Rethoricam Aristotelis ex
glosa Alpharabi, Dar al-Mashreq, Beyrouth, p. 159-162. Je remercie Maroun Aouad d’avoir attiré mon
attention sur ce point.
10 Voir al-Fārābī, K. al-Siyāsa al-madaniyya, éd. najjar, p. 79, 3 – 81, 4.
11 Id., K. al-Milla, éd. Mahdi, p. 44, 6.
12 Ibid., p. 44, 12 – 45, 16.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%