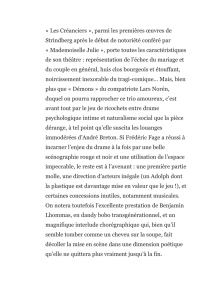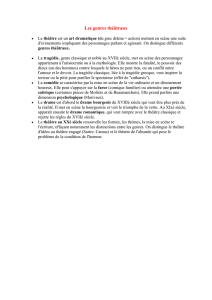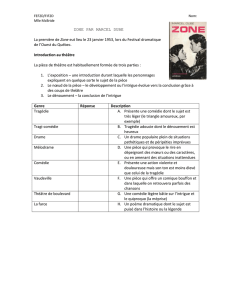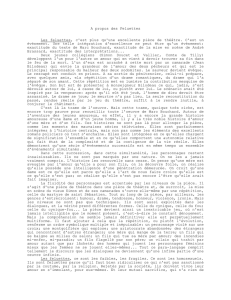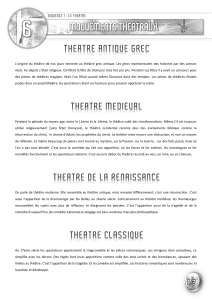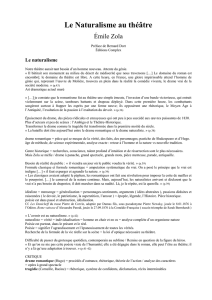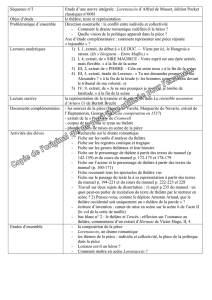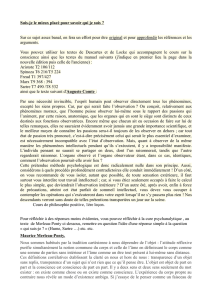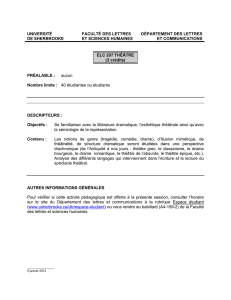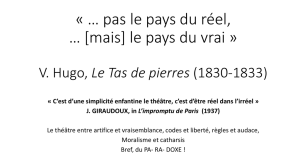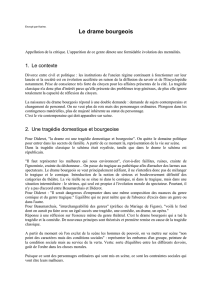LE DRAME EN FRANCE AU XVIIIe SIÈCLE

FELIX GAIFFE
LE DRAME
EN FRANCE
AU XVIIIe SIÈCLE
1971
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
103,
Boulevard Saint-Michel - Paris 5e

TABLE DES MATIERES
Pages
AVANT-PROPOS
1
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PARTIE.
—
Les Origines du Drame.
CHAPITRE PREMIER
DÉCADENCE
ET
TRANSFORMATION
DE LA
TRAGÉDIE
ET DE LA
COMÉDIE
AU
XVIII'
SIÈCLE.
I. — L'épuisement des genres dramatiques classiques au
XVIII*
siècle est
constaté par toute la critique
:
opinions de Mercier, Grimm, Rousseau,
Diderot, Voltaire. — La défaveur ne s'arrête pas aux imitateurs
impuissants des grands modèles du xvn" siècle, mais gagne ces
modèles eux-mêmes 15
II.
— Crébillon et Voltaire modifient profondément l'esprit comme la
technique de la Tragédie 24
III. —
Transformation de la Comédie. Marivaux et ses imitateurs. Des-
touches et la Comédie morale. — Fontenelle, Piron, Voltaire, précur-
seurs du Drame. La Chaussée et la Comédie larmoyante : ce qui lui
a manqué pour être le véritable fondateur du Drame. — François II,
Cénie, Sidney et Silvie. — La Tragédie et la Comédie tendent à se
rapprocher et à se fondre 28
CHAPITRE II
INFLUENCE
DES
LITTÉRATURES
ÉTRANGÈRES.
I. — Les Littératures étrangères, plus que l'antiquité, aident le xvm* siè-
cle à sentir les imperfections du théâtre français classique. — Le
Journal étranger 35

594 LE DRAME EN FRANCE AU XVIII* SIÈCLE
II.
— Influence insignifiante des Littératures méridionales. — Goldoni,
Voltaire et Diderot; la Maison de Molière. — L'Espagne : Linguet
et Beaumarchais 41
III.
— L'Anglomanie. — Shakespeare et le Drame. — Les premières
traductions du théâtre anglais. — Le Marchand de Londres et le
Joueur. Imitations diverses : Fielding et Richardson. — Echanges
par ricochets entre les deux littératures 46
IV. — Influences réciproques du Drame français et du Drame allemand ;
Diderot et Lessing. — L'importance des imitations ne répond pas
à leur nombre
:
prédilection de nos dramaturges pour les pièces alle-
mandes les plus médiocres. — Lessing, Gœthe et Schiller.
—
Gessner
et les
poetse
minores 60
V. — Caractère de ces diverses imitations : leur influence très inégale.
—
Suppressions et atténuations : les adaptations du Marchand de Lon-
dres. — Complexité des questions de priorité : difficultés de leur
interprétation et limites de leur importance 10
CHAPITRE III
ORIGINES
SOCIALES
DU
DRAME.
CARACTÈRE
ESSENTIEL ET
DÉFINITION
DU
GENRE.
I. — Prédominance des influences morales et sociales dans la genèse du
Drame. — Changement dans la situation et le rôle des gens de lettres
et des auteurs dramatiques en particulier.
—
But moral du théâtre.
—
Le Drame est un genre nouveau créé par le parti philosophique pour
attendrir et moraliser la bourgeoisie et le peuple en leur présentant
un tableau touchant de leurs propres aventures et de leur propre
milieu 18
II.
— Justification de cette définition. Aucune de celles que l'on pourrait
tirer des caractères purement esthétiques du genre ne serait satisfai-
sante.
—
Par contre, celle-ci, fondée sur le caractère social du Drame,
en comprend sans peine les nombreuses variétés, en même temps
qu'elle le différencie nettement de la Comédie et de la
Tragédie.
. 93
CHAPITRE IV
LE
MILIEU. — LES RÉSISTANCES.
I.
—
La
Censure
: ses rigueurs et ses caprices; quelques persécutions nota-
bles.—
Intolérance universelle.
—
Le régime des petits théâtres. 105

TABLE
DES
MATIÈRES
595
II.
—
Les Acteurs : omnipotence, ignorance
et
routine. —
Le
Drame exige
un apprentissage nouveau
et
dérange
les
habitudes consacrées.
114
III. —
Les Journaux: asservis
aux
acteurs,
au
pouvoir, aux coteries. — La
plupart
des
journalistes
ne
sont
ni
estimables,
ni
impartiaux; mais
leur influence
est
limitée. —
Les
Correspondances
122
IV.
—
Parodies
et
Libelles: parfois spirituels, rarement redoutables.
131
V.
— Le
Public
:
turbulent
et
routinier; dangereux
par ses
plaisanteries
faciles
et ses
accès
de
pruderie; mais prompt aussi
à
s'émouvoir
et
à s'enthousiasmer
138
CONCLUSION
150
DEUXIÈME PARTIE. — Histoire
du
Genre.
CHAPITRE PREMIER
PREMIÈRE PÉRIODE
: DE
LA
PUBLICATION
A LA
REPRÉSENTATION
DU
«
FILS NATUREL
» (1151-1111).
I.
—
Objet
et
méthode
de cet
exposé. — Publication
du
Fils Naturel
et
du
Père
de
Famille. —
Les
Entretiens
et le
traité
[De
la
Poésie draina-
tique. — Leur importance
:
Diderot, chef d'école.
—
Voltaire
et
VEcos-
saise.
—•
Représentation
du
Père
de
Famille
152
II.
—
Dupuis
et
Desronais
de
Collé.
—
LB Philosophe sans
le
savoir,
chef-d'œuvre
de
l'école de Diderot; valeur
de
Sedaine comme homme
de théâtre. —
Le
premier drame
de
Beaumarchais : Eugénie.
. . 163
111.—La première imitation
du
Drame anglais portée
à la
scène
:
Béver-
ley
de
Saurin.
—
Publication
des
drames d'Arnaud
et de
l'Honnête
Criminel
de
Falbaire.
—
Echec
des
Deux Amis
de
Beaumarchais. —
La Harpe
et les
lectures
de
Mélànie
161
IV. — Chute
du
Fils Naturel; ses conséquences.
—
Place
du
Drame dans
le
répertoire
du
Théâtre-Français
en
1111
113
V. —
Le
Drame s'introduit
au
Théâtre-Italien sous
la
forme
de
l'Opéra-
comique larmoyant.
—
Sedaine
et le
Déserteur
111
VI. —
Influence
du
Drame
sur la
Tragédie
et la
Comédie
182
CHAPITRE
II
DEUXIÈME PÉRIODE
: DE LA
REPRÉSENTATION
DU «
FILS NATUREL
»
A
LA
TRANSFORMATION
DE LA
COMÉDIE-ITALIENNE (1171-1780).
1.
— Période d'incertitude
et
de tâtonnements. — La Comédie-Française
:
tentatives
en
sens divers
;
les
tragédies
de
Ducis
;
les
Amants gêné-

596 LE DRAME EN FRANCE AU XVIIIe SIÈCLE
veux
de
Rochon;
la
Partie
de
chasse
de
Henri
IV de
Collé; Pygma-
lion
de
Rousseau.
—
Peu de
drames nouveaux
; les
anciens
se
main-
tiennent
au
répertoire.
—
La
Comédie-Italienne
;
succès persistant
de
l'Opéra-comique dramatique
et
touchant
186
IL— Les
théâtres
du
Boulevard et les théâtres de province offrent un nouvel
asile
au
Drame.
—
Sébastien Mercier.
—
Les
théâtres
de
société.
—
Le
Drame
et
l'Académie Française. L'opinion moyenne
de la
critique
et
du public devient favorable
au
[genre nouveau
198
CHAPITRE
III
TROISIÈME
PÉRIODE
:
DE
LA
TRANSFORMATION
DE LA
COMÉDIE-ITALIENNE
A
LA
PROCLAMATION
DE LA
LIBERTÉ DES THÉÂTRES
(1180-1191).
I.
—
Reprise des pièces françaises
à la
Comédie-Italienne.
—
Conséquences
de
la
réforme
209
II.
— Rivalité entre
les
deux théâtres.
—
Les
drames représentés brillent
plus
par la
quantité que
par la
qualité
:
quelques œuvres intéressantes
de Mercier, Desforges, Florian, etc. ; déluge d'ouvrages médiocres.
—
1189
et les
drames révolutionnaires
215
III.
—Le Drame influe
de
plus
en
plus
sur
l'Opéra-Comique
et
gagne
jus-
qu'à
la
scène
de
l'Opéra
226
IV.
—
Développement considérable des petits théâtres
:
le
Drame
aux Bou-
levards
229
V.
—
Transformations
du
Drame au début
de la
Révolution : le Mélodrame,
les Faits historiques
231
VI.
— Proclamation
de la
liberté
des
théâtres.
—
Place
du
Drame dans
la
production théâtrale
au
début
de la
période révolutionnaire.
. . 241
TROISIÈME PARTIE.
— La
Matière
du
Drame.
CHAPITRE PREMIER
LES IDÉES PHILOSOPHIQUES
ET
MORALES.
I
—
L'enseignement moral, préoccupation première
et but
essentiel
du
Drame, détermine
le
choix des sujets
et
toute
la
structure
des
pièces.
Il
n'y est pas
dissimulé, mais ouvertement
et
maladroitement alli—
ohé
241
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%