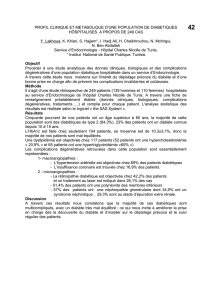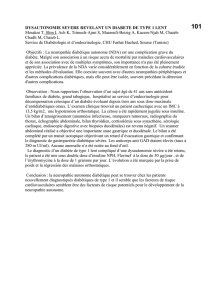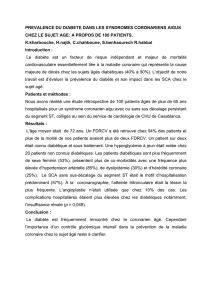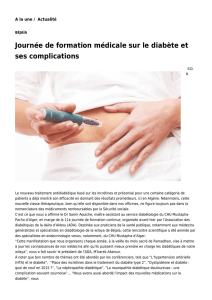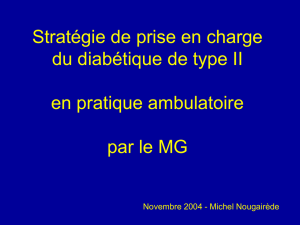Le Diabète Définition

COPIL PRSP MCV – CHU service endocrinologie, maladie métaboliques – 17/12/09
Le Diabète
Le Diabète
1
Définition
Le diagnostic de diabète répond à une définition clinico-biologique : soit une
glycémie veineuse aléatoire supérieure à 2 g /l et des signes cliniques
(amaigrissement, soif intense, fatigue..), soit une glycémie veineuse à jeun
supérieure à 1.26g/l à deux reprises.
Il existe deux principales formes de diabète :
Le diabète de type 1, insulino dépendant, est aussi appelé diabète maigre.
Il survient chez les personnes jeunes et est secondaire à une carence
absolue en insuline. Il concerne 6% des diabétiques. C’est une maladie
particulièrement complexe à gérer, nécessitant un apprentissage de la part
du patient lui permettant d’adapter pluri quotidiennement les injections
d’insuline.
Le diabète de type 2 est aussi appelé diabète non insulino dépendant ou
gras. Il associe, en proportion variable, déficit de la sécrétion de l’insuline
et résistance à l’action de l’insuline et représente plus de 90% de
l’ensemble des diabétiques. Il apparaît principalement après 45 ans. Si son
traitement est le plus souvent médicamenteux par voie orale, les injections
d’insuline sont nécessairement dans certaines situations.
L’OMS qualifie le diabète de fléau épidémique mondial. Sa fréquence est en
augmentation constante en raison de 2 facteurs principaux : le vieillissement de la
population et l’évolution des modes de vie (alimentation et sédentarité).
Le diabète touche actuellement 52 000 auvergnats.

COPIL PRSP MCV – CHU service endocrinologie, maladie métaboliques – 17/12/09
Le Diabète
Le Diabète
2
Etat des connaissances
Déterminants de santé
Généralités
Depuis 1988, la prévalence du diabète a été multipliée par 2. En 2007, elle est
de 3.95% (France entière, tous régimes) et est estimée à 4,5% de la population
à l’horizon 2016 1. Il existe un sur-risque masculin à partir de 40 ans. En 2007,
près d’un homme sur cinq est diabétique à 75 ans 1.
La population diabétique est en moyenne peu aisée financièrement 2. (Source de
comparaison : Enquête revenus fiscaux et sociaux 2006 de l’Insee). Il est
aujourd’hui établi que la précarité chez le diabétique s’associe à une prévalence
plus élevée de complications et à une aggravation des facteurs de risque cardio-
vasculaires 3.
Le diabète de type 2 est découvert lors d’un dépistage pour 67% des personnes
diabétiques, pour 18% à l’occasion de symptômes évocateurs et pour 15% à
l’occasion de la découverte d’une complication 2. Il peut en effet évoluer pendant
plusieurs années sans aucun symptôme.
Association aux autres facteurs de risque cardio-vasculaires
L’étude ENTRED décrit l’association aux autres facteurs de risque cardio-
vasculaires des diabétiques de type 2 en 2007 (France métropolitaine) 2 :
39% Surpoids
41% Obésité
49% HTA
18% Hypercholestérolémie : LDL cholestérol > 1.3g/l
13% Tabac
Au total, le risque vasculaire des personnes diabétiques de type 2, bien qu’en
diminution, reste élevé en 2007. Par rapport aux définitions établies dans les
recommandations de la Haute autorité de santé 2 :
59% ont un risque très élevé
26% un risque élevé
14% un risque modéré
seulement 1% un risque vasculaire faible
En France, la moitié des diabétiques décèdent de complications cardio-
vasculaires 4.

COPIL PRSP MCV – CHU service endocrinologie, maladie métaboliques – 17/12/09
Le Diabète
Le Diabète
3
Complications
L’étude ANTRED 2007 fournit les prévalences des complications du diabète de
type 22 :
20,8% Complication coronariennes
19,0% Insuffisance rénale
0,4% Dialyse ou greffe rénale
7,9% Rétinopathie diabétique
3,9% Perte de la vue d’un œil
2,3% Mal perforant plantaire
En 2007 en France, ces complications ont occasionné plus de 9 000 amputations,
plus de 12 000 hospitalisations pour infarctus du myocarde et près de 3 000
nouveaux cas d’insuffisance rénale terminale5.
Prise en charge des patients diabétiques de type 2
D’importantes améliorations de la qualité du suivi médical ont été observées
entre 2001 et 2007. Cependant en 2007, alors que 56% des diabétiques de type
2 ont un traitement correspondant aux objectifs glycémiques de la Haute
Autorité en Santé (HAS), 44% pourraient bénéficier de l’escalade thérapeutique
recommandée si le mauvais contrôle glycémique persiste 2.
Ces dernières années, la panoplie d’antidiabétiques oraux s’est considérablement
élargie : aux traitements traditionnels (metformine, inhibiteurs des alpha
glucosidases, sulfamides–glinides), ce sont ajoutés de nouvelles molécules
(glitazones et potentialisateurs de l’action du GLP-1) qui ont fait évoluer
rapidement le schéma thérapeutique. Il est aujourd’hui d’usage de proposer au-
delà de la monothérapie l’utilisation d’antidiabétiques oraux se potentialisant
entre eux, en utilisant une bi ou trithérapie puis des combinaisons
antidiabétiques oraux-insuline.
Si la pathologie est bien connue et fait l’objet de recommandations de prise en
charge bien établies, il reste que plusieurs études ont mis en évidence des
insuffisances dans la prise en charge des patients diabétiques2.

COPIL PRSP MCV – CHU service endocrinologie, maladie métaboliques – 17/12/09
Le Diabète
Le Diabète
4
Suivi annuel recommandé
par la HAS
Prestation remboursée en
ambulatoire en 2007
Prestation remboursée
en ambulatoire en 2
ans
9 consultations ou visites
4 dosages d’hémoglobine glyquée
44% ont bénéficié de 3
dosages
1 consultation ophtalmologique
50%
71%
1 bilan dentaire
38%
1 bilan lipidique
76%
86%
1 bilan biologique rénal
83% dosage créatininémie
28% dosage albuminurie
44% dosage
albuminurie
1 bilan électrocardiogramme
39%
57%
En prenant en compte les séjours hospitaliers, on estime que 45% des
diabétiques de type 2 ont eu un ECG ou une consultation de cardiologie et 36%
un dosage d’albuminurie dans l’année 2.
De plus, 39% des patients diabétiques de moins de 65 ans ont une hémoglobine
gliquée (HbA1c, marqueur de l’équilibre glycémique) insuffisamment contrôlée et
supérieure à 7%. Cela les expose à un risque élevé de complications vasculaires
compte tenu de leur longue espérance de vie. Des améliorations thérapeutiques
sont encore nécessaires2.
Alors que le recours au diabétologue est recommandé par la HAS en cas de
déséquilibre persistant, de survenue de complications ou de passage à l’insuline,
en 2007 87% des malades diabétiques sont suivis par les seuls médecins
généralistes sans recours au diabétologue2.
Enjeux économiques
Le remboursement annuel moyen au titre de l’affection longue durée diabète est
estimé en 2007 à 7116 € pour le régime général de l’Assurance maladie6.
L’hospitalisation représente environ 46% des montants remboursés.
Les montants remboursés aux diabétiques auvergnats ont été comparés aux
montants remboursés à l’ensemble de la population. Cette comparaison
s’exprime sous la forme d’un ratio avec au numérateur le montant moyen
remboursé par personne diabétique et au dénominateur le montant moyen
remboursé par personne dans l’ensemble de la population protégée. Les ratios
ont été calculés, pour la région, par poste de dépenses (Tableau I) 7.

COPIL PRSP MCV – CHU service endocrinologie, maladie métaboliques – 17/12/09
Le Diabète
Le Diabète
5
Tableau I : Ratio du montant moyen remboursé par personne diabétique insulino
traitée (DIT) (type 1 et type 2 sous insuline) et non insulino traitée (DNIT) (type
2 sous médicaments par voie orale) sur le montant moyen remboursé dans la
population générale, en 2004.
Honoraires
Pharmacie
Biologie
Soins inf.
Matériel
Transport
Autres
Ambulatoire
Hospit.
Total
DIT
1,8
3,4
3,1
17,2
14,1
4,9
1,7
4,5
3,2
3,9
DNIT
1,3
1,9
2,0
1,4
2,1
1,2
0,9
1,6
1,0
1,3
Leviers reconnus d’intervention
Diagnostiquer le plus tôt possible
Aux Etats-Unis, des études ont montré que le délai moyen entre la découverte
biologique et le diagnostic clinique de diabète de type 2 est de 10 années. Dans
ces conditions, les complications vasculaires commencent à se développer avant
que le diagnostic de diabète de type 2 n’ait été porté, expliquant en grande
partie la morbidité considérable de cette affection8.
En France, parmi les 18-74 ans, environ 20 % des personnes diabétiques ne
seraient pas diagnostiquées. Mais cette proportion diminue fortement avec l’âge
passant de 30 % chez les 30-54 ans à 13 % chez les 55-74 ans5.
Les recommandations proposent de doser la glycémie veineuse tous les trois ans
à partir de l’âge de 45 ans. Les contrôles peuvent être rapprochés ou plus
précoces si la personne présente des facteurs de risque de diabète de type 2 :
apparentée au premier degré de sujets diabétiques, migrants, population
précaire, femme ayant présenté un diabète gestationnel ou ayant accouché d’un
enfant macrosome, sujets obèses, dyslipidémiques, hypertendus,
hyperglycémique à jeun9.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%