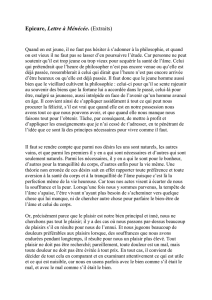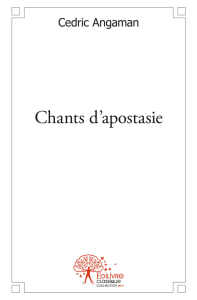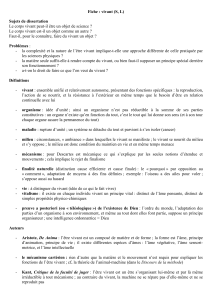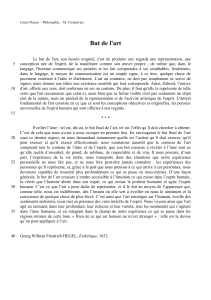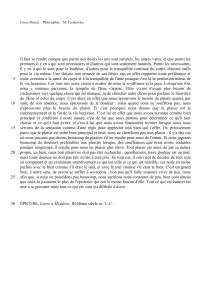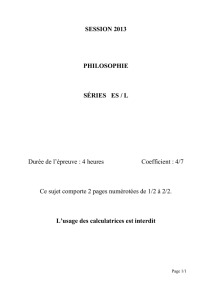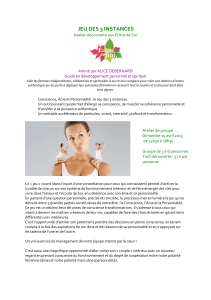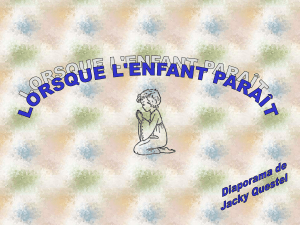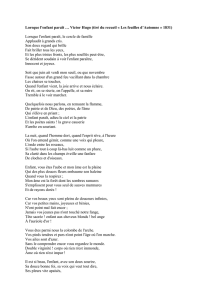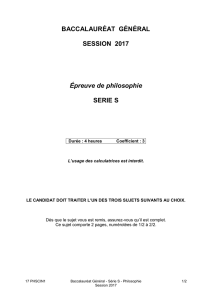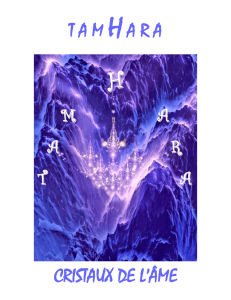l`Ecole des femmes 2. Morale et comédie

— THE UNIVERSITY OF CHICAGO, SPRING 2013 —
Comedy, immorality and theatricality: Molière
April 9
Molière, L'École des femmes (Guest : Patrick Dandrey)
« Morale et comédie »
1 — Morale de la Nature et de la « dénaturation »
a) Agnès ou l’éveil de la nature
L’expérience de la passion : de la Nature au naturel par l’éducation et la civilisation des mœurs.
L'amour en Agnès fait jaillir quelques éclairs de la pure nature, profonde, spontanée, non
pervertie ; son beau naturel, effet d'une personnalité heureusement dotée par la Nature, les féconde
pour vaincre les opacités de la nature brute et grossière qu'on a laissé envahir son être en lui
refusant l'accès aux signes civilisateurs qui confortent, charpentent, trient et canalisent, tantôt
redressant les impulsions de l'âme, tantôt s'y opposant, tantôt les assumant en les perfectionnant
par l'application de règles forgées au plus près de la nature.
Leçon de tout ceci : la “ nature ” est un magma informe, indispensable et insuffisant ; la “ pure
nature ” suscite un éclair, fulgurant et pur, qui fait signe ; et le “ naturel ” constitue un filtre qui
conserve et par transparence révèle ce que le fond d'âme de chacun a de meilleur, après en avoir
corrigé les défauts incompatibles avec la vie sociale et nuisibles à l'harmonie intime : cette
correction constitue l'édification de soi, dont l'effet est l'élaboration d'un naturel devenu seconde
nature. L'homme doit se constituer en somme un naturel “ vraisemblable ”, comme celui de
l'œuvre d'art : l'édification de l'être humain est modelée sur le principe de la création
esthétique.Amour comme grammaire civilisatrice des mœurs et sentiments, éthique de la
transparence. celle des signes intérieurs, affectifs, qui doivent traduire l’intimité en termes de
sociabilité, et celle des signes d’usage social, de civilité, qui aident chacun à fabriquer son
intimité, à féconder son être intérieur. Il y faut en somme des signes qui transcrivent sans la trahir
la langue muette de l’âme, en même temps qu’ils canalisent et civilisent ses jaillissements
impulsifs.
En résumé, la « pure nature » se manifeste par l’intrusion rare, spontanée et instantanée dans les
belles âmes, à de certains moments cruciaux, de quelques intuitions puissantes et absolument
pures : on ne peut fonder une vie sur ces éclairs illuminants ; ils font signe et indice, et c’est tout.
Les « obstacles de la nature », ce sont les menaçantes injonctions de la bête en nous, les désirs
brutaux, la passivité lymphatique, le laisser-aller à la pente, aux désordres et à la démesure : ils
demeurent en deçà de la sémiologie de l’âme. Le « naturel » plus ou moins « beau » de chacun,
enfin, peut s’entendre comme le résultat original, personnel, de la tension entre ces forces
opposées, effet de la bestialité corrigée par la civilisation selon la qualité d’âme qui est échue à
chacun en partage, selon les heureuses intuitions dont la pure nature l’a plus ou moins gratifié :
c’est ici que doit jouer la plus pure transparence et la plus exacte propriété des signes de

convention donnant forme aux impulsions informes de la nature, canalisées par l’intuition et
l’éducation.
L’éthique et l’esthétique de soi : un idéal de perfection accomplie dans l’amour
b) Arnolphe : une imagination malade
Une idée fixe, la hantise du cocuage et chimère du mariage, hantises de l’image. Deux images :
répulsion pour cocuage et fascination narcissique pour le mariage qui lui apporterait le bonheur de
se mirer dans les yeux d’une femme qu’il ne « prend que pour lui ». Piège de l’illusion exprimée
par l’extravagance revendiquée, décalage entre image et réalité de soi d’où incompréhension du
phénomène qu’il vit. Marotte d’une femme stupide = frigide. Cette perversion peut bien prendre
tour à tour les couleurs d’une obsession malsaine, d’un plan absurde, d’un projet d’éducation
mutilant, d’une prudence et d’une surveillance extravagantes, d’une fureur passionnelle et cruelle
enfin : en tout cela, à chacune de ces étapes, on voit bien que l’artifice le dispute à la difformité ;
et tous deux sont également les ennemis jurés de la nature, de la nature entendue dans un cas
comme pure naïveté, dans l’autre comme parfaite et harmonieuse mesure.
Or non seulement l’intervention d’Horace fait échouer la combinaison qu’il avait tramée de ces
fantasmes à la fois liés et incompatibles, mais la courbe de l’intrigue amène leur exacerbation
réciproque, le désir de mariage se métamorphosant en passion amoureuse, la hantise du cocuage
devenant réalité avant même la bénédiction de leur union.
C’est ainsi que le conflit à l’intérieur de son idée fixe entre les deux images qui la composent finit
par placer le personnage, au dernier acte, en situation de suspension et d’angoisse — on dirait
aujourd’hui en « inhibition de l’action » : le tyran dessaisi, le héros parodique, le tuteur foudroyé,
caricature de héros tragique.
2 — Raison et déraison comiques : portrait de Chrysalde en poète comique.
a) Un personnage sémaphore
Ses apparitions : exposition et acmé, dénouement. Sagesse des nations (prudence) et paradoxe
(consolation). Virtuosité sophistique, sens de la relativité, éloge paradoxal du cocuage.
Sa fonction : relativiser. Débusque contradictions d’Arnolphe. Au lieu de se limiter à professer des
vérités rationnelles, le raisonneur s’attache plutôt à les délivrer de l’opacité pour opposer leur
transparence lumineuse à l’ombre dans laquelle, face à lui, se complet l’extravagant aux conduites
ridicules : le raisonneur a donc partie étroitement liée avec le ridicule. Tandis que le rire délivre un
jugement d’intuition sur les comportements déviants et absurdes, le raisonneur en débusque, en
déploie, en éclaire les contradictions qui suscitent l’hilarité : lucide, il transperce les obscurités de
l’âme égarée ; il les expose, au sens photographique du terme ; il instruit, au sens juridique du
terme. Le raisonneur élabore la vérité plus qu’il ne l’expose, et la confronte plus qu’il ne
l’impose.
b) Une métaphore de la comédie
Situation du poète comique : école de lucidité, sagesse de la vérité, distinctions, prend plutôt
modèle sur l’ironie socratique que sur les longues « chaînes de raisons » cartésiennes : son
universalité embrasse le dérisoire autant que l’essentiel, s’arrête et s’applique aux problèmes du
cocuage aussi bien qu’aux interrogations métaphysiques sur l’existence de Dieu. En quoi elle
constitue en quelque sorte une projection analogique à la scène de l’activité fureteuse du poète
dramatique observant la société de son temps, sans préjugé, sans axe ni domaine privilégiés, sans

définir non plus de domaine réservé, dans la seule optique du ridicule, perpétuellement réadaptée
aux sujets et aux contextes.
Castiglione opposant à l’affettazione à la grâce appropriée de la sprezzatura, ou Montaigne
laudateur de l’ariston metron (la juste mesure) n’avaient fait que relayer vers les temps modernes
l’idéal de l’antique paideia. On sait que celle-ci s’entendait comme une ascèse aimable guidée par
l’intuition plus que par la règle, fondée sur une pratique raisonnée (chrisis) des plaisirs moraux et
sociaux (aphrodisia) et sur une pratique de soi conduisant à la maîtrise du moi (enchratéia)
conçue elle aussi comme forme supérieure de beauté morale.
Cette maîtrise de soi et cette gestion avisée des plaisirs de la société qui à la fois la féconde,
l’exerce et la prouve, la génération classique les retrouve dans les notions de « convenance » et de
« civilité » qui désignent l’une l’art de s’approprier sa personne, de se saisir de son moi, l’autre
celui d’approprier la conduite du moi ainsi conquis aux situations et aux êtres dans la perspective
du plaisir social confondu avec le plaisir personnel. Cet idéal s’épanouit alors dans le cadre d’une
esthétique et d’une éthique de la « tempérance », équivalent de l’antique sphorosyné.
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
FOUCAULT, Michel, L'Usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, rééd. « Tel », 1997.
1
/
3
100%