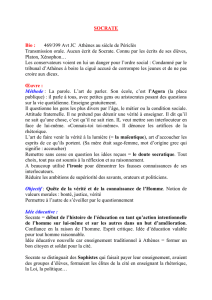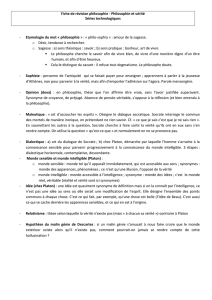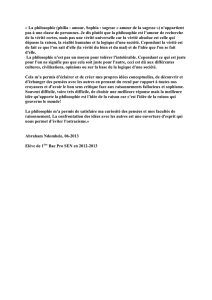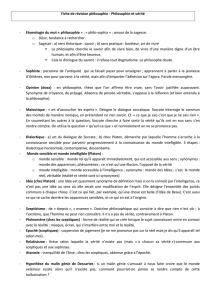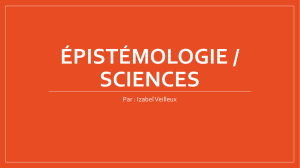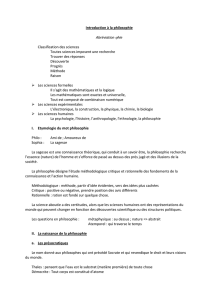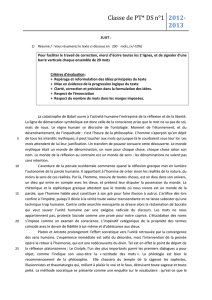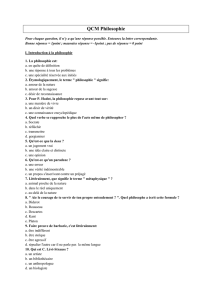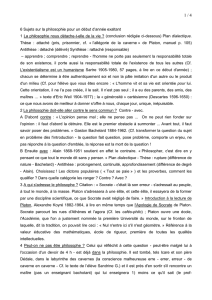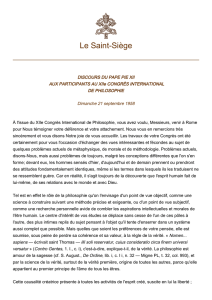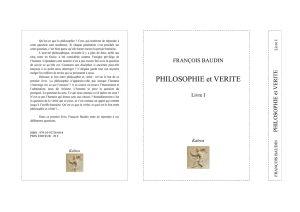Chapitre 0.1 : Le philosophe et la vérité

Séquence 0 Chapitre 0.1 : Le philosophe et la vérité - documents
Le philosophe en méditation, Rembrandt
Texte 1 : Le point de départ de la philosophie
Voici le point de départ de la philosophie : la conscience du conflit qui met aux prises les hommes entre eux, la recherche
de l’origine de ce conflit, la condamnation de la simple opinion et la défiance à son égard, une sorte de critique de
l’opinion pour déterminer si on a raison de la tenir, l’invention d’une norme, de même que nous avons inventé la balance
pour la détermination du poids, ou le cordeau pour distinguer ce qui est droit et ce qui est tortu.
Est-ce là le point de départ de la philosophie : Est juste tout ce qui paraît tel à chacun ? Et comment est-il possible que les
opinions qui se contredisent soient justes ? Par conséquent, non pas toutes. Mais celles qui nous paraissent à nous
justes ? Pourquoi à nous plutôt qu’aux Syriens, plutôt qu’aux Egyptien ? Plutôt que celles qui paraissent telles à moi ou à
un tel ? Pas plus les unes que les autres. Donc l’opinion de chacun n’est pas suffisante pour déterminer la vérité.
Epictète, Entretiens, II
Texte 2 : Les quatre questions de la philosophie
S’agissant de la philosophie selon son sens cosmique 1 (in sensu cosmico), on peut aussi l’appeler une science des
maximes suprêmes de l’usage de notre raison, si l’on entend par maxime le principe interne du choix entre différentes
fins.
Car la philosophie en ce dernier sens est même la science du rapport de toute connaissance et de tout usage de la raison
à la fin ultime de la raison humaine, fin à laquelle, en tant que suprême, toutes les autres fins sont subordonnées et dans
laquelle elles doivent être toutes unifiées.
Le domaine de la philosophie en ce sens cosmopolite se ramène aux questions suivantes
1. Que puis-je savoir ? 2. Que dois-je faire ? 3. Que m’est-il permis d’espérer ? 4. Qu’est-ce que l’homme ?
A la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième
l’anthropologie.
Mais au fond, on pourrait tout ramener à l’anthropologie, puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière.
Le philosophe doit donc pouvoir déterminer
1. la source du savoir humain, 2. l’étendue de l’usage possible et utile de tout savoir, et enfin 3. les limites de la
raison.
Cette dernière détermination est la plus indispensable, c’est aussi la plus difficile, mais le philodoxe ne s’en préoccupe
pas.
Emmanuel Kant, Logique.
NB : philodoxe : mot créé par Kant. Etymologiquement : l'amateur d'opinions.
1

Texte 3 : L'allégorie de la Caverne
SOCRATE - Après cela compare notre nature, sous le rapport de l'éducation et de l'absence d'éducation, à un état du genre
de celui que je vais te décrire. Représente-toi ceci : des hommes vivant dans une demeure souterraine en forme de
caverne; elle possède une entrée ouverte à la lumière et s'étendant sur tout la longueur de la caverne. Ces hommes y
séjournent depuis .leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils restent là et qu'ils peuvent seulement voir
ce qui est en face d'eux car, étant enchaînés ils sont impuissants à tourner la tête; une lumière leur est dispensée, celle.
d'un feu brûlant loin derrière eux et au-dessus d'eux. Entre le feu et les prisonniers, représente-toi à une certaine
hauteur .un chemin le long duquel un petit mur a été construit, pareil à ces panneaux que les montreurs de marionnettes
interposent entre eux et les spectateurs, et au-dessus desquels ils montrent leurs tours prestigieux.
GLAUCON - Je vois.
SOCRATE - Alors vois aussi, défilant le long de ce petit mur, des hommes portant toutes sortes d'objets fabriqués qui
dépassent du mur, statues s de forme humaine et aussi animaux en pierre ou en bois et choses façonnées dans toutes
les formes possibles; comme on pouvait s'y attendre, parmi ces porteurs qui défilent certains parlent et d'autres se taisent.
GLAUCON – C’est une image étrange que tu décris là et de bien étranges prisonniers.
SOCRATE – Ils sont semblables à nous. Pour commencer, en effet, crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que
ce soit d’autre, d’eux-mêmes et les uns des autres, si ce ne sont les ombres qui, sous l’effet du feu, se projettent sur la
paroi de la grotte en face d’eux ?
GLAUCON – Comment auraient-ils pu, puisqu’ils ont été contraints, tout au long de leur vie, de garder la tête immobile ?
Socrate — Et en ce qui concerne les objets transportés ? N’est-ce pas la même chose ?
GLAUCON — Bien sûr que si.
SOCRATE — Alors, s’ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu’ils considéreraient comme des
êtres réels les choses qu’ils voient ?
GLAUCON — Si, nécessairement.
SOCRATE — Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d’en face ? Chaque fois que
l’un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu’ils penseraient que ce qui l’émet est autre chose que l’ombre qui
passe ?
GLAUCON — Non, par Zeus, je ne le crois pas.
SOCRATE — Dès lors de tels hommes considéreraient que le vrai n’est absolument rien d’autre que l’ensemble des
ombres des objets fabriqués.
GLAUCON — Très nécessairement.
SOCRATE — Examine alors ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement,
au cas où de façon naturelle les choses se passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l’un d’eux serait détaché,
et serait contraint de se lever subitement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces
gestes il souffrirait, et l’éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont il voyait auparavant les ombres ;
que crois-tu qu’il répondrait, si on lui disait que tout à l’heure il ne voyait que des sottises, tandis qu’à présent qu’il se
trouve un peu plus près de ce qui est réellement, et qu’il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement ?
Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu’elle est, en le contraignant à répondre
? Ne crois-tu pas qu’il serait perdu, et qu’il considérerait que ce qu’il voyait avant était plus vrai que ce qu’on lui montre à
présent ?
GLAUCON — Bien plus vrai.
SOCRATE — Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n’aurait-il pas mal aux
yeux, et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu’il est capable de distinguer, en considérant ces dernières
comme réellement plus nettes que celles qu’on lui montre ?
GLAUCON — C'est le cas.
SOCRATE — Et si on l’arrachait de là par la force en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait
pas avant de l’avoir tiré dehors jusqu’à la lumière du soleil, n’en souffrirait-il pas, et ne s’indignerait-il pas d’être traîné de
2

la sorte ? Et lorsqu’il arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l’éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu’une
seule des choses qu’à présent on lui dirait être vraies ?
GLAUCON — Non, il ne le serait pas, en tout cas pas tout de suite.
SOCRATE — Oui, je crois qu’il aurait besoin de s'habituer pour voir les choses de là-haut. Pour commencer ce seraient les
ombres qu’il distinguerait plus facilement, et après cela, sur les eaux, les images des hommes et celles des autres réalités
qui s’y reflètent, et plus tard encore ces réalités elles-mêmes. À la suite de quoi il serait capable de contempler plus
facilement, de nuit, ce qui se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même, en tournant les yeux vers la lumière des astres et de
la lune, que de regarder, de jour, le soleil et la lumière du soleil.
GLAUCON— Forcément.
SOCRATE — Alors je crois que c’est seulement pour finir qu’il se montrerait capable de distinguer le soleil, non pas ses
apparitions sur les eaux ou en un lieu qui n’est pas le sien, mais lui-même en lui-même, dans la région qui lui est propre,
et de le contempler tel qu’il est.
GLAUCON— Nécessairement.
SOCRATE — Et après cela, dès lors, il conclurait, grâce à un raisonnement au sujet du soleil, que c’est lui qui procure les
saisons et les années, et qui régit tout ce qui est dans le lieu du visible, et qui aussi, d’une certaine façon, est cause de
tout ce qu’ils voyaient là-bas.
GLAUCON— Il est clair que c’est à cela qu’il en viendrait ensuite.
SOCRATE — Mais dis-moi : ne crois-tu pas que, se souvenant de sa première résidence, et de la "sagesse" de là-bas, et
de ses compagnons de prison d’alors, il s’estimerait heureux du changement, tandis qu’eux il les plaindrait ?
GLAUCON — Si, certainement.
SOCRATE — Les honneurs et les louanges qu’ils pouvaient alors recevoir les uns des autres, et les privilèges réservés à
celui qui distinguait de la façon la plus précise les choses qui passaient, et se rappelait le mieux lesquelles passaient
habituellement avant les autres, lesquelles après, et lesquelles ensemble, et qui sur cette base devinait de la façon la plus
efficace laquelle allait venir, te semble-t-il qu’il aurait du désir pour ces avantages-là, et qu’il jalouserait ceux qui, chez ces
gens-là, sont honorés et exercent le pouvoir ? ou bien qu’il éprouverait ce dont parle Homère, et préférerait de loin,
« étant aide-laboureur, être aux gages d’un autre homme, un sans-terre », et subir tout au monde plutôt que se fonder
ainsi sur les opinions, et vivre de cette façon-là ?
GLAUCON — Je le crois pour ma part : il accepterait de tout subir, plutôt que de vivre de cette façon-là.
SOCRATE — Alors représente-toi aussi ceci. Si un tel homme redescendait s’asseoir à la même place, n’aurait-il pas les
yeux emplis d’obscurité, pour être venu subitement du plein soleil ?
GLAUCON — Si, certainement, dit-il.
SOCRATE — Alors s’il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces
hommes-là qui n’ont pas cessé d’être prisonniers, au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis,
et alors que le temps nécessaire pour l’accoutumance serait loin d’être négligeable, ne prêterait-il pas à rire, et ne ferait-il
pas dire de lui : pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés ? Et encore : ce n’est même pas la
peine d’essayer d’aller là-haut ? Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en-haut, s’ils pouvaient
d’une façon ou d’une autre s’emparer de lui et le tuer, ne le tueraient-ils pas ?
GLAUCON — Si, certainement.
Platon, Livre VII, La République
3

Texte 4 : L'oreille cassée, un réel insaisissable
Venons-en à l'album qui pousse le plus loin la mise en abyme du réel par la prolifération des doubles : je veux parler de
L'Oreille cassée (…). Tintin se lance à la recherche de l'original du fétiche à l'oreille cassée, et découvre des doubles
toujours plus nombreux sur son chemin. L'intrigue est incroyablement complexe et, d'ailleurs, l'album ne l'élucide pas
intégralement. Ainsi, le fétiche original provient d'Amazonie et est exposé au musée ethnographique ; il a une oreille
cassée. Un certain Tortilla le vole (car il contient un diamant) pour en faire exécuter un double par un sculpteur, un
dénommé Balthazar. Ensuite, Tortilla assassine Balthazar et replace la copie (identique mais sans oreille cassée) au
musée ; il part avec ce qu'il croit être l'original. Mais voici qu'on découvre que l'exemplaire de Tortilla est aussi un faux !
L'original, c'est le frère de Balthazar (qui s'appelle lui-même… Balthazar) qui le possède, lequel exerce aussi le métier de
sculpteur et se met à reproduire la statuette à une échelle industrielle (avec oreille cassée), pour la commercialiser. Par
ailleurs, sans savoir que l'original contient un diamant, ce second Balthazar le revend à un riche collectionneur américain.
(…)
Du point du philosophique, il est possible de construire deux types de lectures diamétralement opposées de L'Oreille
cassée. Si vous vous situez dans la lignée des philosophies idéalistes, c'est-à-dire de tous ceux qui, de Platon à Hegel,
voient dans le réel le règne du faux et recherche l'Idée vraie, vous aurez une interprétation assez classique de cet album.
Pour vous, le fétiche original sera le Vrai, le Réel, la Chose en soi, le Modèle et tous les autres fétiches ne serons que
fausseté et contrefaçon. Vous dénoncerez donc les doubles comme autant d'artefacts, de mensonges, au profit de
l'original qui seul vous paraitrait authentique. Si maintenant vous vous situez dans la perspective qui est la mienne, c'est-
à-dire si vous vous intéressez à la « densité du réel » beaucoup plus qu'à « l'éclat du vrai », alors vous direz qu'aucun
fétiche ne peut être tenu pour l'original ou encore qu'ils participeraient tous – le premier exemplaire d'Amazonie, les
doubles du premier Balthazar (sans oreille cassée), les copies du second Balthazar (avec oreille cassée) – du même
ordre de réalité, du même quotidien, de la même banalité. La philosophie du réel qui est la mienne voit dans le quotidien,
aussi répétitif et banal soit-il, toute l'originalité du monde. S'il n'y a que des doubles, il n'y a pas d'originaux ; inversement,
tous les doubles sont des originaux : voilà la conception métaphysique à laquelle je souscris. Quant à Hergé, je pense
qu'il adhérait lui aussi à une sorte de philosophie du réel, et ce ce que signifie la conclusion ironique de l'album : au
moment où Tintin va s'emparer du fétiche original, il tombe et il se brise. Moralité : l'original n'existe pas, et s'il existait, il
serait insaisissable. On ne peut pas s'emparer de la Chose en soi, de l'Idée, du Modèle, de l'Objet original, et si nous
croyons un instant les saisir, ils nous glissent entre les mains.
Clément Rosset, « Les aventures du réel », in Philosophie magazine (sept. 2010), Hors série, p.62
Texte 5 : La vérité s'oppose à l'opinion
Contrairement à l'idée selon laquelle la vérité doit être universellement admise par tous les hommes, le personnage de
Protagoras défend l'idée que toutes les opinions sont vraies, qu'il est possible de dire « A chacun sa vérité ». L'extrait
suivant expose les arguments qu'il donne pour faire de l'homme « la mesure de toute chose ».
Car j’affirme, moi, que la vérité est telle que je l’ai définie, que chacun de nous est la mesure de ce qui est et de ce qui
n’est pas, mais qu’un homme diffère infiniment d’un autre précisément en ce que les choses sont et paraissent autres à
celui-ci, et autres à celui-là. Quant à la sagesse et à l’homme sage, je suis bien loin d’en nier l’existence ; mais par
homme sage j’entends précisément celui qui, changeant la face des objets, les fait apparaître et être bons à celui à qui ils
apparaissaient et étaient mauvais. Et ne va pas de nouveau donner la chasse aux mots de cette définition ; je vais
m’expliquer plus clairement pour te faire saisir ma pensée. Rappelle-toi, par exemple, ce qui a été dit précédemment, que
les aliments paraissent et sont amers au malade et qu’ils sont et paraissent le contraire à l’homme bien portant. Ni l’un ni
l’autre ne doit être représenté comme plus sage — cela n’est même pas possible — et il ne faut pas non plus soutenir que
le malade est ignorant, parce qu’il est dans cette opinion, ni que l’homme bien portant est sage, parce qu’il est dans
l’opinion contraire. Ce qu’il faut, c’est faire passer le malade à un autre état, meilleur que le sien.
Platon, Le Théétète, 166d
4

Texte 6 : L'évidence comme critère de vérité
Mais il est certain que nous ne prendrons jamais le faux pour le vrai tant que nous ne jugerons que de ce que nous
apercevons clairement et distinctement, parce que Dieu n'étant point trompeur, la faculté de connaître qu'il nous a donnée
ne saurait faillir, ni même la faculté de vouloir, lorsque nous ne l'étendons point au delà de ce que nous connaissons. Et
quand même cette vérité n'aurait pas été démontrée, nous sommes naturellement si enclins à donner notre consentement
aux choses que nous apercevons manifestement, que nous n'en saurions douter pendant que nous les apercevons de la
sorte.
Il y a même des personnes qui en toute leur vie n'aperçoivent rien comme il faut pour en bien juger; car la connaissance
sur laquelle on peut établir un jugement indubitable doit être non seulement claire, mais aussi distincte. J'appelle claire
celle qui est présente et manifeste à un esprit attentif; de même que nous disons voir clairement les objets lorsque étant
présents ils agissent assez fort, et que nos yeux sont disposés à les regarder; et distincte, celle qui est tellement précise
et différente de toutes les autres, qu'elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère
comme il faut.
Par exemple, lorsque quelqu'un sent une douleur cuisante, la connaissance qu'il a de cette douleur est claire à son égard,
et n'est pas pour cela toujours distincte, parce qu'il la confond ordinairement avec le faux jugement qu'il fait sur la nature
de ce qu'il pense être en la partie blessée, qu'il croit être semblable à l'idée ou au sentiment de la douleur qui est en sa
pensée, encore qu'il n'aperçoive rien clairement que le sentiment ou la pensée confuse qui est en lui. Ainsi la
connaissance peut être claire sans être distincte, et ne peut être distincte qu'elle ne soit claire par même moyen.
René Descartes, Principes de la philosophie, 1644
Texte 7 : L'élaboration de l'idée de vrai
La première signification de Vrai et de Faux semble avoir son origine dans les récits ; et l’on a dit vrai un récit, quand le
fait raconté était réellement arrivé ; faux, quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard, les philosophes ont
employé le mot pour désigner l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle idée vraie celle qui montre une chose
comme elle est en elle-même ; fausse, celle qui montre une chose autrement qu’elle n’est en réalité. Les idées ne sont
pas autre chose en effet que des récits ou des histoires de la nature dans l’esprit. Et de là on en est venu à désigner de la
même façon, par métaphore, des choses inertes ; ainsi, quand nous disons de l’or vrai ou de l’or faux, comme si l’or qui
nous est présenté racontait quelque chose sur lui-même, ce qui est ou n’est pas en lui.
Baruch Spinoza, Pensées métaphysiques, 1663.
Texte 8 : Une idée n'est pas vraie, elle est rendue vraie
L'opinion courante, là-dessus, c'est qu'une idée vraie doit être la copie de la réalité correspondante. De même que
d'autres conceptions courantes, celle-ci est fondée sur une analogie que fournit l'expérience la plus familière. Lorsqu'elles
sont vraies, nos idées des choses sensibles reproduisent ces dernières, en effet. Fermez les yeux, et pensez à cette
horloge, là-bas, sur le mur : vous avez bien une copie ou reproduction vraie du cadran. Mais l'idée que vous avez du
« mouvement d'horlogerie », à moins que vous ne soyez un horloger, n'est plus, à beaucoup près au même degré, une
copie, bien que vous l'acceptiez comme telle, parce qu'elle ne reçoit de la réalité aucun démenti. Se réduisît-elle à ces
simples mots, « mouvement d'horlogerie », ces mots font pour vous l'office de mots vrais. Enfin, quand vous parlez de
l'horloge comme ayant pour « fonction » de « marquer l'heure », ou quand vous parlez de « l'élasticité » du ressort, il est
difficile de voir au juste de quoi vos idées peuvent bien être la copie !
Vous voyez qu'il y a ici un problème. Quand nos idées ne peuvent pas positivement copier leur objet, qu'est-ce qu'on
entend par leur « accord » avec cet objet ?
En posant cette question, le pragmatisme voit aussitôt la réponse qu'elle comporte : les idées vraies sont celles que nous
pouvons nous assimiler, que nous pouvons valider, que nous pouvons corroborer de notre adhésion et que nous pouvons
vérifier. Sont fausses les idées pour lesquelles nous ne pouvons pas faire cela. (…) La vérité d'une idée n'est pas une
propriété qui se trouverait lui être inhérente et qui resterait inactive. La vérité est un événement qui se produit pour une
idée. Celle-ci devient vraie : elle est rendue vraie par certains faits. Elle acquiert sa vérité par un travail qu'elle effectue,
par le travail qui consiste à se vérifier elle-même, qui a pour but et pour résultat sa vérification.
William James, Le pragmatisme, 1907
5
 6
6
1
/
6
100%