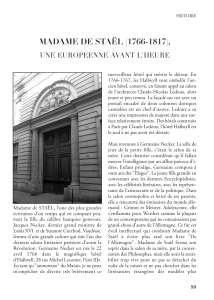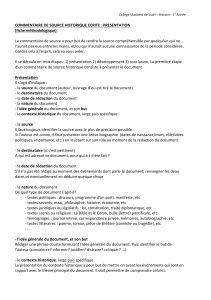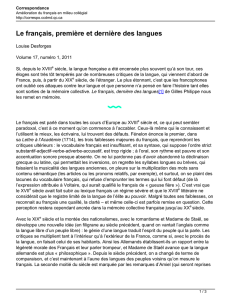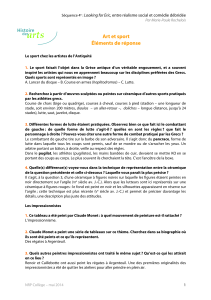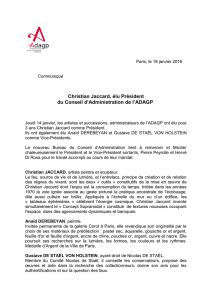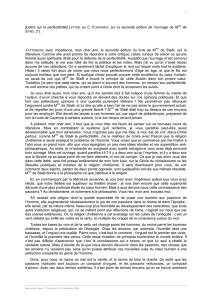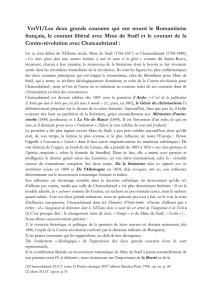Mme de Stael XD - Académie des sciences morales et politiques

!
1!
!
La morale politique de Germaine de Staël
par M. Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l’Académie
séance publique annuelle – 14 novembre 2016
Depuis quelques années, en guise de discours de rentrée, j’ai choisi de procéder à
des adoptions posthumes, en évoquant des personnalités qui auraient mérité de
siéger au sein de notre académie, tant leur œuvre et leur esprit s’accorderaient
avec les centres d’intérêt et avec la raison d’être de notre confrérie. Nous avons
donc croisé dans cette fictive cohorte des auteurs aussi différents que Tacite,
Fénelon ou Péguy. Mais aucune femme encore, alors que l’Académie des sciences
morales et politiques fut la première, en 1971, à recevoir une académicienne
comme membre de l’Institut, par l’élection de Suzanne Bastid. Je vous invite donc
à adouber aujourd’hui Germaine Necker, née il y a tout juste 250 ans, une femme
placée entre deux grands siècles, formée par les raisonneurs de XVIIIe siècle et
source d’inspiration de la vague romantique, et qui fut sous le nom de Madame de
Staël la femme la plus connue de son temps.
Académicienne, celle qui a réuni autour d’elle pendant trente ans le salon le plus
brillant d’Europe aurait mérité de l’être, au sein de la « classe des sciences
morales et politiques » fondée avec l’Institut en 1795, et supprimée en 1803 pour
cause de pensée politique incorrecte, au moment précis où Mme de Staël était
elle-même exilée sur ordre du Premier Consul. Académicienne, elle le fut
pourtant, mais à Rome, où l’Accademia dell’Arcadia la reçut le 14 février 1805. La
Ville éternelle, alors privée de son pape convoqué le 2 décembre à Notre-Dame
pour y voir Napoléon se couronner lui-même, honora sur son Capitole la
protestante chassée de Paris par le nouveau César.
Madame de Staël a laissé un récit amusé de la séance mémorable qui fit d’elle
une « dame pastourelle » de l’Académie d’Arcadie. Venue à Rome pour y écrire
son roman italien, Corinne, elle est invitée par le custode général (l’équivalent du
secrétaire perpétuel) à siéger parmi les Arcadiens. Devant une foule de curieux,
elle subit d’abord la lecture d’un discours sur l’alliance de la poésie et de la
peinture, puis d’un sonnet en latin, puis, raconte-t-elle, « dix jeunes gens tous
déclamant avec une fureur croissante font tomber sur [elle] une pluie ardente de
sonnets ». Enfin elle doit entendre un morceau de son ouvrage De la littérature
qu’un honorable arcadien avait eu la singulière idée de traduire en vers italiens.
En réponse, elle se contente de réciter sa traduction française d’un poème alors
célèbre en Italie, ce qui lui vaut un tonnerre d’applaudissements. Tout se termine
par une soirée chez elle en présence du cardinal Consalvi, secrétaire d’État et
maître de Rome en l’absence de Sa Sainteté. Plaisante vision que ce grand monde
romain, poudré et pourpré, faisant fête à la Genevoise calviniste qui venait de
réaliser, mieux que personne, la vocation donnée trois siècles plus tôt par Erasme
à la ville de Rome : « Aliis alia patria est, Roma communis omnium literatorum et
patria est, et altrix et evectrix ». (D’autres peuvent avoir d’autres patries, pour
tous les lettrés Rome est la patrie commune, nourrice et inspiratrice)

!
2!
!
Ce que la Rome pontificale pouvait se permettre, la France post-révolutionnaire
se l’interdisait. Madame de Staël ne fut donc admise à l’Institut de France qu’à
titre posthume, lorsqu’en 1850, l’Académie française la choisit pour sujet de son
concours d’éloquence – la seconde femme après la marquise de Sévigné à
bénéficier, de cette façon, d’un éloge académique. « L’ennui même de Madame de
Staël respire l’enthousiasme ; son génie c’est l’espérance », déclara dans sa
péroraison le lauréat du concours, Henri Baudrillart, économiste libéral
amoureux des belles-lettres, élu peu après à l’Académie des sciences morales et
politiques, et père du futur cardinal Baudrillart. Mais la gloire est fragile, et cette
même année 1850 eut lieu à l’Académie française une scène assez curieuse, que
Victor Hugo rapporte dans Choses vues. La séance portait sur la définition du
verbe accroître. Un académicien propose un exemple tiré de Madame de Staël :
« La misère accroît l’ignorance et l’ignorance la misère. » Trois objections
surgissent immédiatement, raconte Hugo : « 1° antithèse ; 2° écrivain
contemporain ; 3° chose dangereuse à dire. L’Académie a rejeté l’exemple. »
Le rayonnement intellectuel de Germaine de Staël allait bientôt entrer dans une
longue éclipse. Après la guerre de 1870 et avec la « crise allemande de la pensée
française » qui s’en suivit, bien des auteurs français n’ont plus parlé d’elle qu’avec
une sorte de gêne. Rejet de tout ce qui s’apparentait au romantisme ? Antipathie
pour celle qui se dressa contre Napoléon, le « professeur d’énergie » ? Misogynie
plus ou moins consciente ? Quoi qu’il en soit, pour les nationalistes, l’auteur de
De l’Allemagne ne méritait que trop de s’être prénommée Germaine, et pour les
marxistes, elle restait une baronne, fille d’un banquier richissime.
Aujourd’hui encore, Mme de Staël ne reçoit, dans les livres de littérature, qu’une
place exiguë. On salue qu’elle ait popularisé en France les auteurs allemands,
jusqu'alors méconnus de ce côté du Rhin, ouvrant ainsi la voie au romantisme
français. Plus récemment, on l’a récupérée parmi les pionnières du féminisme. De
fait, ses romans Delphine ou Corinne représentent des femmes victimes des
contraintes sociales et qui tentent de s’en libérer. Ajoutons ses Réflexions sur le
procès de la Reine, plaidoyer en faveur de Marie-Antoinette vue comme une
victime de la brutalité politique masculine, truchement pour s’adresser à toutes
les femmes soumises et pour dénoncer les misères de la condition féminine.
La postérité de Mme de Staël n’en demeure pas moins ardue : les royalistes l’ont
jugée trop libérale, les libéraux trop républicaine, les républicains trop féministe,
les féministes trop royaliste ; elle était trop allemande aux yeux des Français,
trop française aux yeux des Allemands ; trop classique pour les romantiques et
trop romantique pour les classiques ; quant aux bonapartistes, ils la trouvaient à
la fois trop aristocratique, trop cosmopolite, trop indépendante, trop libre en un
mot ; mais tout le monde s’est toujours accordé sur un point, c’est qu’elle était
vraiment trop bavarde.
Ses contemporains brocardaient sans indulgence cette raisonneuse originale et
soûlante, ornée de turbans bizarres et de chapeaux à fleurs, « une machine à
parler », disait même une de ses rivales. Lorsqu’elle rendit visite à Schiller, le
poète allemand s’inquiéta : « Si seulement elle comprend l’allemand, écrivit-il,

!
3!
!
nous prendrons le dessus ; mais s’il faut exposer notre religion intime en phrases
françaises et lutter avec la volubilité française, ce sera vraiment trop rude. » Plus
positif, Sismondi regrettera la voix de Mme de Staël quand elle se sera tue à
jamais, et dira joliment : « La vie est pour moi comme un bal dont la musique a
cessé. »
Elle ne passait pas non plus pour un modèle de beauté féminine. Talleyrand,
après la publication de Delphine eut ce mot cruel : « On dit que Mme de Staël
nous a représentés tous deux dans son roman, elle et moi, tous deux déguisés en
femmes ».
Mais ces cancaneries ne pèsent guère. Mme de Staël a joué à la fois un rôle de
passeur et un rôle de fondatrice, que je voudrais ici rappeler. Lassés des modèles
étatistes ou collectivistes, les penseurs d’aujourd’hui revisitent le courant originel
de la politique moderne que fut le libéralisme européen. Pour comprendre
comment ce courant est devenu, il y a 200 ans, l’un des pivots de la modernité,
celui à partir duquel se définissent tous les grands projets de société, il faut
revenir aux écrits de Mme de Staël et de ses épigones, tel Benjamin Constant et
les membres du groupe dit « de Coppet », du nom de sa propriété où elle animait –
disons-le – une sorte d’académie.
Fille du banquier Jacques Necker (plus tard contrôleur général des finances du
roi Louis XVI), Germaine était « issue de souche réformatrice par son père »,
selon l’habile syllepse de Sainte-Beuve. Par son éducation, elle appartient à
l’Ancien Régime et à la grande histoire des salons du siècle des Lumières. Necker
aimait dîner avec les philosophes, et sa femme recevait dans son salon tout ce qui
gouvernait l’esprit français du temps : Buffon, Marmontel, Grimm, Gibbon,
Raynal, La Harpe et bien d’autres. Il faut imaginer la jeune fille, assise sur un
tabouret aux pieds de sa mère, écoutant les conversations en silence. « Elle se tut
en ces années pour le reste de sa vie », écrit l’un de ses biographes. Le prestige de
son père lui ouvre les portes de ce que l’Europe compte à la fois d'aristocrates et
d'intellectuels éclairés. Mariée l’année de ses vingt ans à l’ambassadeur de Suède
à Paris, le baron de Staël-Holstein, de dix-sept ans son aîné, elle aura désormais
son propre salon, rue du Bac. Disciple de Montesquieu, lectrice passionnée de
Rousseau, marquée par les idées généreuses des Lumières, la jeune ambassadrice
devient, dans ces années fébriles où se préparent la Révolution, la muse des
réformateurs de l’Etat. « La voici reine à Paris de la France qui vient, comme
Marie-Antoinette est reine à Versailles de la France qui s’en va », écrit l’historien
Albert Sorel, qui fut de notre Académie. Elle assiste à l’ouverture des États
généraux et entend inspirer, depuis son salon, le parti des constitutionnels, ceux
qui veulent « placer à la tête de la constitution un roi qui lui devrait le trône, au
lieu d’un roi qui se croirait dépouillé par elle ». Mais les désillusions ne tardent
pas. Quelle place la Révolution laissera-t-elle aux salons politiques, lorsque
l’esprit de faction aura ruiné l’esprit de politesse ? Et surtout, quelle place
restera-t-il aux Cicérons et aux Pompées que Mme de Staël admire tant, lorsque
la France se livrera aux Syllas et aux Césars qu’elle exècre plus que tout ?

!
4!
!
Vite dépassée et bousculée de tous côtés, la salonnière soit s’exiler, en 1793, en
Angleterre. De retour quatre ans plus tard dans le Paris du Directoire, elle
défend le principe d’une république libérale, modérée et pacifique : « Je n’aurais
sûrement pas conseillé d’établir une république en France, avouera-t-elle ; mais
une fois qu’elle existait, je n’étais pas d’avis qu’on dût la renverser. » Elle regarde
l’ascension de Bonaparte avec un mélange de scepticisme et d’espérance. En
janvier 1798, Talleyrand lui ménage une entrevue.
« — Général, quelle est pour vous la première des femmes ?
— Celle qui fait le plus d’enfants, Madame ».
D’emblée, ils se détestent. D’un côté, l’esprit libre et hardi d’une Française déjà
fascinée par l’imagination rêveuse et anglo-saxonne ; de l’autre un génie
méridional tout positif, tout d’action, volontiers malotru. Mme de Staël éprouve
en sa présence, dira-t-elle, « une difficulté de respirer », gênée par son « ironie
profonde, comme une épée froide et tranchante qui glaçait en blessant ».
Elle perd ses dernières illusions après le coup d’État de Brumaire. Lui reprocher
son mépris des femmes ne suffit plus, elle lui reprochera désormais son mépris
des hommes. C’est en pensant à lui qu’elle se flattera plus tard d’avoir inventé le
mot « vulgarité », inconnu des dictionnaires avant elle.
Son salon étant devenu un repaire d’opposants libéraux, Madame de Staël est
chassée de Paris dont elle ne doit plus s'approcher de moins de « quarante
lieues ». Réfugiée à Coppet, elle essaie de trouver une consolation dans sa
relation erratique avec Benjamin Constant, liaison ponctuée de ruptures et de
scènes. Surtout, comme Voltaire à Ferney, elle refuse l’ombre et le silence et
entend rendre son exil éblouissant et sonore. Si l’on en croit le Mémorial de
Sainte-Hélène, Napoléon exilé à son tour ne lui avait toujours pas pardonné : « Sa
demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi ; on venait s’y
faire armer chevalier. Elle s’occupait à me susciter des ennemis, et me combattait
elle-même. »
Elle se lance alors dans la rédaction de romans où la fiction se mêle aux
plaidoyers. Le premier, Delphine, a tout pour déplaire à Napoléon. Dédiée
insolemment à « la France silencieuse », il relate la descente aux enfers d’une
jeune femme intelligente, droite et bonne, qui perd toutes ses illusions sur les
autres et qui voit gâcher par la méchanceté universelle l’amour qu’elle porte à un
homme enfermé lui-même dans les préjugés de sa caste. Mais ce roman est
prétexte à réveiller des questions politiques et sociales issues de la Révolution :
l’émigration, le libéralisme politique, l’anglomanie, la supériorité du
protestantisme sur le catholicisme, le droit au divorce. Le succès européen du
roman s’explique en partie par les critiques virulentes qu’il suscita aux Tuileries.
Longtemps Mme de Staël croira que sa célébrité lui vaudrait une sorte
d’amnistie. Elle mettra des années à comprendre son erreur. Dans le récit de son
exil, elle racontera éloquemment cette joute politico-littéraire, lutte inégale et
disproportionnée. Il faut dire qu’elle ne mâchait pas ses mots, ressassant son
anathème favori : « Un seul homme de moins et le monde serait en repos. »

!
5!
!
Irascible et cynique, l’Empereur, qui ne raisonnait qu’en termes de pouvoir
s’impatientait : « Mais enfin, qu’est-ce qu’elle veut ? »
Question pathétique. Deux siècles plus tard, que pouvons-nous y répondre ? « Il
ne s’agit pas de ce que je veux, mais de ce que je pense », avait répliqué Mme de
Staël. Mais ce n’est qu’une partie du problème, car les idées ne sont pas seules en
cause.
Ce que veut Mme de Staël, c’est d’abord incarner la résistance au pouvoir absolu.
Pour elle, la condition de son travail d’écrivain est la liberté. Or les grands
auteurs du moment sont entrés dans le temps du silence. Benjamin Constant ne
publie plus rien. Chateaubriand est prudent lui aussi, et ne deviendra un
opposant affiché qu’après l’assassinat du duc d’Enghien. Les autres ne font des
livres que pour servir leurs ambitions : « Le parti dominant en France, c’est celui
qui demande des places, accuse Mme de Staël. Se publie-t-il un livre sur la
politique, avez-vous de la peine à le comprendre, vous paraît-il ambigu,
contradictoire, confus ; traduisez-le par ces paroles : je veux être ministre ; et
toutes ces obscurités vous seront expliquées. »
Ce que veut Mme de Staël, c’est penser la place de la littérature dans la société et
dans les mœurs post-révolutionnaires. Et cette partie de son œuvre justifierait à
elle seule sa réception virtuelle et posthume au sein de notre compagnie. Le titre
de son premier grand livre, De la littérature dans ses rapports avec les
institutions sociales, paru en 1800, suffirait comme accréditation. Dans le sillage
de Montesquieu, Mme de Staël examine les rapports entre la littérature, la
morale et les institutions. Il faut entendre littérature au sens le plus large du
mot, ce que nous appelons sciences humaines. Le programme romantique est déjà
là, en germe : retrouver la vigueur des peuples du passé ; valoriser les
littératures du Nord, plus modernes, qui remplaceront les sources antiques ;
réhabiliter le Moyen Age chrétien ; accompagner le progrès de la philosophie et
de l’histoire dans le cadre d’institutions libres et égalitaires ; affirmer, comme
Voltaire, la relativité du goût ; vouloir conjuguer le littéraire et le politique ; d’où
l’importance du théâtre pour éduquer le peuple, et de l’éloquence politique.
Programme immense, visionnaire. Et programme européen.
« Mais enfin, qu’est-ce qu’elle veut ? » criait Napoléon, disions-nous. En fait, il
l’avait bien compris et c’est ce qui le faisait enrager. Mme de Staël ne voulait pas
seulement être une femme indépendante et influente : elle voulait penser en
Européenne, mais une Europe aux antipodes de celle de l’Empereur.
Pour elle, le renouveau des lettres se fera par l’échange des valeurs culturelles et
artistiques. Lever son regard au-delà de limites étroites des habitudes
nationales ; s’obliger à une connaissance plus panoramique et diverse ; franchir
les frontières. Elle sent la nécessité de révéler aux Français l’âme étrangère. Elle
encourage les traductions, qui favorisent la circulation des œuvres et des idées
novatrices. C’est le libéralisme politique appliqué à l’espace littéraire et au
champ artistique. En art comme dans le domaine social, la concurrence est
facteur de dynamisme, d’amélioration, de réforme et de progrès. Principe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%