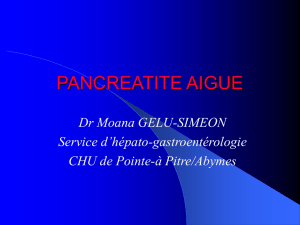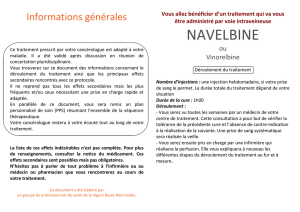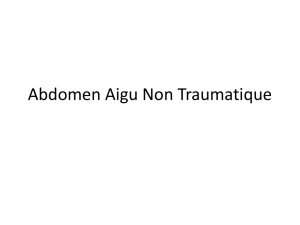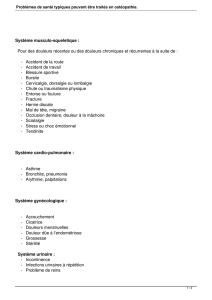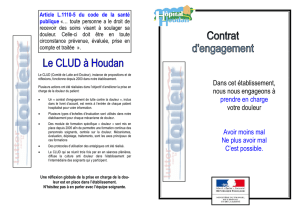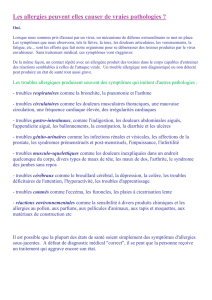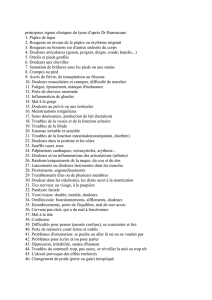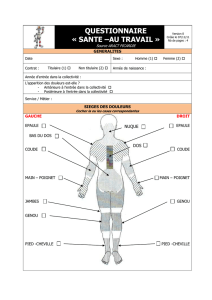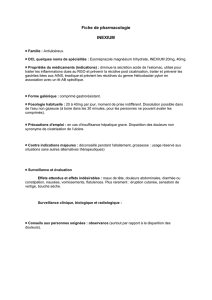Douleursabdominales aiguës hautes : quelle imagerie ?

S. Excoffier
P.-A. Poletti
H. Brandstatter
introduction
Les douleurs abdominales aiguës non traumatiques repré-
sentent environ 10% des consultations dans les centres d’ur-
gences. L’abdomen aigu est défini comme une douleur néces-
sitant un traitement médical ou chirurgical urgent : il est donc
logique de diriger l’imagerie en fonction de la localisation de
cette douleur, comme le précise l’ACR (American College of
Radiology).
Une liste exhaustive des pathologies responsables de dou-
leurs abdominales est répertoriée dans le tableau 1.
Au cours des trois dernières décennies, l’apport de la radiolo-
gie a augmenté, permettant une réduction des interventions
chirurgicales, jadis aussi utilisées à but diagnostique.
Actuellement, l’usage de la radiographie conventionnelle (cou-
ramment appelée «abdomen sans préparation» ou ASP) est
limi té aux douleurs abdominales diffuses, suspectes d’un iléus
ou d’une perforation.1 La dose d’irradiation délivrée par une radiographie abdo-
minale est de 1,4 à 2 mSv ; elle est de 10 mSv pour un CT pour un seul passage.1
A titre informatif, la dose d’irradiation moyenne annuelle reçue par la population
à Genève est de 4 mSv environ.
Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le nombre de CT effectués aux
urgences a augmenté de 500% (dont 33% pour le CT abdominal) de 1999 à 2012,
alors que le nombre des consultations n’a augmenté que de 20%. Les effets indé-
sirables du CT sont l’irradiation et les effets secondaires du produit de contraste
intraveineux (insuffisance rénale et réactions allergiques). Les sujets jeunes sont
plus sensibles aux doses d’irradiation que les patients âgés, alors que ces der-
niers le sont davantage aux effets secondaires néphrotoxiques des produits de
contraste.
L’échographie est un examen rapidement disponible, sans effet indésirable
pour le patient, peu coûteux et facilement transportable. Son interprétation est
cependant dépendante de l’examinateur. Sa sensibilité peut être réduite par la
présence d’un météorisme ou chez les patients obèses.
L’IRM est un examen avec une très bonne discrimination tissulaire, mais d’un
emploi plus difficile (préparation et examen plus longs, collaboration du patient
nécessaire, incompatibilité avec tout objet métallique) et n’est pas forcément
supérieur au CT dans la plupart des pathologies abdominales. Elle peut être
cependant complémentaire au CT dans la recherche d’une cholédocholithiase
(cholangio-IRM).
Acute abdominal pain of the upper
abdomen : which imaging to choose ?
The aim of this article is to review the imaging
modalities to be performed in patients with
acute diffuse upper abdominal pain. Conven-
tional radiography, ultrasound and compute-
rized tomography (CT) are most often used in
this setting. The choice of the initial imaging
technique will depend from the localization
of the pain and the probability of a particular
pathology in the involved area.
Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1710-4
Cet article passe en revue l’imagerie à effectuer en première
intention chez les patients présentant des douleurs abdomi-
nales aiguës de localisation haute. L’abdomen sans prépara-
tion, l’ultrason et le scanner restent les principaux examens
utilisés. Le choix de l’examen radiologique en première inten-
tion dépendra de la localisation de la douleur et tiendra
compte de la fréquence des pathologies rencontrées dans les
différents quadrants abdominaux.
Douleurs abdominales aiguës
hautes : quelle imagerie ?
pratique
1710 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013
Drs Sophie Excoffier et
Hilda Brandstatter
Service de médecine de premier
recours
Dr Pierre-Alexandre Poletti
Unité de radiologie des urgences
Service des urgences
HUG, 1211 Genève 14
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013 0
06_10_37364.indd 1 19.09.13 08:50

1:1.51:1.5
Lactab® 20 mg
sécable
Lactab® 10 mg Lactab® 40 mg
sécable
Lactab® 80 mg
sécable
0613
* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».
Atorvastatine-Mepha® C: 1 Lactab® d’Atorvastatine-Mepha® contient 10/20 /40/80 mg d’atorvastatine. I: Réduction de taux trop élevés de cholestérol total /LDL, d’apolipopro-
téine B et de triglycérides en cas d’hypercholestérolémie primaire, de formes mixtes d’hyperlipidémie, d’hypercholestérolémie familiale, en complément du régime alimen-
taire. Réduction de taux trop élevés de cholestérol total/ LDL en cas d’hypercholestérolémie familiale homozygote, en traite ment adjuvant ou en monothérapie. Prévention
des événements cardiovasculaires en cas de risque élevé de premier événement cardiovasculaire. P: Dose initiale de 10 mg 1 fois par jour, jusqu’à 80 mg par jour au maximum.
Adaptation de la dose toutes les 4 semaines ou plus, en fonction des taux de lipides. Prévention des événements cardiovasculaires: 10 mg 1 fois par jour. CI: Hypersensibilité
au principe actif ou à l’un des excipients conformément à la composition. Maladie hépatique active, augmentation persistante d’origine inexpliquée des transaminases sériques,
cholestase, myopathies. Grossesse/ allaitement. PC: Les tests de la fonction hépatique ASAT(GOT), ALAT(GPT) devraient être réalisés avant le début du traitement, puis à inter-
valles réguliers. Réduire la dose/arrêter le traitement en cas d’élévation persistante de l’ALAT ou de l’ASAT à des taux >3 fois la normale. Consommation élevée d’alcool, anté-
cédents de maladie hépatique, facteurs prédisposant à l’apparition d’un AVC hémorragique ou d’une rhabdomyolyse (diminution de la fonction rénale, association avec ciclospo-
rine, fibrates, érythromycine, niacine ou antimycosiques azolés, ou sensibilité au toucher ou faiblesse musculaire au cours du traitement). Les taux de CPK devraient être mesurés
avant le début d’un traitement par statines en cas de facteurs prédisposants. Arrêt du traitement en cas d’élévation nette (>5 fois la limite supérieure de la normale) des taux
de CPK. EI: Rhinopharyngite, réactions allergiques, hyperglycémie, céphalées, douleurs pharyngées et laryngées, épistaxis, constipation, ballonnements, dyspepsie, nausées,
diarrhée, myalgie, arthralgie, douleurs des extrémités, douleurs musculosquelettiques, crampes musculaires, articulations gonflées, anomalie des tests hépatiques, augmentation
des taux sériques de créatine phosphokinase. IA: Ciclosporine, autres immunosuppresseurs, gem fibrozil /fibrates, acide nicotinique, inhibiteurs du cytochrome P450 3A4, anti-
mycosiques azolés, érythromycine, clarithromycine, antiprotéases (tels que lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir), diltiazem, itraconazole, grandes quantités de jus de pam-
plemousse, inducteurs du CYP3A4 (tels qu’éfavirenz, rifampicine), digoxine, contraceptifs oraux, inhibiteurs de la glycoprotéine P, colestipol, antiacides, warfarine, sulfonylurées,
acide fusidique. Liste: B. [0312]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter www.swissmedicinfo.ch. Vous trouverez d’autres informations sur
Atorvastatine-Mepha® à l’adresse de notre Service Littérature: [email protected]
Mepha Pharma SA, 4010 Bâle, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch
Atorvastatine-Mepha®
La voie à suivre en matière de cholestérol
admis par les caisses maladie
Vous trouverez les données
de bioéquivalence
et le profil de la préparation
sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,
Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*
Dosage de 40 mg,
comprimés désormais
sécables
Les médicaments à l’arc-en-ciel
1006576
1006576_rms_ct.indd 1 14.03.13 17:09

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013 0
douleurs de l’hypochondre droit
Douleurs biliaires
Dans la pratique clinique, il est important de distinguer
une douleur biliaire simple (lithiase vésiculaire symptoma-
tique) d’une douleur biliaire compliquée (migration de
calcul ou cholécystite).
La prévalence de la cholécystite est de 5% parmi les
patients se présentant pour des douleurs abdominales aux
urgences.1 C’est la pathologie la plus fréquente (50-60%)
touchant l’hypochondre droit. Dans plus de 90% des cas, la
cause est un calcul de la vésicule biliaire, enclavé dans le
canal cystique ou le collet de la vésicule.2
Environ 10-15% de la population occidentale serait por-
teuse de calculs biliaires, dont seuls 1-4% deviendraient
symptomatiques.3 La douleur de la colique biliaire est de
type viscéral et le résultat d’un spasme du canal cystique.
Elle est d’abord ressentie au niveau de l’épigastre et peut
irradier dans l’épaule droite. Environ 75% des patients qui
présentent une cholécystite aiguë ont des antécédents de
colique biliaire. La symptomatologie de la colique biliaire
simple dure moins de six heures. Les douleurs sont sou-
vent précipitées par un repas riche en graisses, qui stimule
la contraction de la vésicule biliaire via la libération de
cholécystokinine.2 Si la douleur dure plus de six heures,
une cholécystite est suspectée. Après six heures, la stase
biliaire et la surinfection bactérienne engendrent une in-
flammation de la paroi, avec ischémie et nécrose secon-
daires potentielles.
L’examen physique montre une défense localisée et un
signe de Murphy positif. On retrouve une leucocytose et
fréquemment une élévation de la phosphatase alcaline et
des transaminases. Le traitement de choix dans le cas d’une
cholécystite aiguë est la cholécystectomie dans les 72 heures
après le début des symptômes.
Selon l’ACR, l’échographie est la modalité la plus appro-
priée pour différencier une douleur biliaire simple d’une
douleur biliaire compliquée et poser un diagnostic de cho-
lécystite. L’ultrason permet de mettre en évidence les
signes suivants de cholécystite : distension de la vésicule
biliaire, boue biliaire
(sludge)
ou calcul intraluminal, épais-
sissement de la paroi avec aspect feuilleté dû à l’œdème,
liquide libre autour de la vésicule biliaire et signe échogra-
phique de Murphy. Ses sensibilité et spécificité atteignent
jusqu’à 83 et 95%, respectivement.4 A noter qu’un épaissis-
sement de la paroi vésiculaire peut survenir dans certaines
situations cliniques (ascite, hypoprotéinémie, VIH, hépa-
tite…). Il est important d’intégrer ces paramètres avant de
poser le diagnostic de cholécystite. L’échographie est un
examen plus sensible que le CT pour détecter des calculs
vésiculaires. Toutefois, les calculs cholédociens sont sou-
vent non détectables à l’échographie, car ils peu vent être
masqués par des gaz ou être trop petits pour être vus. Pour
cette raison, l’absence de visualisation de calculs cholédo-
ciens à l’échographie (ou au CT) ne permet pas d’exclure
une lithiase. En cas de dilatation des voies biliaires sans
obstacle détecté à l’échographie ou au CT, le choix de l’exa-
men complémentaire à effectuer dépend de la situation
clinique : 1) en situation d’urgence (obstruction aiguë avec
besoin de traitement immédiat), l’ERCP (cholangiopancréa-
tographie rétrograde endoscopi que) peut être associée au
traitement médical et 2) en cas d’impossibilité technique
de réaliser une ERCP (anastomose biliodigestive ou sté-
nose du canal digestif supérieur), la cholangiographie per-
cutanée avec un geste de drainage ou de désobstruction
peut être recommandée. Dans des situations électives, le
bilan peut parfois être complété par une cholangiographie
par IRM.
douleurs abdominales diffuses
et épigastriques
Occlusion intestinale et perforation d’organe
L’ASP peut être réalisé en première intention dans les
douleurs abdominales diffuses suggérant une occlusion in-
testinale ou une perforation d’organe, car cette imagerie
est facilement accessible et peut rapidement orienter le
diagnostic. On doit cependant souvent compléter l’examen
par un CT, afin de mettre en évidence la cause exacte de
l’obstruction ou de la perforation. Les signes radiologiques
classiques d’iléus sont les niveaux hydro-aériques (L 3) et
la distension de l’intestin grêle sur le cliché réalisé en po-
sition débout.2 Ils peuvent être absents en cas d’occlusion
du duodénum ou du grêle proximal.
Lors d’une perforation, on retrouve parfois de l’air sous-
1712 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013
HCD • Biliaire (cholécystite, cholédocholithiase, colique
biliaire, cholangite)
• Hépatique (hépatite, néoplasie, abcès, foie de stase,
syndrome de Budd-Chiari, périhépatite de Fitz-Hugh-
Curtis)
• Paroi abdominale (musculaire, zona, radiculite)
• Ulcère perforé
• Pulmonaire (pneumonie, pleurésie, pneumothorax)
• Pathologie du côlon (colite, tumeur, diverticulite,
appendicite rétrograde)
• Rénale (pyélonéphrite, stase, infarcissement, lithiase)
HCG • Rate : infarctus splénique, traumatisme
• Pancréas : pancréatite, néoplasie
• Maladie pulmonaire : pneumonie, abcès sous-phrénique,
embolie pulmonaire, pneumothorax
• Estomac (comme épigastre/milieu)
• Radiculite
• Côlon descendant/angle splénique : colite ischémique
segmentaire
Epigastre/ • Etiologies cardiaques : ischémie, IM inférieur, péricardite
milieu • Ischémie ou infarctus du myocarde inférieur :
dissection, anévrisme de l’aorte abdominale, angor
abdominal
• Œsophage : reflux, infections
• Estomac : gastrite aiguë, ulcère perforé ou non, tumeur,
trouble de la vidange
• Paroi : hernie, compression nerveuse
• Toutes les étiologies biliaires
• Pancréas : tumeurs, pancréatite
Douleur Péritonite, iIéus obstructif, ischémie mésentérique,
diffuse anévrisme aortique en cours de rupture, porphyrie,
urémie, acidocétose diabétique, hypercalcémie, hématome
rétropéritonéal, fièvre méditerranéenne, gastroentérite,
IBD, crise hémolytique, angiœdème héréditaire, sevrage
d’opiacés, intoxication aux métaux lourds
Tableau 1. Douleurs abdominales selon la localisation
(Adapté de réf. 2,5).
HCD : hypochondre droit ; HCG : hypochondre gauche ; IM : infarctus du
myocarde ; IBD : syndrome de l’intestin irritable.
06_10_37364.indd 2 19.09.13 08:50

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013 1713
diaphragmatique. L’ASP peut être cependant normal dans
30% des cas.5
Pancréatite
La pancréatite est causée par l’activation prématurée des
enzymes pancréatiques provoquant une autodigestion du
pancréas et des tissus adjacents. Plus de 80% des pancréa-
tites aiguës sont secondaires à une lithiase ou à l’alcool.
Les autres étiologies sont idiopathiques ou secondaires à
des causes rares telles que : des médicaments, un trauma-
tisme, une hypertriglycéridémie sévère (L 1000 mg/dl, soit
L 11,3 mmol/l), une infection, une dysfonction du sphincter
d’Oddi ou iatrogénique (ERCP).2 La pancréatite peut être
sévère dans 20-30% des cas, et létale dans 2-10%.6 Les mor-
bidité et mortalité de la pancréatite sont liées à la dysfonc-
tion d’organe et/ou à la surinfection des zones de nécrose.
Le CT est l’examen le plus utile pour l’évaluation du
degré de sévérité, notamment en identifiant la présence
de zones de nécrose. Un score prédictif radiologique a été
développé par Balthazar et coll., sur la base de critères
scanographiques. Sa valeur est très controversée. La né-
crose est caractérisée par une absence de prise de produit
de contraste (absence de réhaussement) d’une partie du
parenchyme pancréatique après une injection IV. Elle peut
apparaître jusqu’à quatre jours après le début des symp-
tômes cliniques.
Un nouveau CT est indiqué dans les situations suivan tes :
dysfonction d’organe persistante, signes de sepsis, suspi-
cion d’une complication sévère 7 ou détérioration de l’état
clinique dans les jours suivant l’admission. Dans les cas de
nécrose associée à un état fébrile, une ponction du liquide
inflammatoire sous CT est recommandée pour exclure une
surinfection et permettre l’instauration d’une antibiothéra-
pie ciblée. Selon l’évolution clinique, le CT peut être éga-
lement utile pour rechercher les complications éventuelles
de la pancréatite (pseudokyste, pseudo-anévrisme, throm-
bose veineuse).
L’échographie est complémentaire au CT pour détecter
des calculs vésiculaires, voire cholédociens (plus difficiles
à identifier par échographie).
La cholangio-IRM peut être un complément au scanner,
à l’échographie et à l’ERCP pour déterminer la cause d’une
obstruction des voies biliaires.
douleurs de l’hypochondre gauche
Celles-ci sont plus rares et comprennent notamment
les pathologies de la rate (infarcissement, abcès, trauma-
tisme), de l’estomac (gastrite, ulcère peptique), des reins
(emboles, lithiase rénale) ou du côlon descendant (diver-
ticulite, occlusion, perforation, coprostaste) (tableau 1).
L’examen recommandé en première intention est l’écho-
graphie, complétée par un CT en cas de nécessité.
vignette clinique
Un patient de 45 ans se présente aux urgences pour
des douleurs épigastriques intenses, de type coup de
poignard, irradiant en ceinture et dans le dos, associées
à des vomissements, faisant suite à une forte consom-
mation d’alcool. L’examen physique montre une hypo-
tension associée à une tachycardie, des bruits abdomi-
naux diminués en fréquence, une sensibilité locale au
niveau de l’épigastre. Le laboratoire révèle une leuco-
cytose et une élévation de la lipase à plus de trois fois
la norme.
Question : quelle est la prochaine étape dans votre dé-
marche diagnostique ?
Réponse : la présentation clinique suggère une pancréa-
tite. Le CT est l’examen de choix avec des coupes sans,
puis avec injection de produit de contraste. Une écho-
graphie est indiquée en complément du CT pour détec-
ter des calculs vésiculaires.
Le CT injecté avec produit de contraste montre une
pancréatite céphalo-corporéale nécrosante (figure 1).
L’échographie identifie des calculs vésiculaires (figure 2).
Le patient est hospitalisé avec une nutrition parenté-
rale, un remplissage adapté à l’hémodynamique et un
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013
Figure 2. Echographie révélant des calculs vésicu-
laires (têtes de flèche)
Figure 1. Aspect du pancréas sur le CT avec
contraste IV
L’astérisque montre la zone de nécrose du corps pancréatique. La région
caudale du pancréas rehausse normalement (P).
06_10_37364.indd 3 19.09.13 08:50

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013 0
suivi biologique quotidien. A J5, on constate l’apparition
d’un syndrome inflammatoire important, avec un état fé-
brile à 38,6°, et des douleurs abdominales persistan tes.
Question : quelle complication évoquez-vous et quelle
est votre attitude ?
Réponse : répéter le CT avec ponction du liquide pour
détecter une surinfection du liquide inflammatoire.
Un nouveau CT est effectué, avec ponction du liquide
inflammatoire de la zone de nécrose rétro-gastrique (fi-
gure 3) pour introduction et adaptation d’une antibio-
thérapie.
conclusion
Le choix de l’imagerie dans les douleurs abdominales
hautes ou diffuses va dépendre de la localisation de la dou-
leur. En règle générale, l’examen recommandé en première
intention en cas de douleur abdominale diffuse, suspecte
d’une perforation ou d’obstruction, est un ASP. Une écho-
graphie est recommandée pour les douleurs des hypochon-
dres. Lors de suspicion de pancréatite, le CT est réalisé en
première intention. Si le diagnostic est confirmé, une écho-
graphie est nécessaire pour rechercher d’éventuels calculs
vésiculaires. Lorsqu’une ERCP est effectuée pour l’investi-
gation des voies biliaires, il est parfois indiqué de la com-
pléter par une cholangio-IRM.
1714 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
25 septembre 2013
1 ** Stoker J, Van Randen A, Laméris W, Boermees-
ter MA. Imaging patients with acute abdominal pain.
Radiology 2009;253:31-46.
2 ** Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain.
Med Clin N Am 2006;90:481-503.
3 Kiewiet JJS, Leeuwenburgh MMN, Bipat S, et al. A
systematic review and meta-analysis of diagnostic per-
formance of imaging in acute cholecystitis. Radiology
2012;264:708-20.
4 Harvey RT, Miller WT. Acute biliary disease : Initial
CT and follow-up US versus initial US and follow-up
CT. Radiology 1999;213:831-6.
5 * Schaub N, Weber J. Douleurs abdominales hau-
tes – une approche possible. 1re partie : physiopatholo-
gie et clinique. Forum Med Suisse 2009;9:520-5.
6 * Balthazar EJ. Acute pancreatitis : Assessment of
severity with clinical and CT evaluation. Radiology 2002;
223:603-13.
7 UK Working party on acute pancreatits. UK guide-
lines for the management of acute pancreatitis. Guide-
lines. 29 April 2005.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec
cet article.
Figure 3. Ponction du liquide intra-abdominal à
l’aiguille fine sous contrôle CT (tête de flèche)
Implications pratiques
L’abdomen sans préparation est une aide utile pour effectuer
un tri et apporter une information rapidement disponible
dans le cas de suspicion d’iléus, perforation d’organe creux
ou coprostase
L’échographie est plus sensible que le CT pour le diagnostic
de cholécystite ou de lithiase vésiculaire
Le CT est l’examen de référence dans la plupart des dou-
leurs abdominales hautes et diffuses d’autres étiologies
>
>
>
06_10_37364.indd 4 19.09.13 08:50
1
/
5
100%