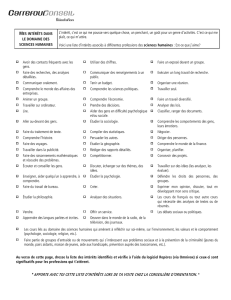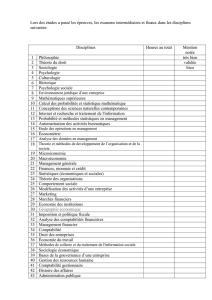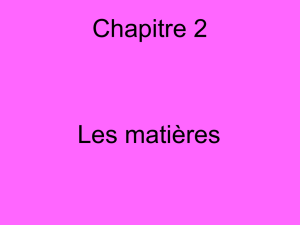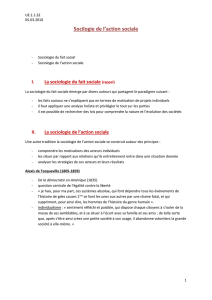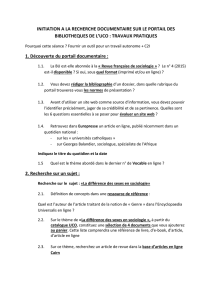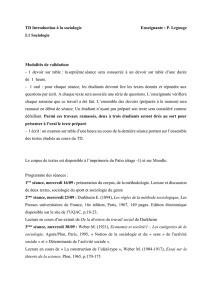Table des matières - Université de Sherbrooke

Chronique entrevue
Entrevue avec ROBERT SÉVIGNY
Lucie Mandeville,
Université de Sherbrooke
Monsieur Robert Sévigny est l'un des pionniers de la psychosociologie des relations
humaines au Québec. De son parcours professionnel, il a acquis une capacité
singulière de saisir la réalité humaine et sociale d'un point de vue multidisciplinaire.
Sa formation universitaire a pris ses racines en sociologie, domaine dans lequel il a
poursuivi un intérêt intarissable pour la culture et la personnalité, mais également en
psychologie, domaine pour lequel il a contribué au déploiement de l'approche
rogérienne, de la dynamique de groupe et des processus d’intervention. Il a été
professeur et directeur au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il a
mené, entre autres, des recherches cliniques mettant en valeur les savoirs implicites
des intervenants en santé mentale. Son tout premier emploi comme étudiant de
sociologie l’avait introduit à la recherche sur les relations ethniques et, beaucoup plus
tard, on le retrouve au Centre de recherche et de formation (CRF) du CLSC Côte-des-
Neiges (depuis cette année, il n’en est plus le directeur scientifique), un CLSC dont
les interventions sont fortement influencées par son contexte pluriethnique. Sa
personnalité et son cheminement de vie ont contribué sans aucun doute à l'image de
cet homme d'une grande ouverture d'esprit et d'une curiosité sans frontières.
L.M. Monsieur Sévigny, parlez-nous des événements significatifs de votre cheminement de
vie et de carrière qui vous ont conduit à la gestion de la diversité.
R.S. Je suppose que votre question s’adresse à la diversité ethnique à laquelle vous venez de
faire allusion. Au plan intellectuel, mon intérêt pour ce type de diversité remonte au tout
premier volume que j'ai lu comme étudiant en sociologie : French Canada in transition
(1938) écrit par Everett C. Hugues, un sociologue de l'École de Chicago. Cet ouvrage était
une monographie sur Drummondville, le centre industriel du textile au Québec à cette
époque. Encore aujourd'hui, il s'agit d'un ouvrage intéressant pour les habitants des Cantons
de l'Est. En français, il a été traduit par Rencontre de deux mondes : la crise de
l'industrialisation du Canada français. Hugues a donc fait une étude sur la façon dont les
deux mondes - le monde francophone et le monde anglophone canadien et américain -
réagissaient entre eux. Nous étions en 1952, j'étais alors étudiant à l'Université de Laval à
Québec. Ensuite, j'ai mis cet ouvrage de côté. Puis, trente ans plus tard, ma fille m'a fait

126 Entrevue avec Robert Sévigny
INTERACTIONS Vol.4 no 1, printemps 2000
remarquer que tout ce que j'avais souligné dans ce livre concernait la relation entre
l'individu et la société. C’est au fond le thème que je n’ai jamais abandonné, même quand
j’ai travaillé dans d’autres secteurs que celui de l’ethnicité.
L.M. Cet intérêt s'est donc développé lorsque vous étiez étudiant en sociologie?
R.S. J'avais un intérêt pour le lien entre la personnalité et les structures sociales et politiques
avant même que j'arrive en sociologie. Et, l’ethnicité ne m’était pas étrangère non plus : j'ai
vécu dans une famille qui s'y prêtait bien. Je suis né à Sherbrooke, dans le Vieux Nord, de
sorte que j'ai beaucoup joué avec des petits Anglais à l'âge de 8 à 10 ans. Il s'agit d'un de
mes premiers contacts avec l'autre, défini en terme de culture différente de la mienne.
D'autre part, mon père avait une vision assez nuancée de la vie privée et de la vie publique.
Il était nationaliste mais, en même temps, il acceptait fort bien que je joue avec un petit
voisin juif. Ses analyses et ses positions politiques étaient distinctes des dimensions
interpersonnelles de notre vie quotidienne.
L.M. De ce fait, considérez-vous que votre famille a contribué à l'ouverture d'esprit qui vous
caractérise ?
R.S. Je vous laisse à vous la responsabilité de l’expression « ouverture d’esprit ». À mes
yeux, il est évident qu’elle est à l'origine de mon intérêt pour l'implicite. Les membres de
ma famille ont toujours exprimé leurs sentiments par leur façon d'être, tout doucement, sans
de grands éclats ni sans grande déclaration verbale. Il m’a toujours fallu les écouter, les
sentir pour saisir, par exemple, leur mécontentement ou leur peine. L'intérêt pour ce que j'ai
appelé « l'implicite » n'est probablement pas déconnecté de ce style de relation dans laquelle
j'ai évolué, style qui, à bien y penser, était plus le fait de ma mère que celui de mon père. Si
je reviens à l’ethnicité, bien d'autres événements spécifiques sont sans doute reliés à ma
sensibilité pour les différences ethniques. Par exemple, quand j'avais environ quatre ans, il y
avait un petit restaurant tenu par un Arménien près de chez-nous. Je me souviens, mon père
m'avait expliqué qu'il y avait une guerre importante en Arménie et que les gens avaient été
obligés de fuir ce pays. Il avait cette façon de relier la présence de cet individu avec des
événements politiques, avec l'immigration ou le statut des réfugiés. Ainsi, plusieurs
événements de mon passé ont contribué au développement de ma personnalité et de ma
carrière, tout comme j'ai été amené à choisir des approches et des thèmes d’études ou
d’intervention qui convenaient davantage à ma personnalité.
L.M. Ainsi, dès votre premier cycle en sociologie, vous réalisiez des recherches sur la
diversité culturelle ?
R.S. Oui. Après ma deuxième année, j'ai participé à une autre recherche dirigée par Jacques
Brazeau, un spécialiste des relations ethniques qui avait étudié avec Hugues à l'Université
McGill. Cette recherche portait sur l'analyse de la situation des Canadiens Français dans le
milieu militaire. L'année suivante, j'ai participé à une recherche différente menée par Guy
Rocher et Arthur Tremblay sur l'analyse comparative des manuels d'histoire français et
anglais - dans un cours sur les relations ethniques, j'avais réalisé une analyse similaire sur
des manuels d'histoire à l'élémentaire - et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'analyse

Entrevue avec Robert Sévigny
127
quantitative de ces mêmes données en fonction des biais idéologiques et nationalistes des
historiens.
Ainsi, il y a probablement des aspects de mes origines et de ma personnalité qui m'ont porté
vers la diversité, mais d'un autre côté, j'ai aussi été « porté » par le contexte socioculturel de
l'époque. Au Québec, les relations ethniques se limitaient aux liens entre les Anglais, les
Français et les Juifs. Les premières recherches qui ont été réalisées au Centre de recherche
sur les relations humaines à Montréal, mettaient les représentants de ces trois groupes
autour d'une table et les faisaient discuter afin d'analyser les différences entre eux. À ma
deuxième année, j'ai produit un essai de sociologie urbaine sur les élections de la ville de
Sherbrooke pour étudier les relations entres les Anglais et les Français. Il me semble évident
que j'utilisais toutes les occasions que j'avais pour explorer les relations ethniques. Voici un
détail cocasse dont je me souviens. À l'époque, dans cette ville, le nombre de Canadiens
Français était le même que celui des Canadiens Anglais. De ce fait, la tradition voulait qu'il
y ait une alternance entre l'élection d'un maire francophone et, l'année suivante, celle d'un
maire anglophone.
L.M. À cette époque, ce genre d'étude était-il fréquent ou vous étiez une minorité à vous
intéresser au contexte pluriethnique ?
R.S. L’analyse des relations ethniques s'est grandement développée dans les années
cinquante à cause de la situation particulière du Québec. Un autre thème d’intérêt était la
religion. C’est sur ce thème que j'ai conduit ma thèse en sociologie.
L.M. Dans le même sens, est-ce que le cheminement de carrière de votre conjointe, qui a
oeuvré à l'ONU, a influencé votre propre itinéraire professionnel ?
RS. À titre de secrétaire générale-adjointe à l’ONU, au Département de l’information, de
1987 à 1992, Thérèse était chargée de l’information au Secrétariat. Tous les centres
d’information de l’ONU à travers le monde relevaient de ses services. Elle s'est davantage
intéressée à l'international, tandis que mon champ était plus celui des relations
interpersonnelles, des groupes restreints et, de façon plus large, de l’expérience personnelle
de la vie sociale. En fait, la ligne directe de sa carrière a surtout été les communications, le
journalisme et les relations publiques. Elle a été journaliste à la Tribune à Sherbrooke, elle a
été présidente de BCP, elle a été vice-présidente des communications pour la Société Radio-
Canada, elle était jusqu’à tout récemment professeure en communication internationale à
l'UQAM.
L.M. Vous avez eu des cheminements de carrière parallèles ?
R.S. Il s'agit vraiment de deux carrières parallèles de deux personnes qui s’intéressent à ce
que l’autre fait. Elle aussi a reçu une formation en sociologie, elle s’est toujours intéressée à
ce que je fais. Il y a peu de choses que j’ai publiées qu’elle n’ait pas lues et commentées. De
mon côté, indépendamment du reste, je me suis toujours intéressé aux relations
internationales. Le premier long essai que j’ai rédigé comme jeune étudiant portait
justement sur le passage de la ligue des Nations à l’Organisation des Nations Unies. J’étais

128 Entrevue avec Robert Sévigny
INTERACTIONS Vol.4 no 1, printemps 2000
loin de m’imaginer, à ce moment-là, que Thérèse y serait jour secrétaire-générale adjointe.
Par ailleurs, les liens entre nos deux carrières sont probablement plus nombreux que ce que
je viens de vous en dire : nous nous sommes connus très jeunes et une bonne partie de nos
deux trajectoires personnelles touchent sans doute, elles aussi, cet implicite auquel je viens
de faire allusion.
L.M. Revenons à votre propre cheminement. Vous avez été l'un des premiers à vous
intéresser aux travaux de Carl Rogers. Votre manière d'être et de faire ne cadrait pas au
courant marxiste de l'époque en sociologie et vous sembliez ouvert aux approches
novatrices. L'approche rogérienne, tout comme votre personnalité, ont pu contribuer à cet
intérêt que vous avez manifesté face à la diversité. De ce fait, certains affirment qu'il n'est
pas surprenant que vous vous soyez naturellement ouvert à l'interculturel. Pourriez-vous
commenter cette perception que certains ont de vous.
R.S. Je ne reviens pas sur le rôle de ma propre expérience personnelle : il me semble bien
que l’approche rogérienne, je l’ai d’abord « adoptée » en fonction de ce que j’étais comme
personne. Mais il y avait plus ou autre chose qui m’attirait chez Rogers. Son modèle me
permettait plus facilement de faire des liens entre l'individu et la vie sociale. En même
temps, ici aussi, l’implicite jouait beaucoup, beaucoup plus que je ne le pensais à cette
époque. Cette approche « respirait » la société nord-américaine et la resituait dans sa culture
sans jamais en parler explicitement - contrairement à la psychanalyse et au marxisme qui
s'imposaient à cette époque. C’est surtout vers la fin de sa vie, que Rogers est devenu plus
sensibilisé à l'influence du contexte socioculturel sur son approche par son contact avec
plusieurs autres cultures. Il se rendait compte que l'actualisation de soi, telle qu'il l'avait
définie, était une notion nord-américaine. Il se rendait compte aussi que son approche faisait
abstraction des processus de pouvoir politique et qu’il rejoignait trop peu le monde de
l’action sociale et politique. Quand j’ai eu la chance et le plaisir de passer une année au
Center for the Study of the Person au début des années 80, ces thèmes ont souvent été au
cœur de nos échanges. Dès notre toute première rencontre, il m’avait longuement fait parler
de mes expériences d’intervention dans les milieux syndicaux, milieux qu’il se désolait de
ne jamais avoir pénétrés. Ce sont les mêmes préoccupations que je retrouvais chez Gay Lea
Swenson qui était mon sponsor au CSP. Gay incarnait l’approche rogérienne de ces années
80, mais elle n’avait jamais oublié le climat social et politique qu’elle avait connu comme
étudiante à Berkeley. C’est beaucoup à cause d’elle que j’ai eu la grâce de redevenir
participant à des workshops de style rogérien pendant deux mois et de pouvoir, par la suite,
réfléchir sur toutes les dimensions sociales, politiques et culturelles de l’approche
rogérienne.
J’ai le sentiment de beaucoup simplifier les choses quand je vous raconte mon année à la
Jolla chez Rogers. Avant, il y avait eu l’influence de Dollard Cormier, mes expériences
avec l’équipe du Centre de recherche en relations humaines - le premier groupe à introduire
la dynamique de groupe style T-Group au Québec, mes années avec le Centre d’étude et de
communication que j’avais fondé avec des collègues - dont certains sont à l’Université de
Sherbrooke, mes expériences d’intervention à l’Alcan et le stage au National Training
Laboratory de Bethel que j’ai effectué à l’instigation de cette compagnie, mon année avec
des collègues de l’ARIP à Paris - dont l’orientation était, pour la plupart, d’orientation

Entrevue avec Robert Sévigny
129
freudienne, mes contacts avec mon collègue Luc Morissette au Département des
communications de l’Université de Montréal et qui, lui, avait été formé à la thérapie
familiale, la gestalt et la bio-énergie. Cette trop simple énumération me rappelle comment
ma trajectoire m’a amené à fréquenter des personnes et des lieux très diversifiés,
multidiscipinaires et multiculturels - à tous les sens du terme : culture organisationnelle et
professionnelle, culture ethnique et nationale, etc. Au-delà de cette diversité, la pratique
nous permettait, la plupart du temps, une saine confrontation et une collaboration très
dynamique.
L.M. Votre double formation universitaire s'est amorcée en sociologie, qu'est-ce qui vous a
dirigé vers la psychologie ?
R.S. J'ai étudié la sociologie de 1952 à 1956 où j'ai surtout travaillé avec Fernand Dumont
comme jeune assistant de recherche pendant un an et demi, puis six mois avec Arthur
Tremblay. Ensuite, j'ai décidé de me diriger vers la psychologie. Il est intéressant de
souligner la manière dont cette décision a été prise. À ce moment, il n'y avait pas tellement
d'ouverture sur le marché du travail pour les sociologues, en particulier ceux de l'Université
Laval, parce que c'était la guerre ouverte contre Duplessis dans la ville de Québec. Un bon
jour, je discutais avec Fernand Dumont - il m'a d'ailleurs beaucoup influencé dans ce choix -
et il m'a proposé de mettre sur papier tous les ouvrages que j'avais lus et aimés. Bien sûr, ils
étaient tous en lien avec la psychologie sociale. J'ai donc décidé de faire mes études à
l'Université de Montréal, bien que ma candidature ait été acceptée dans un programme
interdisciplinaire à l'Université de Harvard, celui des Social Relations. À Montréal, j'ai
d'abord fait deux années d'introduction en psychologie pour me préparer au doctorat que
j’allais faire en sociologie à l’Université Laval.
L.M. C'était à l'époque de la dynamique de groupe à l'Université de Montréal ?
R.S. Tout à fait. Lorsque je mentionne que j'ai été porté par les événements, cela en est un
autre exemple. Je suis arrivé au département de psychologie de l'Université de Montréal
quand les tous premiers T-Groups ont été mis en place au Centre de recherche en relations
humaines. Petit à petit, je me suis mis à faire de la dynamique de groupe. C'est à cette
période que j'ai été en contact avec la pensée de Rogers par l'intermédiaire de Dollard
Cormier qui enseignait cette approche nouvelle au Québec.
L.M. Vous avez été l'un des principaux représentants de l'approche rogérienne en dynamique
de groupe ?
R.S. Disons que j’ai été parmi les premiers, mais quelques autres, dont Fernand Roussel,
avaient initié ce croisement entre la dynamique des groupes et l’approche rogérienne. En
fait, comme étudiant en psychologie sociale, je me suis formé à la dynamique des groupes,
même si je me suis également donné une préparation en psychothérapie. D’ailleurs, la
psychologie de la personnalité m’est toujours apparue fondamentale en psychologie. C'était
au moment du virage vers la dynamique des groupes, genre T-Group. Avant, les stages
étaient beaucoup moins impliquants. Il s'agissait de conférences ou d'ateliers sur l'animation
des groupes de discussion. Alors, tout avait changé dans la façon de faire les choses, entre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%