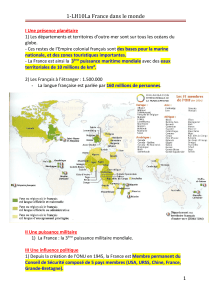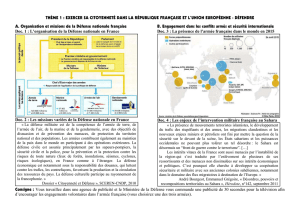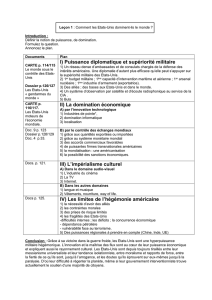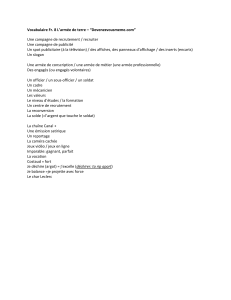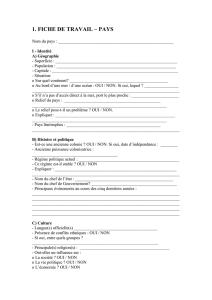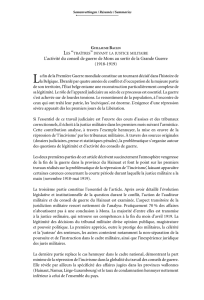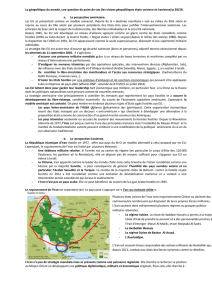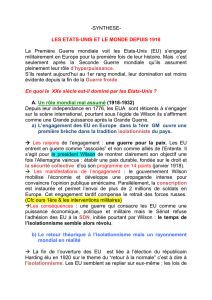SOMMAIRE - Association MINERVE

Cahiers du CESAT n° 8
Juin 2007
1
Sommaire
Éditorial
Vers une véritable ingénierie logistique militaire
Par le Général de corps d’armée J-L. MOREAU,
Commandant la Force logistique terrestre
Un penseur militaire
Colmar Von der GOLTZ
Par Monsieur MOTTE
Articles généraux
Le fonctionnement d’une coalition au XXIème siècle
Par le Lieutenant-colonel D. JAMME
Les projets de Foch à l’est de l’Europe (1919-1924)
Par Madame I. DAVION
L’Iran en quête de puissance: de 1934 à 1938
Par le Chef de bataillon C. AYZAC et Monsieur A. AYATI
Les idées de Clausewitz sont d’actualité
Par le Professeur Doktor M. STÜRMER
Le Mexique un siècle et demi avant l’Irak
Par le Lieutenant-colonel (ORSEM) F. CHOISEL
Le chef militaire dans un espace de bataille numérisé
Par le Lieutenant-colonel E. OZANNE
Libres opinions
1
Crise de diversité des élites militaires françaises
Par le Chef de bataillon G. de la ROQUE
Military victory does not mean political success
Par le Chef d’escadrons V. SEILER
Culture militaire et culture générale: question d’ambition
Par le Chef d’escadrons R. DECOMBE
1
Comme son nom l’indique, cette rubrique comporte des articles qui n’engagent
que leurs auteurs.

Sommaire
2
Management et commandement: essai comparatif
Par le Chef de bataillon P. SÉCRETIN
Notions d’effet majeur et de centre de gravité
Par le Général (2°S) L. FRANCART
Effet majeur et centre de gravité: compatibilité ou non
Par le Lieutenant-colonel C. FRANC
Pour un retour en grâce de l’apprentissage de la tactique
Par le lieutenant-colonel G. HABEREY
Mirage de la multinationalité
Par le Chef d’escadron AUGEREAU
Rubrique: «Le hibou de la mansarde»
Qui est le Hibou?
Quand le Hibou se prend pour Foch
Par le Colonel BEMELMANS
On a aimé
Iran et arc chiite: entre mythe et réalité
Par le Lieutenant-colonel J-P. GERVAIS
Rules of engagement: a life in conflict
Par le Chef de bataillon T. MOLLARD
Comment sera le monde en 2020?
Par le Chef de bataillon P. VERBORG
Précis de l’art de la guerre
Par le Chef d’escadrons X. BARTHET

Éditorial Cahiers du CESAT n°8
Juin 2007
3
Vers une véritable ingénierie
Logistique militaire
Par le Général de corps d’armée Jean-Loup MOREAU,
Commandant la Force Logistique Terrestre
usqu’à la refondation de l’armée de terre à la fin des années 90, le soutien logistique
du corps blindé mécanisé était simple: celui-ci disposait d’une autonomie initiale
complète, dès le temps de paix, qu’il fallait, en cas d’engagement, recompléter
après quelques jours de combat. Le problème majeur était l’organisation et la
conduite du soutien santé face à des taux de pertes élevés. Tout cela est
heureusement resté virtuel.
Après le changement géostratégique qui conduisit à la professionnalisation de l’armée
de terre, une telle logistique, distribuée dès le temps de paix, n’était ni rationnelle au plan
économique, ni nécessaire au plan militaire. L’armée de terre opta alors pour une solution
originale et novatrice qui combine la règle de l’unicité des ressources et le regroupement
des unités de soutien sous un commandement unique chargé de la préparation
opérationnelle, le commandement de la force logistique terrestre. Depuis, deux réservoirs
logistiques existent: l’un de ressources, l’autre de forces, dont le dimensionnement, la
modularité et la disponibilité autorisent les configurations les plus diverses, imposées par
les opérations à soutenir.
Une double séparation en découle: entre les unités de soutien et les unités de combat
d’une part, entre les unités de soutien et les ressources d’autre part. Une implication plus
forte des logisticiens dans les travaux préparatoires à l’engagement des forces devient
nécessaire pour réunir en ensembles opérationnels cohérents des moyens qui reposent
dorénavant dans des réservoirs distincts. L’intérêt du métier se trouve du coup valorisé.
La création d’une filière professionnelle et un cursus de formation associé le confirment.
Le succès de la formule est tel et la contrainte économique si pesante qu’une nouvelle
phase de concentration des ressources dans des réservoirs spécialisés sous la
responsabilité d’opérateurs interarmées a démarré. Le financement des opérations,
l’infrastructure de défense, les transports opérationnels, la maîtrise d’ouvrage de la
maintenance s’organisent selon un mode centralisé, le plus souvent sous la
responsabilité de l’état-major des armées, reprenant le modèle éprouvé des directions
centrales du service de santé des armées et du service des essences des armées. La
conduite centralisée des opérations d’externalisation est un autre exemple de cette
tendance de regrouper sous la responsabilité de l’état-major des armées la maîtrise
d’ouvrage, voire davantage, du soutien logistique opérationnel.
J

Vers une véritable ingénierie logistique militaire
4
Au sein même de l’armée de terre, l’impérieuse nécessité de mieux employer et gérer
les équipements impose une spécialisation des parcs en fonction de l’horizon d’emploi
effectif et des opérations de maintenance associées. Demain, les unités ne disposeront
plus que d’un parc de service permanent, suffisant pour mener l’instruction individuelle
et collective. Pour l’entraînement et l’engagement, elles prendront en compte le moment
venu et pour le temps nécessaire à l’activité les équipements que l’autorité d’emploi aura
décidé de mettre à leur disposition.
Même au plan des ressources humaines et des métiers, les unités ne sont plus capables
de générer par elles-mêmes les structures nécessaires à l’engagement. Le combat
moderne et son soutien imposent des groupements tactiques interarmes et des
groupements de soutien pluri-fonctionnels taillés sur mesure, qui résultent de la
combinaison de modules provenant de divers régiments-métiers.
Ce propos n’a pas pour objet de discuter le bien-fondé de ce grand mécano que
deviennent les armées et tout particulièrement l’armée de terre, mais simplement de
souligner l’importance croissante que prendront, à tous les niveaux, les architectes et
opérateurs du soutien logistique. Ce rôle sera d’une haute criticité dans la phase de
montée en puissance pour un engagement dépassant les capacités des forces en alerte.
L’absence d’autonomie locale et l’interdépendance généralisée des acteurs imposeront
des mises en condition opérationnelle extrêmement rigoureuses qui pourront encore être
rapides dans la mesure où elles s’appuieront sur des logisticiens entraînés, des
procédures éprouvées, des systèmes de commandement et d’information performants et
des infrastructures et processus logistiques à haut rendement.
Au total, le mouvement de rationalisation de la gestion et de l’emploi des ressources de
toutes natures qui s’opère sous nos yeux dans les armées s’accompagnera
nécessairement d’investissements conséquents en ingénierie logistique et fait déjà de
cette discipline un métier passionnant et d’avenir.

Cahiers du CESAT n° 8
Juin 2007
5
Un penseur militaire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
1
/
148
100%