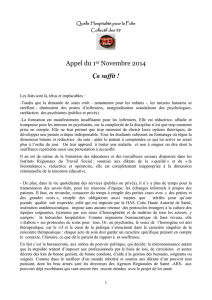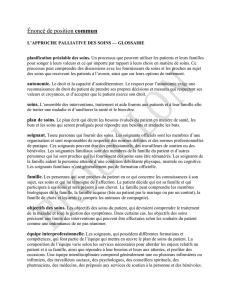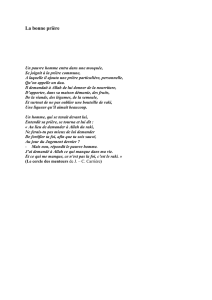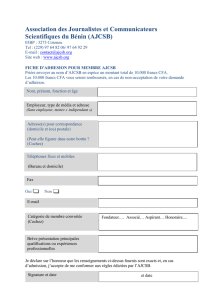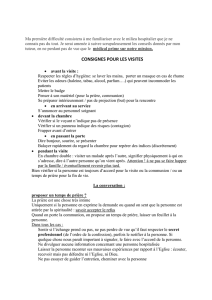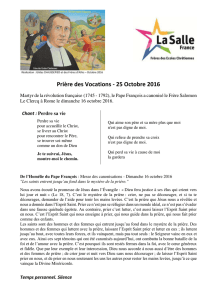pratiques en institutions - Traverses en Psychiatrie et autres lieux

10 39
Puis chacun parle à Dieu comme il le sent
Plus large, ouverte et surtout plus sonore, est la prière en assem-
blée pendant la messe. Mais l’impression qui prédomine est celle d’un par-
tage fraternel et chaleureux. Présumés bien portants ou malades, nous nous
sentons tous membres d’une même communauté humaine tournée vers une
même espérance. Chacun parle à Dieu, à son Dieu comme il le sent, mais
dans une langue commune à tous. Et les résonances de ce chœur maladroit
disent une communion étonnante. Pour des malades « dissociés » comme
sont les patients schizophrènes, il y a là certainement un effet apaisant, et
peut-être même – qui sait ? – réparateur.
Et offre son chant à la terre comme au ciel
Une autre prière collective est celle du groupe de prière. Cette ren-
contre qui a lieu pendant la semaine, en dehors du temps des célébrations,
entre une douzaine de patients et l’aumônerie est un moment privilégié, de
calme surprenant, voire d’une certaine douceur. Aussi ne peut-elle pas durer
bien longtemps. Mais les musiques, les textes courts et les chants connus,
les moments de silence, les risques d’une parole, les lectures de prières ou
d’hymnes, vont nourrir ces instants avec bonheur, reliant ensemble, à l’inté-
rieur du groupe, des moments d’intériorité dérobés à la maladie. Certes,
l’agitation sera de retour avec le chahut des pensées, les angoisses, les
plaintes répétées. Mais le moment ici est dense et précieux. Un temps fort
est celui où chaque participant confie au groupe une intention de prière :
c’est dit avec simplicité, humilité, naturel. « Je voudrais qu’on prie pour untel,
pour ma mère, pour mes enfants, pour une amie, un compagnon… ou
encore pour les sinistrés de telle catastrophe, pour les personnes seules, les
handicapés, les malades… pour telle infirmière, tel médecin, tel aide-soi-
gnant. » La prise de conscience éveille la solidarité. L’émotion est presque
timide. La prière à Marie ou le Notre Père, ou bien les deux, portent des
intentions devenues collectives et les offrent à la terre autant qu’au ciel.
Certains patients voudraient rester encore, prolonger ces instants uniques
pendant lesquels ils sont « comme les autres » avant de retrouver leur unité
de soins. Ils reliront un texte ou un chant, emporteront une image, le souve-
nir d’un morceau de flûte, de harpe ou de piano. La prière tardera en eux-
mêmes comme un soleil qui n’en finit pas de se coucher. Et chacun savou-
rera cette liberté qui déborde le champ du mental. ■
Institutions, soignants, soignés, de quelles façons ces 3 termes
se nouent-ils dans les dispositifs de soin et en soi-même ? A
quels enjeux narcissiques avons-nous à faire dans la confronta-
tion à l’institution ? Ce sont les questions que déploie Martine
Charlery dans cet article, qui reprend en partie le texte d’intro-
duction qu’elle nous a donné à entendre lors de l’ouverture du
stage organisé par l’Association Chrétiens en Santé Mentale ce
printemps dernier et intitulé : « Pratiques en institutions : impas-
ses, paradoxes, initiatives. »
Le travail collectif est source de souffrance, en lien avec le senti-
ment d'étouffement par l'institution, le mélange d'idéalisation et
de peur qu'elle engendre.
Je vous propose d'évoquer deux angles d'approche, de regard sur cette
souffrance.
L'institution délétère
D'abord, le regard sur les sociétés montre que l'institution est tou-
jours une forme datée, un "produit socio-historique" (dit Castoriadis) par
laquelle un rapport social est nommé ; elle stabilise ainsi, pour un temps et
sous cette forme, ce rapport social ; mais ce rapport est en décalage avec
lui-même dès qu'il apparaît comme institué. Cela veut dire que l'institution
subit dès qu'elle apparaît un processus d'altération, qui peut l'amener à
asservir la société et les individus à sa propre auto finalité alors qu'elle a été
créée pour leur rendre service.
Alors, il est très important de toujours se souvenir que l'institution,
c'est le faire social auquel le dire des sujets donne forme pour l'organisa-
tion et les modalités de leur être-ensemble. Autrement dit, l'institution c'est
PSY A FOND
PRATIQUES EN INSTITUTIONS
par Martine CHARLERY
psychiatre

11
38
la manière dont les hommes chargés de l'accomplissement des objectifs de
l'organisation se débrouillent avec leur réalisation. A ne pas confondre avec
les établissements, cadres légaux et réglementaires destinés à répondre à
des objectifs nécessaires au fonctionnement sociétal.
La souffrance liée au travail en groupe est pour une part le résultat
de l'asservissement, de l'empêchement à penser que secrètent parfois les
institutions nous avons vu dans quelle déviance, altération propre à leur
existence même. Mais il y a une autre source de souffrance, qui nécessite
un second angle d'approche.
Les enjeux narcissiques des investissements de chacun
Il y a une façon de rêver l'institution qui secrète, on pourrait dire,
un asservissement volontaire à une unité imaginaire, fusionnelle. Et la
souffrance qui signale que cette unité-là se lézarde, ce peut être une
chance à saisir.
Voici la traduction que donne du passage de Babel, dans la genèse,
André Chouraqui :
"Ils disent, l'homme à son compagnon :
"Briquetons des briques !
Flambons-les à la flambée…
Afin de ne pas être dispersés sur les faces de toute la terre".
La parole ici est un "nous" qui exclut l'altérité ; c'est une parole qui
tourne sur elle-même : briquetons les briques, bitumons le bitume, flambons
à la flambée.
Dans une intervention proposée par l'ACSM Ile de France en 2005,
"d'une unité aux différences, des différences à l'altérité", Blaise Ollivier reve-
nait sur ce texte et soulignait : pas d'adresse les uns aux autres, pas de
négociation sur les objectifs, pas de délibération… Seule règne la défense
contre l'angoisse d'être dispersés …
Et le Dieu va rompre cette hallucination de toute-puissance, introdui-
sant la confusion, l'incompréhension et en même temps le germe de ce qui
pourra produire, ensuite, le commencement d'une histoire de sujets en lien.
Et Blaise montre d'où viennent les difficultés, pour chacun, de
s'impliquer dans les débats institutionnels, pour y produire les trans-
gressions nécessaires : elles viennent de la culpabilité de rompre avec
un consensus hérité, qui se présente comme devant aller de soi. Créer
le désaccord est vécu comme une faute. Tant que l'institution est
sacralisable, tous sommes valorisés d'y avoir notre place. Si nos diver-
gences mettent en difficulté ceux à qui elle a confié le pouvoir, l'idéal
intériorisé nous condamne… D'où la peur d'oser parler ainsi, d'une
façon qui sépare… on peut préférer se réfugier dans les plaintes, le
repli ou la fuite…
En aumônerie d’hôpital on est témoin de nombreuses manières de
prier ; notamment en hôpital psychiatrique où malgré le poids de
la maladie, des traitements et de l’exclusion sociale (au moins partielle), le
patient exprime sa foi librement. Cela ne veut pas dire qu’il l’expose. Mais
l’aumônerie parce qu’elle est garante, officiellement, que l’expression de la
foi n’est pas forcément du délire, a cette chance d’entrer dans la confidence
du patient qui prie.
La chambre d’isolement comme chapelle
Il peut arriver ainsi que le patient raconte sa prière solitaire : comme
Jeanine qui aimait prier dans la chambre d’isolement. Elle m’avait confié
qu’un jour, enfermée là pour rébellion, très seule et accablée, elle s’était
souvenue, du passage d’évangile où Jésus dit ceci : Toi, lorsque tu veux
prier, retire-toi dans ta chambre la plus secrète. Et ton Père qui voit dans le
secret te le rendra. « Depuis ce jour-là, avait-elle ajouté, j’ai vécu en cham-
bre d’isolement comme dans une chapelle ».
Ou la prière comme rencontre amoureuse
Le patient peut aussi nous demander de prier avec lui ou elle. C’est
un moment délicat, parfois bouleversant. Il y a quelque chose dans la prière
à deux ou trois, si elle n’est pas une récitation de routine (et c’est rarement
le cas en psychiatrie), qui ressemble à une rencontre amoureuse à ses
débuts : la voix chuchote, l’attitude est pudique, on confie à l’Autre invisible
et devant témoin des secrets sur soi. Ainsi, même lorsqu’elle paraît décou-
sue, cette prière résonne toujours vrai. Et, de l’entendre et de la partager,
nous met aussi en vérité avec nous-même.
SYMPHONIE
PASTORALE
DE LA PRIÈRE «DANS LE SECRET»
À LA LOUANGE COLLECTIVE
par Monique DURAND
ancien aumônier en psychiatrie

12 37
Voici donc esquissées deux raisons pour lesquelles penser l'institution nous
est difficile :
- celle qui est liée à l'institution elle-même et son risque permanent d'altéra-
tion de ses buts et d'asservissement de ses acteurs à son propre service
- celle qui est liée à notre attachement, à nos propres représentations ima-
ginaires.
En psychiatrie, l'institution c'est le soin
Dans notre travail avec ceux qui sont saisis par la folie, il est absolu-
ment essentiel de s'atteler à cette question de l'institution : c'est qu'elle n'est
pas seulement le cadre dans lequel nous avons à travailler, et dont il faut
peu ou prou nous débrouiller, elle est aussi notre principal –sinon notre seul
- outil de travail.
Dans un bel article paru dans Rhizome, Pierre Delion rappelle qu'en
psychiatrie, il y a toujours un écart entre les faits et la cause, qu'il soit
organo-clinique, socio ou historico-clinique. Nous sommes tous des fous au
sens où nous avons tous en nous les éléments du drame de la folie. Ce
drame cependant, nous ne le vivons pas tous… Les malades mentaux ont
certes un problème médical, mais pas seulement, d'autres éclairages sont à
prendre en considération : anthropologie, droit, santé publique, sociologie,
linguistique, multiculturalisme et bien d'autres… Ces aspects, il faut les inté-
grer dans une théorico-pratique qui soit utile au malade lui-même, dans les
efforts que font les soignants pour l'accompagner dans sa déshérence, puis
l'aider à bifurquer vers d'autres horizons moins noirs. C'est la psychothéra-
pie institutionnelle qui a su accueillir ces éléments hétérogènes pour en
déduire une praxis originale, au cœur de laquelle se trouve la nécessité de
tenir compte de la relation transférentielle quel que soit le dispositif de soins
proposé dans la diachronie du traitement.
Aujourd'hui, les nouveaux visages de l'asile s'avancent masqués :
par exemple le scientisme, qui détermine une ségrégation entre les patients
qui présentent des expressions symptomatiques différentes ; nous devons
nous attacher à préserver plus que jamais le visage humain de la psychia-
trie, en insistant sur les pratiques concrètes qui mettent le sujet, bien qu'il
soit malade mental, au centre de sa guérison.
Réfléchir aux dispositifs nécessaires pour accueillir les patients au
cours de leur trajectoire vitale, les accompagner le temps nécessaire, les
aider quand c'est possible à approfondir un travail psychothérapique : ce tra-
vail ne peut se faire que s'il est appuyé sur des institutions créées entre les
soignants et ces personnes gravement malades : un type de réponse qui
engage le collectif qui l'énonce et les sujets – parlêtres, disait Lacan - qui le
constituent.
Je vais vous parler de la façon dont nous souhaitons que puissent
fonctionner les équipes - ça ne veut pas dire, loin de là, que toutes les équi-
nous adresser. C'est un effet collatéral, mais c'est tout de même important.
- Comment se termine le groupe ?
Quand on a fini ce temps de parole, on annonce qu'on va prendre le
goûter… à l'heure de l'apéritif ! On range tous les dessins dans la valise, les
enfants sont très actifs. Chaque adulte et chaque enfant a un badge avec son
nom et son prénom de façon à pouvoir s'identifier facilement. Donc on range
les badges, les dessins, tout le matériel. On sort sur la table le coca, le jus
d'orange, les bonbons, les gâteaux et c'est un moment où on mange ensem-
ble, on parle aussi très librement, on rit. C'est un moment très gai. On peut
quitter la tristesse, la détresse, la dureté aussi avec des bonnes choses,
sucrées. Se remettre en forme pour sortir et rejoindre la famille. Il y a les
paquets de bonbons qui tournent autour de la table, on se fait des petites pro-
visions, on en met dans les poches. C'est un moment très convivial, c'est très
important pour attendre jusqu'à la prochaine fois. ■

13
36
pes font ce choix de cadre de travail, ni que, dans celles qui le font, il n'y a
pas de difficultés à le soutenir – Mais, qu'on fasse le choix de les repérer
ou non, les processus inconscients dont je vais parler rapidement sont tou-
jours à l'œuvre.
La singularité de la relation transférentielle dans la psychose et les
pathologies graves de la personnalité oblige les acteurs à une inventivité
permanente, en articulation avec tous les partenaires du patient, chacun
avec sa spécificité, son rôle, sa posture, et dans sa durée.
La rupture avec la logique asilaire, ségrégative, excluante n'est
jamais acquise. Elle risque toujours de se survivre masquée, y compris
dans le colloque singulier avec le patient ; doit toujours être cultivée cette
vitale faculté d'étonnement et de remise en question, la brèche de l'effa-
cement, du dessaisissement, non seulement dans le quadrillage médico-
psycho-social mais aussi dans notre for intérieur… sans elle toute tenta-
tive de soin n'est que leurre. La différence que Winnicott introduit entre
game et play (entre le jeu strictement défini par les règles et celui qui se
déploie librement) me semble une bonne image de cet enjeu : maintenir
un espace de soins comme repère de "playing" suppose que ce jeu-là soit
véritablement partagé entre soignés et soignants, dans un lieu qui
consiste en un chevauchement des espaces potentiels de tous les parti-
cipants, l'espace potentiel étant la capacité de chacun à vivre et à créer.
Or pour beaucoup de nos patients, l'accès au jeu, à la créativité, à l'ima-
ginaire, est barré, empêché. Ils ne peuvent que reproduire, répéter, le
drame de leur histoire, de leurs ruptures primitives, sur la scène institu-
tionnelle, entraînant troubles, angoisses, clivages… Il est essentiel que
les soignants aient des espaces de parole et d'échange leur permettant
de maintenir entre eux un "jeu" qui ne soit pas trop menacé par les effets
transférentiels morcelants et évite les effets en retour de violence à l'en-
contre des patients. Au contraire, l'équipe a à servir de contenant pour les
éléments bruts, non symbolisés, qui débordent et terrassent le patient :
seule une équipe constituée d'individus véritablement reliés les uns aux
autres va pouvoir jouer le rôle de contenant pluripersonnel, car chacun
peut accueillir une partie de ces éléments, et non tous. Les échanges
dans l'équipe sont absolument vitaux pour éprouver cela, et qu'aucun soi-
gnant ne se sente à son tour débordé, ni disqualifié. Ainsi, ce qui appa-
raît destructeur à un moment donné à « x » peut apparaître positif à
« y »… pour que s'accomplisse le travail de transformation de ces élé-
ments bruts en pensée, en parole, en naissance chez le patient d'une
cohésion interne, il faut qu'aient été mis en scène, puis en lien ces élé-
ments disjoints, à partir de ce qui a pu être touché en chaque soignant…
à un certain niveau de lui-même, vulnérable, donc potentiellement capa-
ble d'entendre. C'est un des paradoxes à repérer : être pris dans la répé-
tition peut permettre d'en sortir si on peut la lire.
"Quand je suis avec lui, il m'énerve, mais dès qu'il n'est plus là, il me man-
que." Et c'est comme ça un peu que se dit l'amour, l'attachement.
On voit bien que dans ces situations, il y a le versant d'ombre et puis
le versant de lumière. Pour pouvoir accueillir la lumière, il faut aussi avoir fait
la part de l'ombre. Pour pouvoir séparer le handicap (qu'il faut refuser) de la
personne (qu'on aime), cela suppose d'avoir pu parler à la fois de l'ombre et
de la lumière. C'est ce qui est précieux dans cette expérience de groupe,
mais qui demande du temps et un certain courage aux parents et aux
enfants. On est pas tous prêts à tout moment à ouvrir ces boîtes-là.
- Quels vous semblent être les bénéfices du groupe pour les enfants ?
Ce groupe est proposé à beaucoup de familles, un petit nombre s'en
saisit. Il va de soi pour nous que ce n'est pas parce qu'on a un enfant han-
dicapé ou autiste dans une famille que ça fait que le frère ou la sœur va
souffrir ou avoir besoin de venir en parler. Ça nous a semblé important d'en
proposer la possibilité pour ceux qui veulent s'en saisir, parce qu'on a vu des
enfants s'éteindre, s'empêcher de vivre, aux prises avec des sentiments de
culpabilité tellement importants quant à leur désir de meurtre, de disparition
de l'autre, entre autres, qu'ils ne pouvaient même pas s'exprimer dans la
famille par des conflits ordinaires qu'on trouve dans toutes les fratries. On
peut difficilement saisir les bénéfices du groupe autrement que par leur fidé-
lité, leur appétit à venir longtemps ; mais il y a régulièrement des parents qui
nous disent que celui qui vient au groupe commence maintenant à dire non,
parfois à refuser de faire quelque chose, à être moins facile. Cela dit a pos-
teriori, qu'il y avait un empêchement à exister, qu'il y avait besoin d'un lieu
pour se dire.
- Et pour les animateurs ?
Pour nous soignants, c'est très important d'entendre dans ce lieu-là
parler des frères et sœurs d'enfants autistes, que par ailleurs, nous avons
en charge dans le service, parce que ça nous permet de mesurer les diffi-
cultés énormes de la vie quotidienne à l'intérieur de la famille avec ses
enfants, auxquelles bien sûr nous sommes attentifs dans les entretiens avec
les parents, mais quand même ça ne nous donne pas la mesure de la souf-
france des familles à laquelle nous avons accès à travers le discours des
frères et sœurs. Cela, dans certains cas, nous a amené à être plus attentifs
aux aides à proposer, par exemple des temps d'accueil plus longs dans le
service, à aller au-devant même de demandes que les parents n'osaient pas

14 35
Ce travail réclame une capacité de mouvance, de se laisser tra-
vailler par ses affects dans la relation aux patients, d'avoir vécu que "cela ne
tue pas" ! La responsabilité de chacun est là : dans l'invitation à la vigilance
quant au transfert et au contre-transfert, à exposer dans l'équipe sa prati-
que, à supporter de l'entendre interrogée par les autres, à mettre soi-même
en question celle des autres si nécessaire, à analyser les défaillances de
l'équipe en lien avec son histoire.
Je viens de vous parler du quotidien d'une équipe soignante –
comme je les aime ! dans les moments où ça fonctionne - mais je crois pro-
fondément que les mêmes enjeux concernent toute personne, tout collectif
en contact avec la folie.
Je suis convaincue que la confrontation à l'institution, donc à la
question du devenir que nous faisons à la fonction instituante que chacun
porte en soi, est une des confrontations qui nous permettent de passer à
plus d'humain en nous. ■
- Comment concevez-vous la posture des animateurs ?
Cela nous pose question et nous le retravaillons tout le temps, car
nous avons des expériences professionnelles différentes : notre place à
nous dans ce groupe, nos interventions. Nous préférons quand ce sont les
enfants qui s'interpellent entre eux, qui rebondissent sur quelque chose qui
a été dit, qui interpellent l'autre, qui posent des questions, mais quelque fois
nous le faisons aussi, intervenant pour soutenir, pour faire préciser, pour
demander ce que l'enfant ressent à ce moment là. Nous n'intervenons pas
pour réparer ou pour consoler, cela nous paraît important que nos interven-
tions soient là pour aider la parole à naître et à se déployer, à se donner,
parce que nous pensons que c'est cela qui est très important pour les
enfants et qu'à partir de là, ils feront leur chemin, ce n'est pas à nous de les
rassurer, de les déculpabiliser, c'est quelque chose qui se fait tout seul, ou
entre eux, et chacun en témoigne, à partir du moment où une parole juste
a pu se dire. C'est vraiment l'esprit du groupe, ne pas aller au-delà de ce
que l'enfant dit, il y viendra quand le temps sera venu pour lui, on ne fait
pas d'interprétations.
- Est-il parfois question de la honte ?
Par rapport à la honte, un jeune garçon disait qu'il se posait la ques-
tion que son petit frère vienne à une fête dans son école. Il disait "j'ai peur
que si les professeurs voient que j'ai un petit frère handicapé, ça change
leur regard sur moi et qu'après ils aient pitié de moi" ou si la sœur est à la
maison, il faut la cacher pour pouvoir inviter des copains. Ces moments-là
sont importants ; on a constaté que quand ces choses-là ont pu se dire,
s'exprimer, dans les séances suivantes peuvent apparaître des moments
précieux, des moments où ils peuvent dire "j"étais fière de lui" "j'ai été
étonné, je pensais qu'elle allait se mettre à pleurer, et bien non, elle a
assumé la situation".
La honte d'avoir honte, elle est là, mais elle est partagée par tous.
Du coup ça la rend moins monstrueuse. Les enfants repartent plus légers
par rapport à ce sentiment-là, parce que c'est partagé tout simplement.
J'ai souvent en tête le mot entraide, mais aussi compagnonnage.
Ce que les enfants nous disent souvent, c'est le besoin de souffler.
C'est-à-dire quand le frère ou la sœur n'est pas là un week-end par exem-
ple ou quand ils peuvent partir en vacances sans le frère ou la sœur seul
avec les parents, le besoin de souffler, mais en même temps le manque.
1
/
5
100%