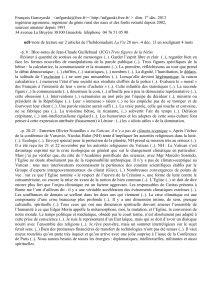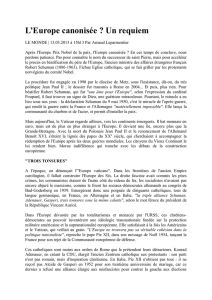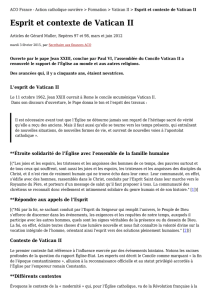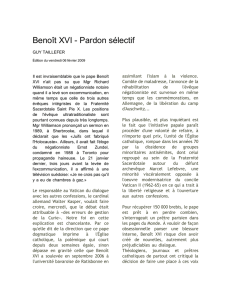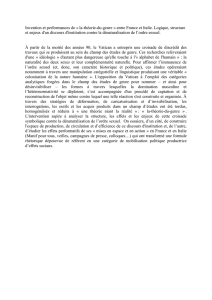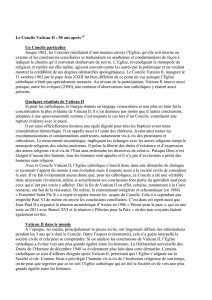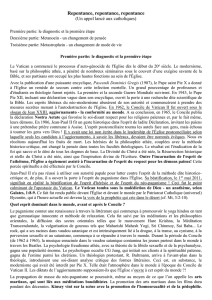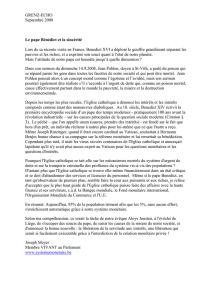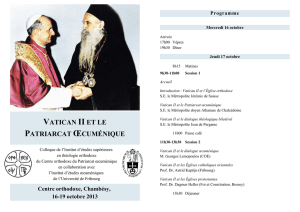autour de l`ouvrage de Carl Bernstein

1
Avant-propos :
Recension rédigée en 1997 pour la revue Golias, qui attendait pour le publier, m’a dit alors
son directeur Christian Terras, de faire un numéro spécial sur Jean-Paul II.
J’ignore si ledit numéro a été publié, mais cette rédaction sur demande n’a jamais eu de suite
imprimée, Annie Lacroix-Riz, 23 décembre 2009
LA DÉCOUVERTE TARDIVE DE L’AMÉRIQUE ET SES LACUNES: AUTOUR DE L’OUVRAGE DE CARL
BERNSTEIN ET MARCO POLITI, SA SAINTETÉ. JEAN-PAUL II ET L’HISTOIRE CACHÉE DE NOTRE ÉPOQUE,
PLON, PARIS, 1996.
« La découverte tardive de l’Amérique et ses lacunes: autour de l’ouvrage de Carl Bernstein et Marco Politi », Sa
Sainteté. Jean-Paul II et l’histoire cachée de notre époque, Plon, Paris, 1996
Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contemporaine, université Paris 7
Pour tenter de bénéficier des apports de l’ouvrage de Carl Bernstein et Marco Politi, il
convient de faire abstraction d’un style hagiographique au point d’obscurcir des analyses par
ailleurs vraisemblables. Les auteurs, vers la fin de l’ouvrage - portant sur la période de
« crise » profonde de l’idole, qui révèle la fragilité de la spectaculaire offensive cléricale des
années 1978-1990 -, récupèrent le sang-froid perdu au cours des centaines de pages
précédentes. On a eu jusque là trop souvent l’impression de lire une chronique de saint en
cette biographie d’un pape crédité de sa contribution à l’« effondrement du communisme », et
brutalement - par quel miracle? - passé du stade de clerc mystique à celui d’homme politique
intégré jusque par le menu à la stratégie et à la tactique américaines en Europe et en Amérique
latine (et ailleurs?).
La méthode prête à sourire concernant Karol Wojtyla, personnalité fondamentalement
politique, comme le confirment toutes les données discernables de sa carrière (le non-dit et le
non-précisé abondent), des prémices de la prêtrise au pontificat. L’obsession antirusse et
antibolchevique de ce Polonais germanophile - cas de figure représentatif de la hiérarchie de
l’Eglise polonaise - est ici transfigurée en amour de Dieu et de la Vierge (de Fatima souvent, à
laquelle Pacelli-Pie XII vouait le même culte). La collaboration quotidienne de la Curie et de
son chef avec les services secrets américains cadre mal avec la « nature mystique » alléguée
du pape: le flot de littérature d’espionnage militaire (d’où émerge le colonel polonais
Kuklinski, grand informateur des Américains, p. 272 sq.), sur fond de missiles ou de projets
d’anéantissement de la théologie de la Libération et de la puissance soviétique en Europe et
ailleurs, fait mauvais ménage avec les prières, la vénération de Marie et les extases
qu’auraient partagées Reagan, ses collaborateurs les plus proches - intégristes catholiques de
longue date responsables des services secrets - et Wojtyla. Cet enrobage lyrique et dévot -
alors que les liens du pape avec l’Opus Dei sont réduits à une note (p. 334) - gêne
notablement la lecture, sans parler de la tendance au fouillis et à la répétition, écueil qu’eût
permis d’éviter le respect plus sourcilleux de la chronologie.
Ce livre nous en apprend par ailleurs beaucoup moins qu’il ne le prétend, et des travaux
historiques l’ont précédé sur mainte question. Si les auteurs prétendent nous révéler
« l’histoire cachée de notre époque », ils ont presque totalement évacué la question
yougoslave, grand dossier de ce règne traité dans la tradition germano-italienne antiserbe du
Saint-Siège. L’accent mis ici sur les relations américano-vaticanes - donnée en effet
fondamentale de la politique vaticane du siècle - conduit les auteurs à négliger les racines
allemandes de cette grande alliance conclue au terme du premier conflit mondial, et non dans
le coup de foudre entre un Reagan, grand croisé contre « l’Empire du mal » au « christianisme
salvateur » (p. 303), et un Wojtyla communiant dans l’amour de la Vierge Marie.
A réunir les pièces d’un puzzle éparpillé sur plus de 450 pages, on voit confirmé le portrait -
dressé par les archives diplomatiques françaises - de Karol Wojtyla et de l’univers clérical qui
l’a formé et encadré. Sur la base d’une biographie rédigée par des hagiographes, le futur pape

2
apparaît d’emblée comme un Polonais assez violemment antirusse - solide tradition bien
antérieure à l’ère bolchevique - pour éprouver envers le Reich des sympathies que la
discrétion des auteurs voile à peine: germanophone, il est présenté comme « hostile aux
nazis » mais surtout comme un des clercs les plus hostiles à toute résistance à l’occupant (p.
43 sq., jusqu’à 59, p. 89, etc.); on doute de son antinazisme en apprenant que, face à la
barbarie allemande qui frappait jusqu’aux salésiens de sa paroisse, il consacra ses efforts, avec
succès, « à convaincre la plupart » de ses amis « du Rosaire Vivant » - organisation secrète
sur laquelle on aimerait en apprendre davantage - « de ne pas rejoindre la lutte clandestine »:
« prier était la seule chose à faire » (p. 56-57), aurait-il alors jugé - sérénité qui ne régit
assurément pas ses relations orageuses avec le monde russe. Il aurait aimé les juifs, en ce pays
dont l’Eglise conduisait la toute-puissante coalition antisémite, sous la houlette du primat
Hlond (p. 32 sq.), un des protagonistes essentiels de l’orientation pro-allemande - francophobe
autant que russophobe - de la politique polonaise d’avant 1939.
Du descriptif embrouillé d’un hypothétique philosémitisme ressortent des éléments
antagoniques avec cette thèse: Karol Wojtyla ne porta jamais secours à un juif (p. 57) pendant
la guerre - comme la quasi totalité de ses pairs il est vrai; il aurait eu depuis son enfance
nombre d’« amis juifs », mention très vague, plus vague que les actes. Car ce philosémite
présumé a canonisé Kolbe, « personnage complexe » peut-être, mais surtout antisémite
notoire; son caprice entêté de sanctification catholique du camp d’Auschwitz ne le classe pas
parmi les amis des juifs, au jugement des principaux intéressés (p. 194-195).
De la guerre allemande contre l’URSS il attendait, comme ses supérieurs hiérarchiques,
qu’elle liquidât le communisme et permît au « peuple russe » de « retrouver la voie du
christianisme » (p. 57). Le livre évoque à plusieurs reprises cette antique obsession de rendre
la Russie au catholicisme romain. Mais on mesure mal dans cette hantise d’apparence
purement anti-rouge la vieille mission que les Habsbourg avaient assignée au Vatican, via
l’uniatisme, qu’il conduisit depuis la fin du XIXè siècle également sous la houlette des
Hohenzollern, et qu’il poursuivit après 1917-1918 avec le Reich allemand, créant notamment
des organismes dominés par l’Institut oriental et son Russicum, instruments idéologiques
(renseignement militaire inclus) de la reconquête future ou rêvée.
De même perçoit-on souvent l’influence germanique déterminante dans la promotion de ce
Polonais. Il y a cependant, les archives françaises l’attestent, bien autre chose dans cette
affaire que la commune adhésion, indéniable, à l’intégrisme et à la revanche contre Vatican II
(p. 93 sq.). Nul ne contestera le tableau, correctement fait à la fin de l’ouvrage, d’un
intégrisme culturel nourri d’une impressionnante misogynie sexuelle (p. 341 sq.). Mais c’est
ailleurs, sur les frontières - les auteurs le suggèrent avec une discrétion excessive -, que se
joua l’alliance qui fit Wojtyla pape. En dépit de ce qui est dit ici des « persécutions » contre
l’Eglise polonaise, et du « martyre » enduré par Wyszynski pour préserver les « droits » de
l’Eglise bafoués « par le pouvoir stalinien » (p. 79), c’est à la simple non-reconnaissance des
frontières polonaises de 1945, exigée par Pie XII de tout l’épiscopat polonais, que Wyszynski,
primat successeur de Hlond, dut ses ennuis, notamment son emprisonnement en septembre
1953.
La demande de pardon... aux Allemands, rédigée en 1964 par l’épiscopat polonais sous la
pression de Wojtyla, nous oriente sur des voies familières: le « refus commun du nationalisme
et [la] volonté d’assurer la défense des valeurs de l’Europe contre le communisme » auraient
réuni le prélat polonais et l’épiscopat allemand (p. 94-95). De l’idylle polono-austro-
allemande qui se concrétisa en 1978 dans l’élection de Wojtyla on a presque exclusivement
retenu les aspects anticommunistes; or, elle s’est évidemment conformée au vieux principe
romain défendu bec et ongles depuis 1918: un prélat polonais n’est acceptable pour la Curie
que lorsqu’il ne fait pas un préalable du respect intangible des frontières de son Etat établi sur
les dépouilles d’une Allemagne vaincue i. C’est la seule base susceptible de fonder le soutien

3
austro-allemand à la promotion pontificale d’un Polonais antirusse - condition nécessaire mais
non suffisante pour lui gagner ces voix germaniques.
Ce paradoxe apparent cesse de l’être lorsque l’on soulève la couverture « polonaise » - portant
l’étiquette du « rempart » de l’antibolchevisme, routine idéologique de la Pologne de 1918-
1939 - qui a maintenu intacte la vieille tutelle germanique sur l’Eglise romaine: à se fier à
l’histoire - nous nous y obstinons en l’absence de preuves contraires -, la communion dans
l’intégrisme n’a pu suffire à assurer l’hégémonie incontestable sur ce règne du chef de
l’Inquisition Ratzinger, cardinal-archevêque de Munich, capitale d’une Bavière vouée à la
traditionnelle mission de l’Anschluss (objectif auquel Rome n’a pas renoncé en 1945 plus
qu’en 1918). L’ouvrage fourmille d’indications sur la présence à tous les échelons décisifs
d’éléments allemands et autrichiens: ainsi Wojtyla fréquentait-il assidûment le cardinal-
archevêque de Vienne, König, un des maîtres des initiatives en direction de l’Est et de
l’élection de 1978 (p. 138 sq.). On comprend donc à maint signe que les « Polonais »
moyenâgeux de l’entourage du pape pèsent depuis 1978 beaucoup moins que les chefs
d’orchestre germaniques de sa nomination et du fonctionnement quotidien de la Curie.
On n’en regrette que davantage de tout ignorer des modalités d’une action largement
commune dans l’ancien espace yougoslave désormais déchiré. Pas plus que la hantise de
conquérir l’espace russe au catholicisme germanique, la contribution vaticane à la destruction
du serbisme orthodoxe ne date de l’ère communiste: entamée du temps des Habsbourg, elle
fut poursuivie aux côtés du Reich (et de l’Italie en quête d’expansion balkanique); la Serbie
d’avant 1914, considérée comme le barrage essentiel, conforté par la Russie tsariste, à la
poussée autrichienne vers le Sud, puis la Yougoslavie monarchique et dictatoriale d’après
1918, alliée de la France, suscitèrent autant de haines et d’initiatives vaticanes que l’Etat
titiste et son successeur yougoslave puis serbe. Les Etats-Unis ont certes montré pendant tout
le siècle de vastes ambitions balkaniques et lorgné, comme leurs rivaux, le port de Trieste -
projets aisément travestis, après 1945, en croisade anti-titiste. Mais l’Allemagne n’a jamais
abdiqué les siennes, sans parler de l’Italie, dont la droite a toujours affiché ses appétits
dalmates ii.
L’ouvrage est donc surtout consacré aux relations américano-vaticanes, clé d’un remodelage
de la carte de l’Europe établie par le résultat militaire de la Deuxième Guerre mondiale,
codifié par les conférences interalliées de 1945, Yalta et Potsdam. L’idylle ne date pas de
Reagan, et la thèse de la novation qu’aurait apportée ce dernier en matière de rapports entre
son pays et la Rome pontificale est particulièrement infondée (p. 223 et sq.). Assurément, le
Vatican de Wojtyla a été utilisé comme la plus efficace agence de renseignement et d’« action
psychologique », 1° pour remettre en cause le bilan européen de la dernière guerre auquel les
Etats-Unis s’étaient résignés de fort mauvais gré, le sort des armes bénéficiant aussi au
vainqueur soviétique (comme il avait servi naguère le vainqueur français); 2° pour redonner à
l' « arrière-cour » des Etats-Unis, l’Amérique latine rongée par la richesse et la misère
extrêmes, la stabilité que menaçait la mise en mouvement des humbles soutenus par les
adeptes de la « théologie de la libération ».
Le dossier ne relève pas de l’amour fou entre le président républicain et le pape polonais, mais
des vieilles priorités respectives de Washington et du Vatican. A la fin du premier conflit
mondial, les Etats-Unis eurent besoin d’une force idéologico-politique stabilisatrice cruciale
pour rétablir en Europe le statu quo mis en péril par la guerre et l’agitation, révolutionnaire ou
non, qui lui succéda: c’était une des conditions préalables à l’ouverture aux produits et aux
capitaux américains de la porte du Vieux Continent - à commencer par celle de l’Allemagne
vaincue, pays européen doté du capitalisme le plus moderne, le plus concentré et déjà lié,
avant 1914, aux plus puissantes firmes américaines (banque, chimie, électricité, etc.);
Washington lorgnait aussi les ressources des vastes empires coloniaux de ses alliés-rivaux de
l’Entente, fournisseurs potentiels de matières premières à bas prix pour l’heure affectées aux

4
seules métropoles, et terres ultramontaines par excellence, avec leurs missions catholiques
régies par le Vatican.
Celui-ci, qui avait pendant le conflit mondial engagé ses forces au service des Empires
centraux, trouva dans ce partenaire un allié pour briser une Entente fragile, car divisée sur les
buts de guerre: il s’appuya sur les Américains résolus à reconstruire vite un Reich-pivot de
leur pénétration en Europe, ou plutôt à lui éviter une bonne part du coût élevé de sa défaite.
Seule la réduction à l’impuissance de l’Entente européenne - et surtout de la France,
vainqueur militaire au programme de paix dure - préserverait les chances de réalisation des
plans territoriaux allemands. Objet fréquent des discussions, depuis le début de la guerre et
plus encore lorsque se confirma la déroute, entre la Curie et le Reich promu au fil des ans
héritier unique de l’empire austro-hongrois condamné, ils visaient un double objectif: la
récupération de l’Altreich - celui d’avant Versailles - et l’expansion territoriale, allant de la
reprise totale de l’ancien Empire des Habsbourg (à partir du pivot autrichien) à de nouvelles
conquêtes, entre annexion et contrôle total, de la Russie (Ukraine et pays baltes d’abord) à la
Belgique. Défini lorsque Berlin comptait sur la victoire, ce programme impérialiste quasi
illimité - qui impliquait revanche et que mettrait en oeuvre l’ère hitlérienne -, fut strictement
maintenu à l’heure de la défaite iii.
L’ouvrage, sans le préciser, resitue donc en fait le pontificat de Jean-Paul II dans une
perspective de long terme, ce qui nuance sérieusement sa thèse centrale du règne-miracle
terrassant « l’empire du mal ». Vers la fin de la Première Guerre mondiale, Etats-Unis et
Vatican établirent des relations largement dictées par leur souci respectif du sort du Reich.
L’intelligent nonce à Munich Pacelli déclara dès mars 1918 que « l'unique planche de salut
désormais était l'Amérique ». La « planche » ne permit pas à l’Allemagne d’éviter la défaite -
qui constituait aussi un but de guerre américain -, mais elle se révéla solide. L’alliance, étayée
par un financement considérablement accru des catholiques américains soutenus par leur Etat,
se noua sur une double base: la mise en place, imposant le truchement vatican, d’un énorme
appareil missionnaire américain, dès le début des années vingt, dans une Chine jusque là
dévolue aux Européens (France en tête, bénéficiaire depuis 1858 des privilèges du protectorat
catholique de Tien-Tsin); la campagne en faveur d’une « paix chrétienne », douce au Reich,
qui rassembla les nouveaux alliés contre l’impitoyable « paix de vengeance » de la France sur
des thèmes rassembleurs, culminant lors de l’occupation franco-belge de la Ruhr de 1923: on
stigmatisa de conserve la France martyrisant le Reich anéanti et pillé, imposant « la honte
noire » (ses troupes coloniales noires et arabes) à ce parangon de la « civilisation (Kultur)
européenne », la France révolutionnaire, impie, bolchevisée et « enjuivée » (la presse
catholique dénonçait volontiers dans chaque occupant un juif quand ce n’était pas un
« nègre »). Contribuant largement à cette offensive, les fonds américains, largement diffusés
dans les diocèses allemands, vinrent entre autres soutenir la « résistance passive » (et active) à
l’occupation de la Ruhr; y compris la mission de l’émissaire vatican Testa venu appuyer ladite
résistance et tenter d’abattre les obstacles nés de l’occupation française de l’Ouest allemand.
Cet aspect de l’intervention américaine accompagna les pressions financières écrasantes
exercées sur la France par le prêteur de dollars depuis la guerre (banque Morgan en tête).
Elles aboutirent à la première capitulation française de l’après-guerre - préfiguration de la
capitulation militaire de 1940 -, l’acceptation (dès la fin de 1923) du « Plan Dawes » qui, en
1924, sonna le glas de la « paix dure » en amorçant la liquidation des réparations et de
l’occupation iv.
C’est dans ce contexte idyllique que le jeune prélat irlando-américain Spellman (36 ans), ami
de Pacelli et d’un intime de ce dernier, le comte Enrico Galeazzi - bientôt chargé des fonds
américains affectés au Vatican -, amorça en 1925 à Rome même sa fulgurante carrière de
trésorier des « chevaliers de Colomb ». A cette organisation intégriste adhéraient certaines des
plus grandes familles financières germano- ou irlando-américaines, aussi violemment anti-

5
anglaises qu’antifrançaises et antibolcheviques, dont le discours enflammé masquait de
substantiels intérêts temporels. A ses responsabilités financières, essentielles, le futur
archevêque de Boston adjoignit d’emblée la fonction de chef des services de renseignements
américains au Vatican, qui revêtirait tant d’importance pendant et après la guerre suivante.
Dans une Europe ravagée par la Grande Crise, l’atout vatican ne fit que s’apprécier: on le vit
bien en octobre-novembre 1936, lorsque Pacelli et Galeazzi, les deux «agent[s] principa[ux]
des "chevaliers de Colomb" en Italie», partirent en toute hâte vers New York, pour conjurer
«une crise de trésorerie aiguë». Le Vatican put ainsi resserrer les liens avec des «fidèles
américains» qui commençaient à bouder le « denier de Saint-Pierre », utilisé en «presque
totalité» au prêt «à M. Mussolini» des fonds nécessaires à «la conquête de l'Abyssinie» puis
au soutien de la rébellion franquiste contre la république espagnole. Pacelli y discuta avec
Roosevelt des moyens d’apaiser les soubresauts, fâcheux pour les deux Etats, de l'Amérique
latine (Mexique en tête) et d’une Europe où Washington préparait son avenir : « c'est le
danger croissant du communisme qui a fait l'objet principal de leur conversation», rapporta un
diplomate français.
Tout en déployant de considérables efforts, comme pendant la Première Guerre mondiale,
pour maintenir les Etats-Unis dans la neutralité, la Curie mit deux fers au feu à l’orée de la
Deuxième. Plaçant à nouveau toutes ses forces au bénéfice du germanisme, cette fois allié à
l’Italie dans le cadre de « l’Axe », elle conclut avec Roosevelt - par ailleurs combattu, à peine
en sous main, par ses féaux sur place - une alliance quasi officielle: à la fin de 1939, on apprit
que serait nommé «représentant personnel du président auprès du pape Pie XII» le richissime
protestant Myron Taylor, ancien président de l'US Steel très lié par ses investissements à
l'Italie où l’accueillait souvent sa somptueuse villa de Florence. Consacrée par des
financements étatiques énormes, cette alliance, fort ambiguë, n’abolit à aucune étape de la
guerre le soutien éperdu du Vatican au Reich. Aucun des deux alliés forcés n’ignorait le
caractère forcé de cet attelage, mais leurs intérêts respectifs y trouvaient leur compte: pour sa
part, Washington visait surtout à bénéficier en ce début de conflit, par le truchement du
Vatican, d’« une source d'information d’une importance considérable sur l’Allemagne, l'Italie
et l'Espagne ».
L’alliance fut conflictuelle jusqu’en 1942, où l’emporta du côté américain la priorité de la
défaite de l’Axe, condition d’un nouveau compromis avec le Reich: le payeur américain, via
Spellman et l’adjoint permanent de Taylor, Harold Tittman, haussa souvent le ton contre la
conception très germano-italienne du «principe des nationalités» de Pie XII. Après Stalingrad,
l’emporta la priorité du remodelage futur de l’Europe, avec ses caractéristiques semblables à
celles de la première Paix. Cette étape décisive de la défaite allemande atténua un peu
l’urgence militaire en posant surtout les problèmes de l'après-guerre. Les conflits entre
Vatican et «planche de salut» américaine ne disparurent point mais, malgré la fureur de Pie
XII contre la «capitulation sans conditions» requise en janvier 1943 par les Anglo-Américains
à la conférence de Casablanca, ils s'adoucirent au profit du front commun contre les
conséquences prévisibles de la participation de l'URSS à la victoire alliée: sa récupération des
frontières de l’ancien Empire russe, but de guerre affiché dès l’attaque allemande de juin
1941, et son contrôle sur l’Europe orientale. L’une et l’autre conditions brideraient
sérieusement le Reich, mais écarteraient aussi les Etats-Unis d’une zone séduisante par
l’abondance de ses matières premières agricoles et industrielles et le bon marché de sa main-
d’œuvre v.
Spellman avait en temps de guerre dirigé le service de renseignement américain à Rome,
baptisé (presque comme en 1915) « service vatican d'informations pour les prisonniers et les
réfugiés de la guerre»: sa navette permanente entre l’Amérique et l’Europe avait des étapes
romaines obligées. Il cautionna l’organisation, entamée dès 1943, d’un service de sauvetage
des criminels de guerre dirigé par deux têtes de la Curie: l’une, pourvue de fonctions
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%