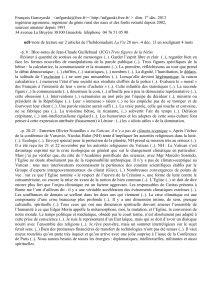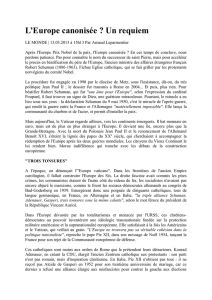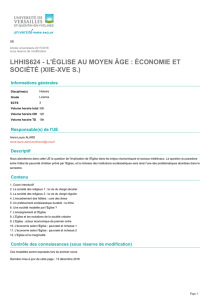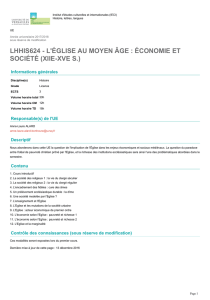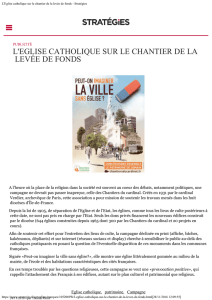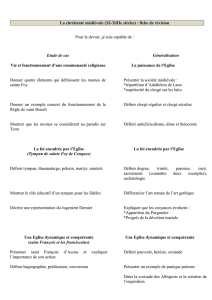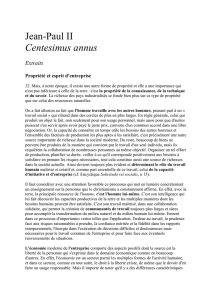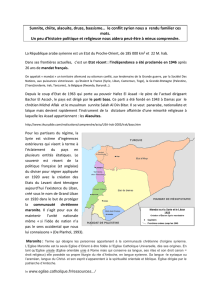Plongée dans les ténèbres d`une église égarée

Plongée dans les ténèbres d’une église
égarée
Saviez vous que Luis Buñuel – cet irréductible blasphémateur, ce surréaliste flamboyant, ce
solitaire insurrectionnel, cet inimitable cinéaste en un mot – avait, quelque part dans le cinéma
hispanophone, un fils caché ? Par des voies non élucidables, une miraculeuse germination a en
effet transporté l’esprit du grand Luis en terre chilienne chez un garçon de la haute bourgeoisie
locale, né sous le soleil noir du général Pinochet. Ce bambin prénommé Pablo, né en 1976,
longtemps bercé par les ignominieuses atrocités du vieux capo, est entré en cinéma
tardivement, mais a signé, depuis 2006, sous le nom de Larrain, cinq longs-métrages qui sont
autant de jalons d’une œuvre asphyxiante, marchant résolument vers vous avec le sourire de
l’épouvante, rayonnant d’une élégance sardonique, imposant l’insidieux dérèglement de sa folle
singularité. Trois de ces films (Tony Manero, 2008 ; Santiago 73, post-mortem, 2010 ; No,
2012) composent une fascinante trilogie dont le pivot est le régime fasciste et néolibéral du mal
nommé Augusto.
Tandis qu’on crédite ce surdoué du cinéma de la préparation, au Chili, d’un film consacré au
poète Pablo Neruda, et de la réalisation, à Hollywood, d’une œuvre évoquant Jackie Kennedy
après l’assassinat de son mari, nous parlerons aujourd’hui de son cinquième et nouveau long-
métrage, El Club. Réalisé en quatrième vitesse, néanmoins cinglant et plus bizarre que jamais,
ce film, disons-le tout net, tinte de toutes les breloques pendues ces dernières années au
revers de certains dignitaires de la sainte Eglise apostolique et romaine, au premier chef celle
de la pédophilie. Et, comme toujours chez Larrain, de la tenue dans le malaise, une atmosphère
nimbée d’étrangeté, de la misère percluse d’humanité, une descente aveuglante dans la ouate
affective de ceux qui se sont rendus coupables des pires forfaitures.
Une bande de loups gris
Ici, une maison bien ordonnée dans une modeste station balnéaire. Dedans, des hommes
plutôt âgés, policés, courtois, qui se livrent sous la houlette d’une bonne sœur franchement
inquiétante à des rites tranquillement profanes. Repas à heures strictes. Conciliabules au salon.
Encanaillement vénal au dehors, où la bande de vieux farceurs effectue clandestinement, avec
l’aide de Sœur Sourire, des paris sur des courses de lévriers. On reconnaîtra, dans cette bande
de loups gris, la figure à la fois hiératique et veule qu’Alfredo Castro, acteur fétiche de Larrain,
confère si admirablement aux monstres tristes qu’il incarne à tour de rôle dans l’œuvre du
cinéaste.
Ceci appelant cela, l’air de rien, il finit par apparaître que cet inoffensif aréopage regroupe des
ecclésiastiques qui ont fauté assez gravement pour que le Vatican les soustraie en ces lieux
retirés à la justice des hommes. Or, voici qu’un nouveau pensionnaire arrive, que la justice

divine rattrape d’emblée, sous la forme d’un innocent qui vient hurler sous les fenêtres de la
maison les turpitudes sexuelles et morales que le nouvel arrivant lui faisait subir en sa prime
jeunesse d’élève des bons pères. On s’affole aussitôt dans la maisonnée, les anciens,
plausiblement mal intentionnés, confient au nouveau un pistolet qui dormait planqué quelque
part pour qu’il dissuade le fou de leur faire une telle publicité, de sorte que le pauvre homme,
déjà plus mort que vif, préfère se tirer en chemin une balle dans la cafetière.
Le tragique et la farce
On est là, tout au plus, au premier tiers du film et l’on se demande un peu comment le
réalisateur va relancer la machine. Nous n’en dirons évidemment rien, sinon que l’arrivée d’un
émissaire du Vatican, psychologue et enquêteur, transforme le film, sous un faux air de polar,
en chronique impitoyable des égarements de certains hommes d’Eglise, et à travers eux de
l’Eglise elle-même, dont le rapport à la dictature, passant du soutien à la dénonciation, fut
ambigu.
Là-dessus, une forme qui oscille entre le trivial et le solennel, le tragique et la farce, l’horreur la
plus vive et la très basse intensité. Jean-Sébastien Bach et Arvo Part à la musique. Des lentilles
soviétiques des années 1960 qui regardent ce bas monde pour nous. Un demi-jour qui domine,
entre aube et crépuscule, au physique comme au moral. Mais quel est donc ce monde terni,
blafard, indécis, indistinct, retiré en lui-même, à demi englouti, qui ne cesse de démentir la
citation génésiaque pourtant mise en exergue au début du film : « Dieu vit que la lumière était
bonne. Et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres » ? Le nôtre, selon toute apparence.
Jacques Mandelbaum
© Le Monde
18 novembre 2015
1
/
2
100%