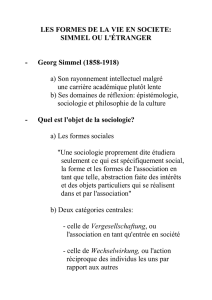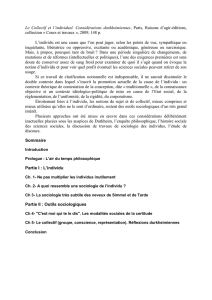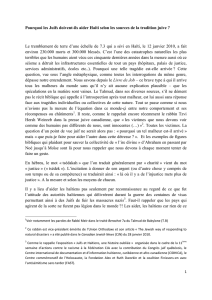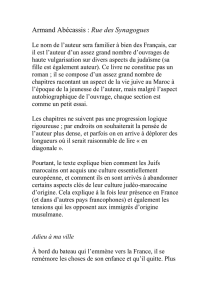La sociologie : une secte juive ? Le judaïsme comme milieu d

Revue germanique internationale
17 | 2002
Références juives et identités scientifiques en
Allemagne
La sociologie : une secte juive ? Le judaïsme
comme milieu d’émergence de la sociologie
allemande
Dirk Kaesler
Traducteur : Céline Trautmann-Waller
Édition électronique
URL : http://rgi.revues.org/887
DOI : 10.4000/rgi.887
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 15 janvier 2002
Pagination : 95-110
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Dirk Kaesler, « La sociologie : une secte juive ? Le judaïsme comme milieu d’émergence de la
sociologie allemande », Revue germanique internationale [En ligne], 17 | 2002, mis en ligne le 26
septembre 2011, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://rgi.revues.org/887 ; DOI : 10.4000/
rgi.887
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Tous droits réservés

La sociologie : une secte juive ?
Le judaïsme comme milieu d'émergence
de la sociologie allemande
DIRK KAESLER
Parmi les milieux qui ont eu une certaine importance pour l'émer-
gence et l'évolution de la sociologie en Allemagne entre 1909 et 1934 on
peut distinguer trois grands ensembles : la bourgeoisie ou plus spécifi-
quement celle des propriétaires et directeurs de grandes entreprises
(Besitzbürgertum), les socialistes et le milieu
juif.
Examiner le judaïsme
comme un milieu d'émergence de la sociologie permet de rendre compte
de l'importance qu'a eu d'un point de vue épistémologique l'étiquetage
en tant que « juif
»
pour nombre de scientifiques qui ont participé de
façon significative à l'entreprise collective de constitution et d'institution-
nalisation de la sociologie scientifique en Allemagne entre 1909 et 1934.
Une telle analyse permet aussi de comprendre l'importance que cet éti-
quetage social, qui devint de plus en plus une stigmatisation, a eu pour
l'appréciation interne et externe de la sociologie allemande de cette
époque.
Lorsqu'on s'intéresse aux liens entre judaïsme et sociologie, on se
trouve pris souvent entre deux positions extrêmes. Si parmi les études déjà
réalisées en histoire des sciences et en sociologie des sciences sur les débuts
de la sociologie allemande, aucune ne
s'est
préoccupée de manière précise
de cette question, les conversations avec les auteurs de ces mêmes études,
comme par exemple Joseph Ben-David, Lewis A. Coser, Edward A. Shils
ou Kurt
Wolff,
m'ont permis de me rendre compte que ce silence ne
s'explique pas par la conviction qu'il n'existe aucune relation entre
l'appartenance au judaïsme d'une fraction significative des premiers socio-
1.
Voir Dirk Kaesler, Die frühe
deutsche
Soziologie 1909 bis 1934 und ihre Entstehungs-Milieus. Eine
wissenschaftssoziologische
Untersuchung, Opladen, 1984. Une première version de cet article est parue
en allemand, Dirk Kaesler, « Soziologie ist eine jüdische Sekte », Das Judentum als zentrales
Entstehungs-Milieu der frühen deutschen Soziologie, in E.-V. Kotowski, J. Schoeps et B. Vogt
(éd.),
Wirtschaft und Gesellschaft. Franz Oppenheimer und die Grundlegung der Sozialen Marktwirtschaft,
Berlin, 1999, p. 15-42.
Revue germanique
internationale,
17/2002, 95 à 110

logues allemands (indépendamment du fait de savoir s'il
s'agit
d'une auto-
définition ou d'une identité imposée de l'extérieur) et leur production
scientifique. Bien au contraire, on m'assura à maintes reprises lors de ces
conversations qu'il existe bien ici des liens tout à fait significatifs. Ce sont
souvent des motifs d'ordre très personnel qui expliquent la réticence à
aborder cette problématique dans des textes publiés. On ne doit pas
oublier en effet, et c'est là l'autre extrême dans cette question, qu'un des
prétendus « arguments » de la propagande national-socialiste contre une
partie des premiers sociologues allemands et contre un certain type de
sociologie fut que la sociologie était en fin de compte une « science juive »,
c'est-à-dire une « science non allemande » et je suis tout à fait conscient de
la nécessité historique et éthique qu'il y a par conséquent, surtout pour un
sociologue allemand, à aborder cette problématique des liens entre
judaïsme et sociologie d'une manière très prudente et différenciée.
DES RAPPORTS ENTRE JUDAÏSME ET SOCIOLOGIE
Si nous voulons aller au-delà de la thèse générale souvent reprise, qui
caractérise la bourgeoisie juive en Allemagne comme une « culture de
classe montante », qui, en raison de sa discrimination sociale, fut écartée et
refoulée vers les professions libérales comme le barreau, la médecine, le
journalisme, et que nous nous tournons vers le problème spécifique du
rapport des juifs aux débuts de la sociologie allemande, il faut avant tout
répéter qu'il n'existe à ce jour aucune étude de cette question. Seul l'essai
de René König sur
Les
juifs et la
sociologie1
peut nous servir ici de point de
départ.
König ouvre son esquisse en citant une « anecdote humoristique »
attribuée au germaniste juif Friedrich
Gundolf,
« politiquement libre de
tout soupçon ». Celui-ci aurait dit, probablement suite au Congrès des
sociologues qui s'était tenu à Heidelberg en 1924 : « Maintenant je sais au
moins ce qu'est la sociologie
!
La sociologie est une secte juive. »2 Ma
propre analyse de ce IVe Congrès des sociologues3 ne me permet pas de
partager l'évaluation de cette anecdote de Gundolf comme « humoris-
tique » et « politiquement fibre de tout soupçon ». Je vois bien plutôt en
elle une reprise du préjugé antisémite de la sociologie comme d'une
« science juive » qui se veut en même temps une dénonciation de cette
dernière. Je pense toutefois comme König que cette « anecdote » repré-
sente une réaction de l'époque au fait « que parmi les sociologues impor-
1.
René König, « Die Juden und die Soziologie », in R. König, Studien zur Soziologie, Franc-
fort-sur-le-Main, 1971, p. 123-136.
2.
Ibid.,
p. 123.
3.
Voir Dirk Kaesler, « Der Streit um die Bestimmung der Soziologie auf den Deutschen
Soziologentagen 1910-1930 », in M. Rainer Lepsius (éd.), Soziologie in Deutschland und Österreich
1918-1945, Opladen, 1981, p. 214-220.

tants le nombre des chercheurs juifs [était] bien plus élevé que dans la vie
scientifique et culturelle en général »1.
König ne précisant pas cette constatation d'un point de vue quantitatif,
je renvoie à une étude de John Torrance sur « La naissance de la socio-
logie en Autriche 1885-1935 »2 dans laquelle ce dernier qualifie 15 des
38 sociologues autrichiens évoqués par lui de « juifs » : il
s'agit
d'Alfred
Adler, Friedrich Adler, Max Adler, Otto Bauer, Walther Eckstein, Eugen
Ehrlich, Rudolf Eisler, Sigmund Freud [!], Rudolf Goldscheid, Ludwig
Gumplowicz, Ludo Moritz Hartmann, Rudolf Hilferding, Wilhelm Jerusa-
lem, Hans Kelsen et Otto Neurath. Ce qui est problématique dans cette
ennumération, dans laquelle apparaissent quatre sociologues que j'ai
compté moi-même parmi les premiers sociologues allemands, c'est que
Torrance n'a pas défini son critère de
«
juif
».
Tout au plus renvoie-t-il à
une « famille juive », en indiquant cependant lui-même que certains
auteurs, comme Gumplowicz, Ehrlich ou Kelsen, se convertirent au chris-
tianisme. Ceci mis à part, je rejoins Torrance lorsqu'il écrit :
« On pourrait spéculer que la sociologie et la psychanalyse se ressemblaient en ce
qu'elles attiraient des intellectuels juifs qui avaient le goût de la recherche scienti-
fique et qui avaient besoin, à l'intérieur de l'identification externe générale avec la
culture humaniste allemande, d'une identité oppositionnelle plus intime, leur per-
mettant d'atteindre à travers une érudition critique un statut européen et donc
universel qui transcende le particularisme de l'élite allemande, surtout à partir du
moment où cette dernière devenait de plus en plus antisémite. »3
On rencontre cette idée d'une « identité oppositionnelle » des sociolo-
gues juifs également dans le tableau de König, qui tentait d'expliquer
« l'affinité particulière du chercheur juif avec la sociologie » à l'aide de la
situation sociale et culturelle des juifs dans les sociétés modernes. Partant
de la caractéristique « des juifs » comme d'un peuple paria, c'est-à-dire
d'un « peuple-hôte » discriminé et séparé du monde social environnant par
des rites, des formes et des faits, développée de manière détaillée par Max
Weber, König voit des liens étroits entre le judaïsme ainsi envisagé et le
choix de la sociologie. L' « émancipation juive » est selon König un événe-
ment parallèle à l'évolution et à la libéralisation de la société bourgeoise à
partir de l'État absolutiste, cette libéralisation de son côté étant « une des
conditions principales pour la naissance de la sociologie. [...] Les condi-
tions, qui présidèrent à une émancipation des juifs furent donc en grande
partie les mêmes que celles qui virent naître la société économique
moderne et, avec elle, la sociologie comme instrument de connaissance de
cette société »4.
1.
René König, op. cit., p. 123.
2.
John Torrance, « The Emergence of Sociology in Austria », in Archives
européennes
de socio-
logie,
vol. 17 (1976), p. 185-219.
3.
Ibid.,
p. 195.
4.
René König, op. cit., p. 128.

En même temps l'émancipation des juifs, terme qui signifie ici essen-
tiellement la sortie du ghetto, ne conduisit qu'à une intensification de la
discrimination sociale des juifs, qui, du point de vue de la majorité chré-
tienne, ne furent que des « membres sous réserve » dans les sociétés euro-
péennes du
XIXe
siècle. Partant de ces réflexions, König postule un lien de
contenu et un lien personnel entre le judaïsme et la sociologie. Puisque
socialement une « alliance avec le pouvoir » aurait été impossible pour les
juifs,
« nous trouvons la pensée juive participant à tous les projets où la
pensée sociale se présente comme une critique sociale, et surtout comme
une critique du pouvoir (...) »1.
König évoque principalement les juifs Karl Marx, Moses Hess, Émile
Durkheim, Franz Oppenheimer et Georg Simmel comme des cas dans les-
quels la discrimination sociale aurait fait naître une « prise de distance »,
qui à son tour aurait mené à la sociologie. Cette distanciation leur aurait
ensuite permis de percer à jour les « évidences culturelles » qui munissent
de préjugés tout membre « naïf » d'une communauté, car elle produit une
connaissance « adéquate » de la société environnante, elle favorise « la
liberté incorruptible et l'indépendance du regard » et conduit surtout à
« démasquer » les préjugés et les stéréotypes nationaux. S'inspirant de
Georg Simmel, König trace ainsi un portrait du sociologue juif comme
d'un « étranger » dans la société avec ce mélange complexe de « proxi-
mité » et « distance » qui en tant que « liberté de la distance » aurait
conduit à un « savoir d'un genre particulier ».
Cette description de l'affinité particulière des intellectuels juifs avec la
sociologie depuis le tournant du siècle jusque dans les années 1930 m'a
été utile comme hypothèse de travail, mais il a été nécessaire d'examiner
de manière critique le stéréotype, sans cesse répété dans tous les travaux,
de la « marginalité » et de « l'aliénation » des intellectuels juifs. Il faut se
demander effectivement en quoi consistait pour chacun des individus le
rôle de « marginal », réel ou supposé, d'un point de vue économique,
culturel, social ou politique. Parler ici de « marginalité » sans différencier
peut conduire à aplatir inutilement des différences typologiques comme
celles qui existent par exemple entre les « marginalités » si différentes
d'un Max Adler, d'un Rudolf Goldscheid, d'un Max Horkheimer, d'un
Karl Mannheim, d'un Gottfried Salomon-Delatour, d'un Max Scheler ou
d'un Georg Simmel. Et pourtant ces différences pourraient peut-être
apporter des informations importantes pour la compréhension de cha-
cune de ces sociologies. Il faut vérifier également en quoi consistait exac-
tement l'appartenance de chacun des individus au judaïsme, si apparte-
nance il y avait.
La définition de König, « est juif celui qui se sait juif » ne suffisait pas
pour l'analyse que je souhaitais mener et j'ai préféré retenir la définition
suivante : est juif celui qu'on définit comme
juif,
indépendamment de la
1.
Ibid.,
p. 131.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%