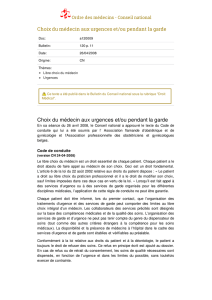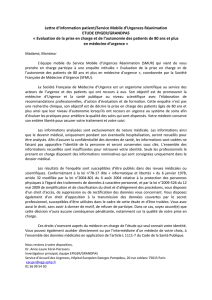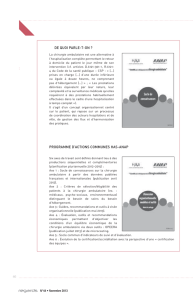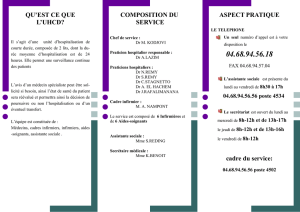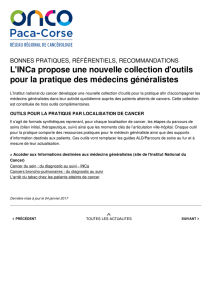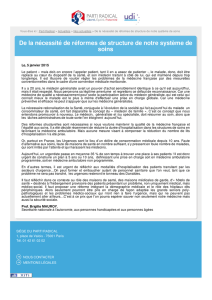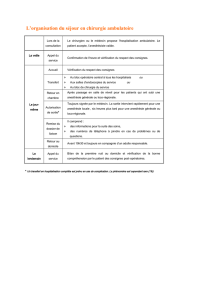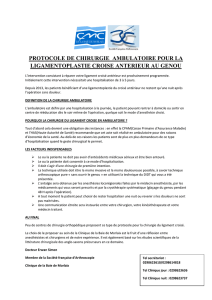Annexes du Chapitre deux : Qualité du système de soins Première

139
HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE
Annexes du
Chapitre deux :
Qualité du système de soins
Première partie :
Le périmètre des biens et
services et la qualité
médicale des actes

140
Annexe 30 : Le contenu du périmètre de prise en charge par l’assurance maladie de base dans
certains pays de l’OCDE
Dans un souci de simplicité, il apparaît plus aisé de définir « en creux » le contenu du périmètre
de prise en charge des biens et services de santé en vigueur à l’étranger.
Aussi le tableau ci-dessous présente-t-il, sous la forme d’une « liste négative », les biens et services de
santé qui ne sont pas retenus comme remboursables par l’assurance maladie de base dans les
principaux pays industrialisés. Cette étude n’est pas exhaustive, compte tenu de la difficulté de
synthétiser les données issues de très nombreuses « études-pays ».
Si les pays industrialisés présentent des soins remboursables assez diversifiés, certains traits
communs se dégagent s’agissant des biens et services non pris en charge par l’assurance maladie de
base. On peut citer ainsi : les soins et prothèses dentaires, notamment pour les adultes, les soins
ophtalmologiques et matériels d’optique médicale (monture, verres de contact, lentilles), les
médecines alternatives (acupuncture, homéopathie, ostéopathie, ergothérapie, physiothérapie, etc…),
la chirurgie esthétique, les médicaments du « bien-être », les cures thermales et les traitements de
procréation médicalement assistée.
En France, les biens et services non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sont
plutôt plus ciblés que chez nos voisins. Le périmètre de soins apparaît donc plus large qu’à
l’étranger.
Les choix des pays de l’OCDE en matière de périmètre de prise en charge
Pays Biens et services de santé totalement exclus du périmètre de soins remboursables
par l’assurance maladie de base
Allemagne traitements d’orthodontie pour les plus de 18 ans, montures de lunettes, cures thermales au-delà de
trois semaines et au-delà d’une par période de quatre ans, certains médicaments (anorexigènes,
toniques, laxatifs, contraceptifs oraux, médicaments utilisés dans le traitement des rhumes et des
refroidissements, antinaupathiques), prestations liées à la contraception, aux inséminations
artificielles et aux interruptions volontaires de grossesse ainsi que médicaments pouvant être
achetés sans ordonnance même s’ils sont prescrits par un médecin (à compter de 2004)
Australie examens et traitements dentaires, transports sanitaires, aides à domicile, kinésithérapie,
ergothérapie, chiropraxie, traitement des maladies du pied, orthophonie, orthoptie, actes des
psychologues, dispositifs médicaux auditifs, optique médicale, prothèses, chirurgie esthétique,
acupuncture, frais médicaux imputables à un autre responsable (assureur, employeur,
administration), frais médicaux non médicalement justifiés, frais d'hospitalisation en clinique privée
(frais d'opération ou séjour en clinique), examens en vue de la souscription d'une assurance-vie,
pour des cotisations à la retraite ou pour adhérer à une mutuelle ou une société de prévoyance
Belgique médecine alternative (acupuncture, homéopathie et ostéopathie) ainsi que chirurgie plastique,
montures de lunette et orthodontie dans certaines conditions, prothèses dentaires pour les personnes
de moins de 50 ans, sauf dans certaines conditions médicalement justifiées
Canada
(treize
provinces
et
territoires)
dans toutes les provinces et territoires : médecine alternative (naturopathie, homéopathie et
ostéopathie), hospitalisation en chambre privée ou semi-privée, sauf si elle est prescrite par un
médecin, fourniture de téléphones et de téléviseurs à l’hôpital, soins infirmiers privés, visite
d’optométriste au-delà d’une par an, consultation téléphonique, examens, délivrance de certificats
médicaux pour l'employeur, l'école, les assureurs (assurance automobile, assurance-vie), les clubs
de sport et de loisirs, et les témoignages devant les tribunaux, chirurgie esthétique
dans certains provinces et territoires : enlèvement des verrues et de lésions cutanées bénignes
(
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Colombie-

141
Britannique), gastroplastie (N.-E., N.-B., Yukon), circoncision de routine des nouveaux nés (Terre-
Neuve-et-Labrador, Ile-du-Prince-Edouard, N.-E., On., Alb., Y.), enlèvement de taches ovalaires
sur les yeux (T.-N., N-E., On.), hypnothérapie (T.-N.), extraction d’une dent incluse (T.-N.),
otoplastie (T.-N., I.-P.-E., N.-B., On., Alb.), détatouage (S., Man., On.), inversion de stérilisation
(I.-P.-E., N.-B., On., Man., S., Alb, Yn., N.-E, C. B.). prothèse pénienne (On., S., N.-E),
psychanalyse (Man., Québec), examen de la vue pour les personnes âgées de 19 à 64 ans (I.-P.-E.,
N.-E, N.-B., Qc., Man., S., Alb.), deuxième échographie ou échographie subséquente dans le cas de
grossesse sans complication (N.-E, C.-B.), fécondation in vitro (On., Man., T.-N., N.-E., Territoires
du Nord-Ouest), insémination artificielle/intra-utérine (N.-E, N.-B., Alb.), enlèvement de cérumen
(N.-E.), enlèvement de varices (N.-E., Qc., On., Man.), anesthésie pour un service non assuré (N.-
B., S., Alb.), services de chiropraxie (S., Québec), épilation de poils faciaux (I.-P.-E., On.),
réfractions oculaires (T.-N., S.), chirurgie d’augmentation ou de réduction mammaire (N.-E., N.-B.,
On., C.-B.), chirurgie réparatrice de l’oreille, frais d'achat, d'ajustement ou de réparation au-delà
d'une prothèse auditive par personne tous les 6 ans selon certains niveaux de perte de l'ouïe,
ambulance pour les personnes de moins de 65 ans, optométrie pour les 18 – 64 ans (Québec)
Danemark chirurgie esthétique, sauf pour des cas fondés sur des causes psychologiques ou sociales,
réflexotherapie, kinésithérapie, homéopathie, cures thermales, montures de lunette, sauf pour les
patients qui ont une très mauvaise vue, fécondation assistée sauf pour les couples hétérosexuels
dont la femme à moins de 45 ans, fécondation in vitro pour les femmes de plus de 40 ans ou, pour
les femmes de plus de 40 ans, au-delà de la troisième tentative, frais d’hospitalisation en
établissement non agréé, prothèses dentaires
Espagne cures thermales, certains médicaments (antidiarrhéiques, laxatifs, antiacides, médicaments utilisés
dans le traitement des rhumes et des refroidissements, certains anorexigènes et certaines topiques)
Etats-Unis
(exemple
de
l’Orégon)
traitements des pathologies qui s’améliorent d’elles-mêmes, pathologies sans traitement efficace,
traitements le plus souvent inefficaces, chirurgie plastique, y compris chirurgie reconstructrice,
changement de sexe, traitements destinés à résoudre les problèmes de fertilité, traitements
favorisant la perte de poids
Finlande traitements et prothèses dentaires pour les adultes nés avant 1946 (sauf vétérans de guerre),
montures de lunette, médecines alternatives, chirurgie esthétique, sauf en cas de lien avec une
pathologie (tumeurs, brûlures)
France chirurgie de la myopie, ostéodensitométrie, implants dentaires, parodontologie, certains
médicaments (anti-asthéniques, multivitamines, pilules de 3ème génération, aides à l’arrêt du tabac,
traitements des troubles érectiles et de l’obésité, certaines estrogènes, certains corticoïdes locaux,
certains antispasmodiques, traitements anti-grippe, traitements de la calvitie hormonale), chirurgie
esthétique sauf en cas de préjudice psychologique, psychothérapie non réalisée par un psychiatre
(psychologue, psychanalyste), chiropraxie, traitements ambulatoires de psychomotricité ou
d'ergothérapie, consultations de diététiciens en dehors de certains réseaux, consultations
téléphoniques, délivrance de certains certificats médicaux (à compter de 2004)
Grèce chirurgie esthétique, traitements dentaires pour les adultes (dans le régime agricole), traitements
dentaires (dans le régime des non salariés non agricoles), cures thermales, consultations et
traitements d’homéopathie
Luxem-
bourg
la plupart des tests prénataux de détection des anomalies génétiques et malformations fœtales, une
partie des traitements liés à la stérilité (ceux qui sont pris en charge nécessitent une certification, et,
dans certains cas, une entente préalable), ostéodensitométrie, chirurgie ou traitement au laser pour
corriger l'indice de réfraction (ophtalmologie), traitement chirurgical de l’obésité non fondé sur un
rapport médical détaillé indiquant que tous les précédents traitements non chirurgicaux ont échoué,
remplacement de prothèses mammaires pour lesquelles aucune entente préalable n’a été conclue au
départ, certains médicaments (produits diététiques, antiasthéniques, médicaments homéopathiques,
contraceptifs, médicaments utilisés dans le traitement des rhumes et des refroidissements,
antinaupathiques, aides à l’arrêt du tabac, produits n’ayant pas suffisamment fait la preuve de leur
efficacité ou jugés trop chers au regard des alternatives thérapeutiques)
Norvège traitements et prothèses dentaires pour les adultes, sauf pour les analgésies dentaires, montures de
lunettes, frais d’hospitalisation en clinique privée si celle-ci n’est pas agrée
Nouvelle-
Zélande
traitements dentaires pour les adultes, sauf pour les prestations d’urgence pour les personnes à
faibles ressources, optique médicale, tests opthalmologiques

142
Pays-Bas montures de lunette et verres de contact (sauf premier achat), traitements dentaires pour les adultes
(notamment les radiographies dentaires), sauf les traitements préventifs et les actes de chirurgie
dentaire, limitation des séances de kinésithérapie et de physiothérapie, fécondation in vitro au-delà
de la troisième tentative pour les femmes de plus de 40 ans, médicaments homéopathiques
Portugal traitements dentaires pour les adultes, frais d’hospitalisation en chambre individuelle à l’hôpital
privé, frais d’hospitalisation en clinique privée
Royaume-
Uni
chirurgie esthétique, sauf chirurgie réparatrice, homéopathie, effacement de tatouage, examens
d’acuité visuelle et optique médicale, sauf pour les étudiants de moins de 19 ans, les personnes à
faibles ressources et les personnes ayant de graves problèmes de vue, cures thermales, certains
médicaments (antiacides, laxatifs, analgésiques pour douleurs faibles ou moyennes, médicaments
utilisés dans le traitement des rhumes et des refroidissements, toniques, vitamines, benzodiazépines
– tranquillisants et sédatifs, antidiarrhéiques, antiallergiques, hypnotiques, anxiolytiques,
anorexigènes, contraceptifs, médicaments à action locale – gynécologiques, nez, oreilles, peau,
topiques anti-rhumatismaux, médicaments utilisés dans l’anémie), soins hospitaliers non
cliniquement nécessaires, transports sanitaires ambulatoires, sauf cas d’urgence médicale.
Suède une partie des actes dentaires pour les plus de 19 ans, fécondation in vitro au-delà d’une par an,
mammographie au-delà d’une par an, chirurgie esthétique, certains médicaments (vitamines,
laxatifs, topiques contenant du minoxidil, aides à l’arrêt du tabac, mucolytiques et antitussifs,
médicaments utilisés dans le traitement de l’obésité et dans le traitement des dysfonctionnements
érectiles)
Suisse soins dentaires (notamment les coûts des plombages habituels en cas de carie ou les frais d'appareils
dentaires pour enfants), sauf s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du
système de la mastication ou par une autre maladie grave, ou encore s'ils sont nécessaires pour
traiter une maladie grave, psychotérapie effectuée auprès d’un praticien non qualifié, hypnose,
chirurgie esthétique non liée à un accident, une maladie ou une malformation congénitale,
fécondation in vitro
Source : Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, Commission européenne,
European Observatory on Health Care Systems, Haut comité de la santé publique, Ministères de la Santé,
Parlements et régimes d’assurance maladie des pays ou collectivités locales concernés, Organisation de la
coopération et du développement économique, Organisation mondiale de la santé.

143
Annexe 31 : La redéfinition du périmètre de prise en charge par l’assurance maladie de base
dans les systèmes de soins étrangers86
L’analyse des expériences étrangères met en évidence trois types d’approche :
- la « priorisation par l’efficacité », c’est-à-dire la définition de ce que sont les soins
médicalement les plus justifiés, par opposition à ceux dont l’impact positif sur la santé des patients
n’est pas avéré. L’enjeu principal est de ne faire prendre en charge par la collectivité que des biens et
services dont l’utilité médicale est la plus certaine, quelle que soit la pathologie traitée. Les procédures
d’évaluation des médicaments et dispositifs médicaux s’inscrivent précisément dans cette perspective ;
- la « priorisation par l’efficience », c’est-à-dire la définition de ce que sont les soins
susceptibles d’améliorer l’état des patients, pour une pathologie donnée. Il s’agit, au vu de
contraintes financières, d’exclure de la prise en charge des biens et services médicalement pourtant
utiles, et ce en raison de leur rapport coût/efficacité trop élevé par rapport à d’autres ou de leur nature,
comme les médicaments dits de « confort87 » ou du « bien-être » ;
- enfin, la « priorisation ciblée », qui consiste à fixer des lignes directrices pour la
fourniture de certains biens et services de santé dans certaines conditions. Il s’agit, dans ce cas, de
limiter la prise en charge de certains traitements en fonction de critères relatifs aux patients ou aux
professionnels de santé.
La présente note se penche sur les expériences conduites en la matière et notamment aux Etats-Unis
(Etat de l’Orégon), aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou, plus
récemment, en Allemagne88. L’expérience la plus aboutie semble avoir été menée dans l’Orégon (cf.
encadré 1).
L’exemple de l’Orégon souligne qu’une politique de redéfinition explicite du périmètre de soins pris
en charge soulève de nombreuses questions complexes : qui décide de la composition du périmètre de
soins (l’Etat, le ou les assureurs, les médecins, la population), à quel niveau (national, régional, local)
et selon quelle procédure ? Ces décisions doivent-elles être explicites ou implicites ? Au vu de quels
critères ces décisions doivent-elles être prises ? Quelle doit être l’articulation entre les critères
objectifs et les valeurs d’une société ? Ces différentes questions ont partiellement reçu des réponses
dans le cadre des expériences étrangères :
1) Les pays étrangers ont généralement privilégié l’acceptabilité sociale de la réduction du
périmètre de soins à son efficacité financière
- Préférence pour le débat politique versus le débat technique : L’objectivité des critères
techniques pour déterminer les priorités n’a pas semblé de nature à emporter, à elle seule, l’adhésion
publique. L’exclusion de certains biens et services du périmètre des soins remboursés n’a pu résulter
uniquement d’un choix fondé sur des éléments objectifs, tels des ratios coûts/bénéfices, mais est
apparue comme devant faire l’objet d’un débat politique impliquant l’opinion publique.
86 Cette annexe s’appuie très largement sur le rapport de l’Inspection générale des finances sur la
régulation et l’organisation de la médecine de ville : les enseignements des expériences étrangères (mars 2003).
87 Cette dénomination est impropre et il convient d’utiliser la dénomination : médicaments utilisés dans le
cas de pathologies ne présentant pas un caractère général de gravité
88 Pour une présentation de cette approche en France, citons entre autres les travaux du Haut comité de la
santé publique (Le panier de biens et services de santé : première approche, février 2000 et Le panier de biens et
services de santé : du concept aux modalités de gestion, mars 2001).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
1
/
189
100%