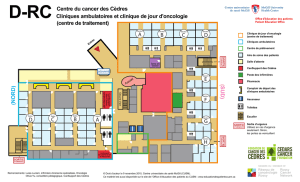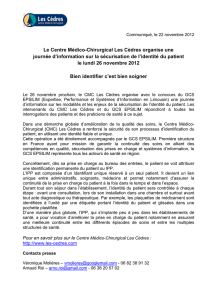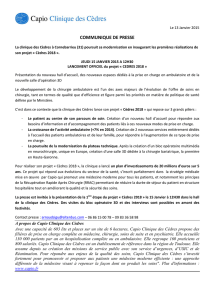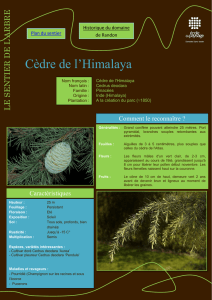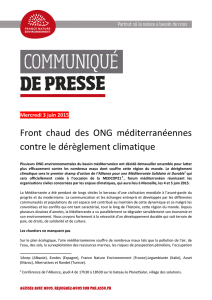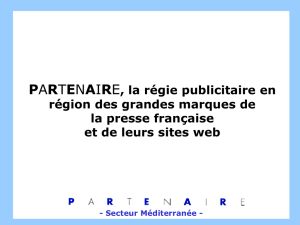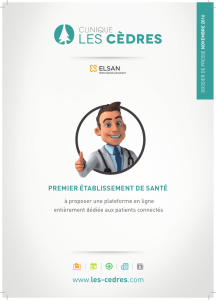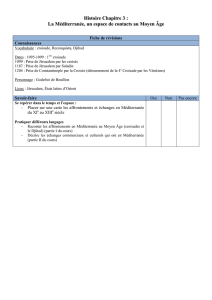nature, histoire, loisirs et forêt

LE CÈDRE DANS LA RÉALITÉ
ET DANS L’IMAGINAIRE
DE LA MÉDITERRANÉE
DE L’ANTIQUITÉ ÀNOS JOURS *
D.ARNAUD
«Les monuments naturels les plus célèbres de l’univers »
A.deLamartine
LeCèdreprésente uncurieux paradoxe:il ne fut ni laplus importantenilaplus nécessairedes réa-
lités naturelles,minérales, végétales ou animales, sur lesquelles sefondait la vie des sociétés tradi-
tionnelles de laMéditerranée. Lepalmier-dattier aurait eu et aurait encoreplus de titres queluià
faire valoir.Iln’était pas irremplaçable dans son rôle économique. Ilaacquis,pourtant, unprestige
considérable,prestige quiest resté sans éclipsejusqu’ànos jours.Dès les premiers documents
écrits,il y aquelquecinq millénaires,il tient une placeexceptionnelle dans l’imaginairedes civilisa-
tions anciennes et modernes.Quecefait soit malaisément explicable,il n’en demeurepas moins un
fait:le Cèdre représente,on ne peut queleconstater, une sorted’archétype,peut-êtrel’archétype
culturel par excellencedel’aireméditerranéenne.
Assurément,les auteurs antiques,des Assyriens aux Grecs et aux Romains,ont vanté,àl’envi,
toutes les qualités queprésentait cet arbrepour l’architecture. Ses troncs, robustes et longs,per-
mettaient de fairedes pièces de grande largeur et de vaste volume sans recourir àdes colonnes.Il
ne pourrit pas, résisteaux insectes et salongévitéapparaissait presquefabuleuse:on parlait,dans
l’Antiquité,de quatrecents ans pour le temple d’Artémis àÉphèse(aujourd’huiSelçuk,Turquie),et
même de mille ans pour celuid’Apollon àUtique(Tunisie). AussileCèdrepassait-il pour le symbole
de l’immortalitéchez les Romains.Enmême temps,il sent bon et tout aussilongtemps:les poutres
159
Rev.For.Fr.XLIX - 2-1997
*Cem’est unplaisir de remercier Mlle A.Caubet,Conservateur général,et Mme B.André-Salvini,Conservateur en chef,du
Département des Antiquités orientales,et Mme C.Bridonneau,du Département des Antiquités égyptiennes,pour avoir mis ànotre
disposition l’importantedocumentation du Musée du Louvre.
nature,histoire,
loisirs et forêt

d’unpalais assyrien àNinive(Iraq) avaient gardé intacteleur délicieuseodeur,quelque trois millé-
naires après leur miseenplace,au témoignage de l’archéologuequiles découvrit.
Son bois est facile à travailler et son poli plaisant.Les artisans de jadis appréciaient d’autant plus
ces avantages queleurs outils étaient médiocres et leurs techniques rudimentaires.Aussil’utili-
saient-ils partout pour les lambris,les belles portes et le mobilier,en Égyptepour les sarcophages,
en Égypteencoreet en Grèceàl’époquearchaïquepour la statuaire.
La réunion de ces qualités expliquequeleCèdreait étéemployédel’Antiquitéànos jours dans les
belles constructions d’unbout àl’autredelaMéditerranée,des palais mésopotamiens àl’Odéon
construit àAthènes,àl’époque romaine,par Hérode Atticus,et aux boutiques des médinas ou aux
maisons de lamontagne au Maroc.Mais ce sont les édifices religieux quil’ont utiliséleplus :les
temples assyriens du Iermillénaireavant notreère,les sanctuaires grecs,le Saint-Sépulcreau
IXesiècle,les mosquées marocaines.
Copeaux,branches et feuilles mais surtout les exsudats (queles Assyriens et les Babyloniens appe-
laient du nom pittoresquede“sang” du Cèdre) furent universellement employés d’aborddans les
brûle-parfum,particulièrement jusqu’au VIesiècle avant notreèreoù commença alors seulement à
sediffuser l’encens, venu d’Arabie. Dans laMésopotamie du IIeet du Iermillénaires,on en mâchait
lagomme,peut-être une sortedemastic, pour sepurifier l’haleine ; on en parfumait l’huile. La phar-
macopée antiquel’employait en fumigations pour la toux,en potion pour soigner les maux d’esto-
mac et comme onguent pour les maladies de lapeau.Chez les Berbères du Maroc, son goudron
distillé artisanalement sert de lamême façon à soigner les dermatoses et les douleurs stomacales
et intestinales,les maladies de labile et du foie :étrange rencontredelamédecine traditionnelle
entreles deux extrémités de laMéditerranée,àplusieurs milliers d’années de distance!Aussi,la
symboliquedes rituels religieux recourut tout naturellement au Cèdre. Dans laBible,le Lévitique
demande qu’on s’en servepour purifier quiaétéfrappé de lalèpreou quia touché unmort.La
résine servait àl’embaumement dans l’ancienne Égypteet,naguère,les Kabyles brûlaient du Cèdre
avant ladescentedu corps dans la tombe.
Superbequand,isolé,il a tout l’espacenécessairepour étaler ses branches,le Cèdrefut planté
comme arbred’ornement;lamode en fut lancée par les Assyriens quil’introduisirent,au VIIesiècle
avant notreère,dans leurs parcs,quijouaient pour eux le double rôle de jardins d’agrément et de
jardins botaniques.Les Babyloniens puis les Grecs, une fois installés au Proche-Orient au IVesiècle,
apprirent àl’apprécier et les Romains le diffusèrent dans tout leur empire.
Reproduiredes arbres par semis ou par transplantation n’était doncpas inconnu des civilisations
anciennes.Cependant,aucune n’eut jamais l’idée d’entreprendrele reboisement systématiquede
telle région en investissant ainsipour l’avenir.Jusqu’àl’époquemoderne,on secontentad’exploi-
ter les forêts existantes,en comptant sur leur renouvellement naturel. L’historien est bien en peine
de décrirelagéographie de l’exploitation des Cèdres car les documents qu’il aà sadisposition sont
très maldistribués aussibien dans le temps quedans l’espace. Avant l’Antiquitégrecqueet
romaine,il y acertes de nombreux textes mais exclusivement du Proche-Orient.Même pour le
Moyen-Âge et pour l’époquemoderne,nous sommes bien mieux renseignés sur l’Est que sur l’Ouest
de laMéditerranée. Hasarddes sources mais dont on ne peut pas ne pas tenir compte.
Depuis le IIIemillénaire,l’Égypteenvoyait ses navires au Libanpour en rapporter les billes dont elle
avait besoin,et cettepratiquefut constanteet ne s’interrompait quependant les périodes d’anar-
chie dans la vallée du Nil. La production libanaise s’exportamême jusquedans laCrèteminoenne
du millénaire suivant.Depuis lamême époque,aussi,l’on exploitait,pour laSyrie comme pour la
Mésopotamie,plus au nord,les Cèdres de l’Amanus.Enplus du commerce,forme normale de l’ex-
ploitation,les rois asiatiques recouraient au tribut.Les Assyriens seprocuraient ainsi,àbon compte,
auprès des princes syriens,des troncs du Taurus.Enfin,menant en personne leurs armées,d’une
manièrefréquenteàpartir du XIesiècle,ils montaient des expéditions,mi-conquêtemi-pillage,et
allaient couper sur laMéditerranée les Cèdres dont ils jugeaient avoir besoin. La techniquelaplus
D.ARNAUD
160

rudimentaire,cequine signifie pas qu’elle n’ait pas étépratiquée jusqu’au siècle dernier,était de
traîner les billes,en y attelant hommes ou bêtes;les charrois de troncs siénormes étaient malai-
sés et dangereux mais plus efficaces.Flottage ou remorquage étaient évidemment les procédés les
plus commodes et les cédraies les plus proches d’uncours d’eau ou de lamer étaient les plus
appréciées.Cefurent celles queladéforestation atteignit les premières.
Suivreles progrès de cephénomène est plus malaiséencoreque rendrecomptedel’exploitation ;
les contemporains n’en avaient pas une conscienceclaireet n’en dirent rien. Encorenefaudrait-il
pas en exagérer l’importancedans l’Antiquitéet au Moyen-Âge. Autant qu’on puissel’apprécier
maintenant,l’exploitation ancienne restamodérée,même sielle sepoursuivit pendant des millé-
naires,àcaused’aborddelamédiocritédes moyens techniques mis en œuvre. Pour fixer les idées,
encoredans les années cinquantedenotre siècle,les procédés traditionnels ne permettaient de
récolter qu’1 à 2 m3àl’hectare. Les royaumes syriens,autreexemple, se voyaient imposer lalivrai-
son de 200 à 300 billes annuellement par leur maîtreassyrien,même sil’on ne sait pas quel pour-
centage cechiffre représentait par rapport àleur production totale. D’autrepart,cequia sauvéles
Cèdres,àl’inversedes autres essences proches de lui,c’était queles charpentiers de marine,
antiques et médiévaux,préféraient le Pin,le Sapin ou le Cyprès pour leurs flottes.Aussiétaient-ils
encoreabondants dans lamontagne libanaiseau IVesiècle de notreère:les constructeurs de la
basiliquechrétienne de Tyr s’en procurèrent facilement.Chypreafourni du bois de marine jusqu’au
Xesiècle de notreère. Mais il est vraiqu’après avoir recherché les Cèdres sur les pentes orientales
de l’Amanus,on fut forcédepasser sur ses pentes occidentales puis de descendreau Iermillénaire
vers le Libanet,plus au sudencore, vers l’Hermon.
Les aires principales où se trouvaient les cédraies restèrent les mêmes de lafin de l’Antiquité
jusqu’ànos jours,c’est-à-direpour le Cedrus libani :le Taurus et l’Anti-Taurus ciliciens et lamon-
tagne libanaise,pour le Cedrus brevifolia:Chypre,enfin,pour le Cedrus atlantica :les Atlas maro-
cains et des peuplements discontinus en Algérie.
La diminution des forêts de Cèdres dans cettedernière région,bien connue,est particulièrement
significative; elle montre,d’une manièreexemplaire,queles ravages de ladéforestation ne furent
en fait vraiment brutaux qu’au XIXesiècle, sous l’effet de deux causes.Tout autour de la
Méditerranée,l’accroissement démographiqueapousséàaugmenter les surfaces cultivables et à
élargir simultanément les terrains de pacage ; de plus,par places,l’industrialisation locale semit à
exiger du combustible en abondance,empirant ainsila situation.
Encore,àlafin du IIIemillénaire,nos premières sources montrent quelaMésopotamie du sud se
satisfaisait de seprocurer,par le commerce,cematériau exceptionnel ; attitude qui restacelle de
l’Égypte,pendant toute son histoire. Mais,ensuite,les monarques asiatiques firent de laconquête
de la“montagne aux Cèdres”,Amanus et Liban,lapreuvedeleur volontéimpériale de dominer le
Proche-Orient.Tous ceux d’entreeux quipurent entreprendrecetteexpédition (il fallait,d’abord, se
frayer unpassage de viveforce vers laMéditerranée) en rapportèrent le récit aveccomplaisance:
l’Univers,leur univers connu du moins entreZagros et Taurus,avait manifesté son obéissancemani-
feste. Les ambitions politiques l’emportaient indiscutablement sur les motifs économiques.Ils
auraient pu beaucoupplus facilement seprocurer du bois de charpented’autres essences,des pié-
monts plus proches de laMésopotamie,du Taurus oriental,alors densément boisé. Cefut d’ailleurs
lapratiquecourante:les découvertes archéologiques montrent quec’était la sourced’approvision-
nement normale ; pourtant,les textes n’évoquent queles forêts méditerranéennes.Aussi, une pro-
phétie,mise sous le nom d’Isaie,àlafin du VIesiècle avant notreère,fait-elle se réjouir Cèdres et
Cyprès de lachutedeBabylone ; ses rois ne viendront plus les abattre.
Cettepersonnification n’a rien d’original; les textes bibliques aiment àévoquer le Cèdre,d’ailleurs
d’une manièreambivalente. Ils y voient tantôt le symbole de l’homme droit et fort dans sajustice,
tantôt l’image de l’orgueilleux queDieu sait bien punir,en le jetant à terre, s’il le veut.Cetteambi-
guïté se retrouvechez ceux qui s’y attaquaient: toujours fiers d’avoir pu le faire,ils s’excusent
Nature,histoire,loisirs et forêt
161
Rev.For.Fr.XLIX - 2-1997

toujours de l’avoir fait.Ainsi,bien avant laprisedeconsciencecontemporaine,l’attitude des
Anciens fut longtemps contradictoire. Depuis le IIIemillénairejusqu’aux Perses,les textes histo-
riques et littéraires de l’ancien Orient au moins (nous ne savons rien pour les autres régions)
aimaient développer ce thème,d’autant plus riche qu’il impliquait contradiction :abattrede tels
arbres (àl’exclusion de toutes les autres essences,quelles qu’elles fussent,cefait est digne de
remarque) était unacted’une exceptionnelle gravité,àlafois une mauvaiseaction, une sortede
crime,mais, tout aussibien,c’était unexploit quihissait son auteur au niveau des héros.Onplan-
tait une stèle sur placepour marquer son succès pour lapostérité,mais on prenait bien garde,en
même temps,d’apaiser les dieux par des sacrifices.On rapportait avecprécision quelebois serait
destiné aux constructions les plus nobles,pour les palais mais surtout pour les sanctuaires.En
somme,on avançait comme raison implicite unmotif altruiste:le servicedivin.
Comme nous,les Anciens ont été sensibles àlaNature; ils ont étéfascinés par labeautédes
cédraies et lagrandeur de leurs arbres que, selon laBible,Dieu aplantés lui-même. L’impression
qu’ils faisaient sur eux n’est doncpas non plus étrangèreàces sentiments de gêne qui transpa-
raissent même dans les plus arrogants de leurs récits.Mais il y aplus :dans l’imaginaire,ces lieux
sont une sortedeparadis:l’univers rêvédes hommes du Proche-Orient est celuid’ungrand jardin ;
c’est l’Éden biblique,quelepéché interdit désormais.La forêt de Cèdres était,pour eux, unmonde,
àbeaucoupd’égards,inversedeceluiqu’ils connaissaient dans les civilisations urbaines,et qu’ils
n’appréciaient guèreplus quenous :là, c’était,enfin !,le silenceet le calme. Mais c’était,en même
temps, unmonde sans repères familiers,presqueinhumain ; les montagnes où poussaient les arbres
formaient uncontraste totalavecleur environnement quotidien de vastes plaines alluviales;elles
apparaissaient pleines de dangers imprévus.
L’épopée de Gilgameshfut l’œuvrelittéraire,en assyro-babylonien,laplus célèbredu Proche-Orient,
pendant trois millénaires.Iln’est doncpas étonnant qu’elle ait situé ses scènes les plus fortes dans
la“montagne des Cèdres”. Elle y faisait vivre ungardien semi-divin, uncertain Humbaba.La per-
sonnalitédecelui-ci témoignait du même double caractèrequeles arbres sous le couvert desquels
il s’abritait.Ilavait certes l’aspect extérieur d’unmonstre,il vivait d’une vie de sauvage, sans
maison,dans la solitude. Mais son cœur était celuid’unpur et d’unjuste,il soignait sacédraie, sous
le regardde son protecteur,le dieu-Soleil,dieu de lajustice. S’il était doncétranger àl’humanité,
habitant la région laplus excentriquedu Proche-Orient,il en avait cependant les traits les plus esti-
mables.Aussi,quand le héros mésopotamien Gilgamesh vint couper ses arbres,par simple goût
d’accomplir une prouesse,Humbaba tentade le détourner de cetteimpiété. Ilfut tuémais lapuni-
tion divine frappale meurtrier,quiconnut alors une longue suited’échecs.La morale était sévère.
Ce thème mythiqueeut son répondant,bien des siècles après,dans l’histoiredes Maronites.Le
moine anachorèteMaron auquel ils ont, semble-t-il,empruntéleur nom,est le contretype chrétien
du mythologiqueHumbaba ; il vivait dans la véritédu Christ comme Humbaba dans lalumièredu
dieu-Soleil,aussiétranger aux hommes queluipar sa vie presquebestiale, sous une simple tente
de peaux brutes, soumiseà toutes les rigueurs du climat.Mais, selon son biographe,l’évêque
Théodoret,il aplanté un«jardin spirituel »,des «Cèdres humains»par saprédication. Àl’instar de
Humbaba, il cherchaàguérir des désirs excessifs et des dérèglements agressifs.Ilne serait,peut-
être,pas trop difficile,mais unpeu forcé,cependant,de retrouver dans lapiétémaronite unécho
de cette vigilancecrépusculairedeMaron et de l’échec temporel de ses premiers moines massa-
crés,mais aussi,de cetteattentedelaLumière,non plus celle du dieu-Soleil mais celle du Christ.
Au Xesiècle,les Maronites allèrent chercher unabridans lamontagne libanaise,dans lamontagne
des Cèdres;eux seuls pouvaient offrir aux persécutés un refuge. Cetteallianceàlafois mystique
et historiqueétait une sorted’affirmation de soi,faceaux autres.Onne s’étonneradoncpas quele
Libanindépendant ait mis le Cèdre,le “saint Cèdre”, sur son drapeau et que,depuis 1936,il décore
de l’Ordredu Cèdreceux qu’il juge dignes d’être récompensés;il n’y apas silongtemps qu’il offrait
des plants de l’arbrepour le diffuser dans le monde, symbole vivant du pays.
D.ARNAUD
162

Ces raisons sidiverses expliquent donccettepassion qui semanifestepour le Cèdre tout autour de
laMéditerranée,mais cettedévotion àl’arbreest d’autant plus fortedans sadurée plurimillénaire
qu’elle sefonde sur la religion laplus ancienne, sur le cultedes arbres,êtres vivants dont certains
peuvent direlefutur et qui tous sont àlafois symboles et garanties de la vitalité. Ces traditions
remontent sans douteàlaPréhistoire; ce sont làdes idées,ou plutôt des pratiques,immémoriales:
depuis toujours,on est venu,et l’on vient attacher àleurs branches des vêtements,des bijoux,des
objets de décoration,pour en obtenir l’abondanceet lafertilité. Ces croyances àlafois souterraines
et irrépressibles furent d’abord tenues àl’écart des cultes officiels païens;au mieux,ont-ils cherché
àles accueillir,comme ils ont pu,installant des autels àl’ombredes arbres antiques sacrés.Puis
le Christianisme et l’Islamont eu la sagessede s’en accommoder,fautedepouvoir les éradiquer et
c’est chez les Maronites qu’on peut voir l’aboutissement de cette religiosité,lorsque,chaqueannée,
une chapelle sous les Cèdres abritelamesse,au jour de laTransfiguration.
La FAO dans son Projet de développement méditerranéen (Rome,1959) souhaitait «conserver la
forêt naturelle où son rôle de protection est reconnu et porter ce rôle au maximum, tout en assurant
àlaforêt, sipossible, une productivitééconomique». Un tel investissement,coûteux,et pour les
générations futures,ne peut avoir pour but une sortede reconstitution «archéologique». Ilne réus-
siraque si,àl’intérêt matériel, s’ajoutel’intérêt moral. Des circonstances fâcheuses sont venues en
travers des efforts de laRépubliquelibanaise,mais l’avenir resteouvert.Àl’autreextrémitédela
Méditerranée,le Marocmontrequ’éleveurs et agriculteurs peuvent devenir sensibles àladivision
des ressources et collaborer àla sauvegarde et àla reconstitution des cédraies,par le reboisement
et par une sage utilisation quilaisselibrejeu àla régénération naturelle. Telle est la voie à suivre.
Partir d’une conciliation pour aboutir à une réconciliation,l’ambition d’un tel programme n’est pas
sigrande ni le but siinaccessible.
Les Méditerranéens d’aujourd’huine sauront-ils pas semettreàl’école de ceux d’hier?L’Antiquité
et le Moyen-Âge sont loin,mais n’en faudrait-il pas en retenir le meilleur de l’héritage ?Pendant
longtemps,les Cèdres ont étélamarqued’unpaysage,mais ils n’ont pas étéquecela.Ils ont
appartenu aussi, sil’on peut dire,au paysage intérieur des peuples quibordaient laMéditerranée.
Ils jouent encorece rôle, rôle moralqu’il serait léger de croiremoins important.Ils révélaient une
sortede solidaritéd’abordentrel’habitant et laNature,d’autant plus profonde qu’elle était moins
réfléchie. Elle manifestait encore une autre solidarité,non plus locale mais générale,entreles deux
extrémités de laMéditerranée ; celle-ciest d’autant plus précieusequ’elle fut le seullien entreelles
deux,àcertaines époques de l’histoire. Qu’il fût ténu et,plus que ténu,inconscient,il n’importe.
Abandonner les cédraies,c’est,pour les Méditerranéens,accepter d’êtreétrangers sur leur propre
sol.
Nature,histoire,loisirs et forêt
163
Rev.For.Fr.XLIX - 2-1997
D.ARNAUD
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
45, ruedes Écoles
F-75005PARIS
BIBLIOGRAPHIE
Article “Cèdre” (M.Gast). In:Encyclopédie berbère. —Aix-en-Provence:Edisud,1993.—Tome XII, pp. 1834-1836.
Article “erenu”. In:Chicago AssyrianDictionnary.—Chicago-Glückstadt:The University of Chicago,1958. —Tome E,
pp. 274-279.
MEIGGS (R.). —Trees and Timber in the Ancient World. —Oxford:Clarendon Press,1982.
1
/
5
100%