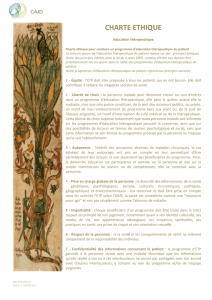L`éducation thérapeutique du patient

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 5 - mai 2012 | 251
DOSSIER THÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique
du patient
Therapeutic patient education
J. Rouprêt-Serzec*
* Pharmacien praticien hospitalier,
master 2 “Éducation thérapeutique” ;
service d’hématologie clinique pédia-
trique, CHU Robert-Debré, Paris.
Pourquoi ?
Adoptée le 21 juillet 2009, la loi HPST (hôpital,
patients, santé et territoires) réforme et modernise
le système de santé français. L’intégration de l’édu-
cation thérapeutique dans le parcours de soin des
patients atteints de maladie chronique est désormais
reconnue (article 84).
De quoi parle-t-on ?
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est diffé-
rente d’une information ou d’un conseil donné au
patient : elle propose un apprentissage qui s’adresse
au patient lui-même ou à un aidant, personne de
son entourage éduquée à sa place si nécessaire (par
exemple, si le patient est défi cient cognitif, s’il s’agit
d’un très jeune enfant, etc.). Cet apprentissage est
centré sur le patient et vise à lui prodiguer plus d’auto-
nomie au quotidien. L’objectif est l’acquisition de
connaissances (savoir) et de compétences (savoir-être
et savoir-faire) par le patient. Ce transfert de compé-
tences repose sur un partenariat : c’est un enseigne-
ment à double sens entre le savoir du “professionnel
de santé-éducateur” et le savoir profane du “patient-
apprenant”. L’ETP contribue à améliorer la qualité de
vie des patients, et ses bénéfi ces sont connus : elle
permet de limiter les risques de complication, de
rechute, d’hospitalisation. Ces bénéfi ces en termes
de santé publique, indiscutables, se doublent de
vraies économies de santé pour la collectivité.
Qui ?
L’ETP est un processus pluriprofessionnel et pluri-
disciplinaire qui nécessite de travailler en réseau et
en collaboration rapprochée avec tous les acteurs
de santé à l’hôpital et en ville impliqués dans la
prise en charge du patient (médecins, pharmaciens,
infi rmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, assistants
sociaux, etc.). Deux arrêtés et 2 décrets d’application
de la loi HPST sont parus le 2 août 2010, préci-
sant notamment les compétences requises en ETP.
En effet, cette diversifi cation de l’activité pour les
professionnels de santé suppose l’acquisition ou
le renforcement de compétences “relationnelles,
pédagogiques et d’animation, méthodologiques
et organisationnelles, biomédicales et de soins”.
Les professionnels de santé déjà en exercice
peuvent se former à l’ETP grâce à la formation
continue (formation courte, diplôme universitaire,
master, etc.). Les textes requièrent un minimum de
40 heures pour animer une consultation d’ETP au
sein d’un programme. Plus particulièrement, cette
formation − qui fait actuellement l’objet de quelques
ajustements − s’intègre également d’ores et déjà au
sein de la formation initiale des futurs médecins et
pharmaciens dans nos facultés.
Comment ?
C’est un processus qui s’organise dans le cadre d’un
programme d’ETP. Les recommandations de la Haute
Autorité de santé (HAS) en 2007 en ont précisé les
grandes lignes. Les 2 arrêtés et les 2 décrets d’appli-
cation de la loi HPST parus le 2 août 2010 décrivent
également le cahier des charges (prérequis) d’un
programme d’ETP.
Il s’agit du projet de toute une équipe pluriprofes-
sionnelle. Il est préférable qu’un ou plusieurs patients
souffrant de la pathologie en question participent
à la conception du programme d’ETP, afi n d’être
garants des orientations choisies. Ainsi, dès l’origine,

252 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 5 - mai 2012
Points forts
»
L’objectif est l’acquisition de connaissances (savoir) et de compétences (savoir-être et savoir-faire)
parle patient.
»Il est préférable qu’un ou plusieurs patient(s) souffrant de la pathologie en question participe(nt) à la
conception du programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP), afin d’être garant(s) des orientations
choisies.
»Le diagnostic éducatif est la première étape, essentielle, d’un programme d’ETP.
»Les programmes d’ETP font désormais l’objet d’une autorisation appelée “labellisation” par l’Agence
régionale de santé (ARS).
»
Le législateur a désormais défini le cadre de l’ETP, les professionnels de santé doivent maintenant se
former et choisir la forme la plus appropriée à leur exercice.
Mots-clés
Éducation
Thérapeutique
Patient
Compétences
Formation
Programme
Highlights
»
The objective is for the
patient to get the knowledge,
the skills and the behave.
»
It is better to include in the
development of a TPE program,
one or several patients
suffering from the pathology.
This is to ensure they are
aligned with the chosen direc-
tion of the program.
»
Educational diagnosis is
the fi rst crucial step of a TPE
program.
»
The TPE programs now
require to obtain authorisation
called “labellisation” from the
regional Health Agency.
»
Now that TPE is legally
defi ned, it is up to the health
care professional to get trained
and to choose how best to
apply it in his daily practice.
Keywords
Education
Therapeutic
Patient
Skills
Training
Program
les professionnels de santé adoptent une posture
d’écoute active.
Le programme d’éducation
thérapeutique du patient
Les différentes étapes d’un programme sont les
suivantes :
➤réalisation du diagnostic éducatif ;
➤élaboration d’un “contrat” d’ETP ;
➤planifi cation des consultations d’ETP ;
➤mise en œuvre du contrat ;
➤réalisation des consultations d’ETP ;
➤évaluation de l’ETP ;
➤
reprise éducative selon que les objectifs fi xés sont
atteints ou non et/ou réalisation de consultations
d’ETP répondant à de nouveaux objectifs pédago-
giques (reprise du diagnostic éducatif et ajustement
du contrat), et ainsi de suite.
Le diagnostic éducatif est la première étape, essen-
tielle, d’un programme d’ETP. Au cours de cette
séance, l’éducateur tente de répondre, avec l’aide
du patient, aux questions suivantes : “Qui est-il ?”,
“Qu’est-ce qu’il a ?”, “Que fait-il ?”, “Que croit-il ?”,
“Que sait-il ?”, “Quels sont ses projets ?” Il s’agit
“d’appréhender les différents aspects de la vie et de
la personnalité du patient, d’identifi er ses besoins,
d’évaluer ses potentialités, de prendre en compte ses
demandes et son projet dans le but de proposer un
programme d’éducation personnalisé” (1). Plusieurs
outils, tels qu’une carte conceptuelle (“photographie
mentale” du patient), peuvent être utilisés au cours
de cette séance.
À l’issue de ce diagnostic éducatif, les compétences
à acquérir par le patient doivent être identifi ées et
se déclinent en objectifs pédagogiques à acquérir
lors du programme (par exemple, “faire connaître
ses besoins, repérer/analyser et gérer une situation à
risque, savoir résoudre un problème de thérapeutique
quotidienne, savoir gérer les effets indésirables de
son traitement, savoir réajuster sa thérapeutique à
un nouveau contexte de vie, etc.” [1]).
Le contrat d’éducation est établi par le professionnel
de santé et le patient, qui déterminent ensemble les
priorités au sein des différents objectifs identifi és lors
du diagnostic éducatif. Le contrat d’éducation théra-
peutique formalise le partenariat entre le patient-
apprenant et l’éducateur-professionnel de santé.
Il est ensuite possible de planifier les premières
séances d’ETP suivant les premiers objectifs péda-
gogiques défi nis.
La consultation d’ETP, dont la durée doit être déter-
minée (souvent 45 mn ou moins), est animée par
1 ou 2 professionnels de santé formés à l’ETP, dont
les compétences-métier sont requises suivant les
objectifs pédagogiques à atteindre à l’issue de la
consultation d’ETP (pas plus de 1 ou 2 objectifs par
consultation d’ETP).
L’évaluation porte sur l’éducation du patient : la
fi nalité de l’ETP est l’apprentissage par le patient.
L’évaluation de cet apprentissage se fait à partir de la
“ligne de base” du patient, sa propre norme défi nie
au cours de son diagnostic éducatif.
L’autoévaluation peut tenir une place importante
dans ce procédé. Elle peut porter sur les outils du
programme, sur l’équipe éducative (techniques
pédagogiques, animation des consultations, etc.).
Les programmes d’ETP font désormais l’objet d’une
autorisation appelée “labellisation” par l’agence
régionale de santé (ARS). Elle est obtenue pour une
période de 4 ans après laquelle le programme sera
à nouveau évalué. L’HAS a produit, en juillet 2010,
une grille d’aide à l’évaluation de la demande d’auto-
risation par l’ARS, document de référence permet-
tant actuellement aux équipes de préparer cette
échéance. Il faut savoir que la labellisation permet
de pratiquer l’ETP mais ne garantit pas l’attribu-
tion d’un fi nancement (actuellement sous forme
de missions d’intérêt général et d’aide à la contrac-
tualisation [MIGAC] par les tutelles). Cependant,
il demeure pertinent de penser à réunir autant que
faire se peut les éléments refl étant l’activité dudit
programme d’ETP.
Transversalité de l’éducation
thérapeutique du patient
Afin de mutualiser les moyens et de galvaniser
les forces en présence, la coordination de l’ETP au
sein d’un même établissement est souhaitable.
Elle s’organise le plus souvent en une cellule de

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 5 - mai 2012 | 253
DOSSIER THÉMATIQUE
coordination parfois appelée “unité transversale
d’éducation thérapeutique des patients” (UTEP).
Ses missions peuvent être multiples : coordination,
formation, accompagnement méthodologique,
éducation du patient, etc.
L’éducation thérapeutique
du patient en ville
Regroupant naturellement des professions diverses,
l’hôpital est − et a longtemps été − le lieu privi-
légié de l’ETP. Cette dernière a cependant vocation,
aujourd’hui, à débuter et/ou se poursuivre plus
encore en ambulatoire. L’ETP en ville s’organise
le plus souvent au sein des réseaux de santé qui
rassemblent les différents professionnels autour
d’un même secteur géographique, d’une même
pathologie, etc. Elle peut également être dispensée
au sein de maisons de santé ou d’autres struc-
tures, telles que défi nies dans la loi n
o
2011-940
dite “loi Fourcade”, du 10 août 2011 : les sociétés
interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).
Ces dernières permettent “la mise en commun de
moyens pour faciliter l’exercice de l’activité profes-
sionnelle de chacun de ses associés et l’exercice en
commun d’activités de coordination thérapeutique,
d’éducation thérapeutique ou de coopération entre
les professionnels de santé”.
Le législateur a désormais défi ni le cadre de l’ETP,
reste au professionnel de santé à se former et à
choisir la forme la plus appropriée à son exercice.
Conclusion
L’ETP va au-delà des segmentations habituelles
entre professionnels de santé autour d’un même
patient. Elle crée, ou recrée, du lien. L’ETP est
surtout un processus sur mesure, ajusté à chaque
patient, évidemment unique dans sa vie avec la
maladie. ■
Spécifi cité du sujet âgé
A. Certain*, E. Orru-Bravo**
Du fait de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées sur les plans physique,
neuromoteur, affectif et psychique,
ainsi que de l’accumulation de leurs vulné-
rabilités physiopathologiques, accentuées
par les risques iatro gènes liés aux polymédi-
cations, envisager un programme d’éducation
thérapeutique du patient (ETP) en gériatrie
peut surprendre.
Et pourtant ! L’éducation du patient âgé, parce
qu’elle lui redonne confi ance et le responsabilise
à la juste mesure de ses capacités, est propre-
ment thérapeutique.
Grâce, d’une part, à l’établissement d’un mail-
lage souple et évolutif d’aidants faisant partie
de l’entourage du patient ou de professionnels,
adapté aux besoins de la personne âgée (domi-
cile ou institution, troubles cognitifs, etc.), et,
d’autre part, à l’acquisition de “compétences
de sécurité” (par exemple, la connaissance
de 3 signes d’alerte et la capacité d’appeler à
l’aide les personnes appropriées), l’éducation
thérapeutique est doublement bénéfique :
elle renforce la participation de la personne
âgée à ses soins, et constitue un défi pour les
soignants éducateurs, qui doivent adapter
constamment la pédagogie et les outils, dans
ce contexte particulier, afin de délivrer des
messages simples et opérationnels à reprendre
dans un environnement bienveillant, stimulant
et cohérent.
Les personnes âgées n’ont pas dit leur dernier
mot ; leur expérience et leur bon sens doivent
être sollicités dans la construction des
programmes d’éducation thérapeutique du
patient en gériatrie. ■
* CHU Bichat-Claude-Bernard, Paris.
** CHU Robert-Debré, Paris.
Abonnez-
vous
en ligne !
Bulletin
d’abonnement
disponible
page 279
www.edimark.fr

254 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 5 - mai 2012
DOSSIER THÉMATIQUE
Éducation thérapeutique
1. D’Ivernois JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient,
4e éd. Maloine, 2011.
2. Haute Autorité de santé. Recommandations ETP 2007.
http://www.has-sante.fr
3. Brunie V, Rouprêt-Serzec J, Rieutord A. Le rôle du phar-
macien dans l’ETP. JPC 2010;29(2):90-2.
4. Rouprêt-Serzec J, Sitbon O, Lott MC. Conception et mise
en place d’un programme d’ETP pour les patients souffrant
d’HTAP : le projet de toute une équipe. JPC 2010;29(2):103-7.
5. Rouprêt-Serzec J, Feldman D, Liou A, Paillet C, Allenet B.
Pratiquer l’ETP après la loi HPST : comment passer en
pratique d’une action non coordonnée à une offre de soin
structurée et une reconnaissance de compétences. Le phar-
macien hospitalier et clinicien 2011;46(2):110-5.
6. Bevans M, Castro K, Prince P et al. An individualized dyadic
problem-solving education intervention for patients and
family caregivers during allogeneic hematopoietic stem
cell transplantation: a feasibility study. Cancer Nurs 2010;
33(2):E24-32.
7. Liekweg A, Westfeld M, Jaehde U. From oncology phar-
macy to pharmaceutical care: new contributions to multidis-
ciplinary cancer care. Support Care Cancer 2004;12(2):73-9.
8. Tuffaha HW, Abdelhadi O, Omar SA. Clinical pharmacy
services in the outpatient pediatric oncology clinics at
a comprehensive cancer center. Int J Clin Pharm 2012;
34(1):27-31.
9. Pérol D, Toutenu P, Lefranc A et al. [Therapeutic education
in oncology: involving patient in the management of cancer].
Bull Cancer 2007 Mar;94(3):267-74.
10. Rizzo M, Migneco A, Mansueto P et al. Therapeutic patient
education in oncology: pedagogical notions for women’s
health and prevention. Eur J Cancer Care 2007;16(1):9-11.
11. Baillet AS, Gagnayre R, de Andrade V, d’Ivernois JF,
Poirot Mazères I. Éducation thérapeutique et responsa-
bilité juridique des équipes soignantes dans le cadre de la
loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de juillet 2009, Du
devoir du médecin au droit du patient. Educ Ther Patient/
Ther Patient Educ 2011;3(2):S207.
12. D’Ivernois JF, Gagnayre R, Rodary E, Brun N. Éducation
des familles à “Porter Soins et Secours” : un nouveau concept
dans le champ de l’éducation santé. Educ Ther Patient/Ther
Patient Educ 2010;2(1):1-6.
13. Arfé E, Bombail M, Roché H, Gagnayre R. Quelles compé-
tences peuvent être mobilisées par des patientes atteintes
de cancer du sein durant leur parcours de soin ? Une enquête
par entretiens auprès de patientes et de professionnels d’un
centre de lutte contre le cancer. Educ Ther Patient/Ther
Patient Educ 2012;4(1):11-22.
14. Régnier-Denois V, Rousset-Guarato V, Nourissat A,
Bourmaud A, Chauvin F. Contribution of a preliminary socio-
anthropological survey to the development of a therapeutic
patient education programme for patients receiving oral
chemotherapy. Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2010;
2(2):S101-7.
15. Parkinson DR, Ziegler J. Educating for personalized
medicine: a perspective from oncology. Clin Pharmacol
Ther 2009;86(1):23-5.
Pour en savoir plus (suite de la p. 254)
L’éducation thérapeutique dupatient
1
/
4
100%