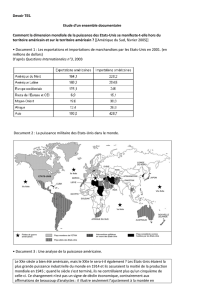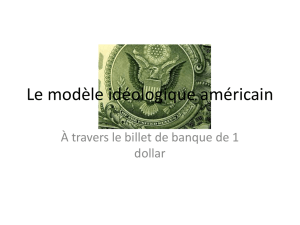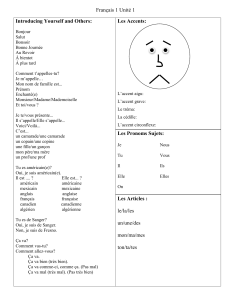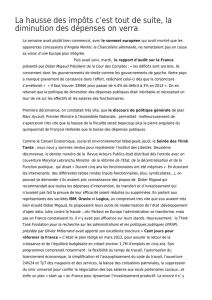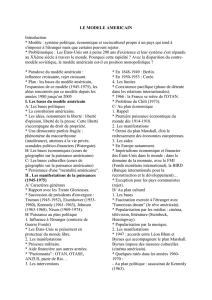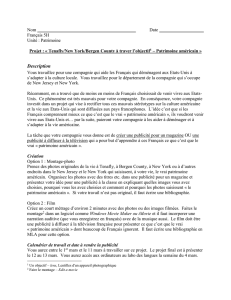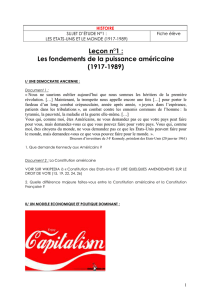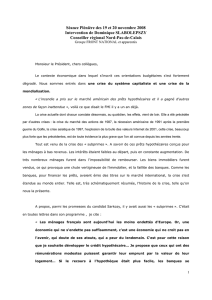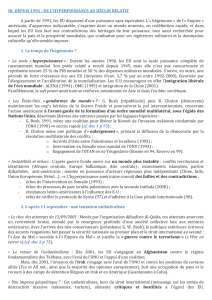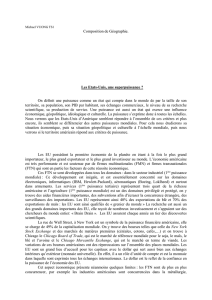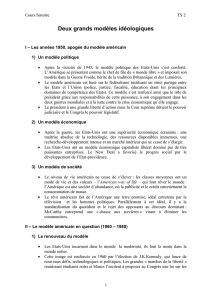introduction La crise du modèle social américain

11
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Il est souvent question du «modèle socialfrançais», voire d’un «modèle
social européen», mais bien plus rarement du «modèle social américain». Si
l’expression peut surprendre, elle n’en est pas moins légitime. Un modèlesocial
peut se défi nir en effet par un ensemble de valeurs et d’institutions clés sous-
tendant un certain type d’organisation de l’économie et de la société et les objec-
tifs qu’un pays se fi xe sur le long terme dans ce domaine. De ce point de vue, il
existe bel et bien un «modèle social américain». Fondé sur des valeurs libérales
et un principe de laisser faire, il place en son centre l’individu, doté de droits
mais responsable de ses actions et de son propre destin. Il confère également
à l’entreprise privée et au marché un rôle de premier plan dans les régulations
économiques et sociales, accompagné par des politiques macroéconomiques
actives. Il repose enfi n sur l’idée que tout individu a ses chances et peut bénéfi -
cier de l’ascenseur social au cours de sa vie professionnelle.
Cette logique, sans avoir été remise en cause dans ses principes fondateurs,
a été infl échie à l’occasion de cette parenthèse historique exceptionnelle qu’a
été le New Deal. La brutalité de la crise économique de 1929 et sa durée ont
légitimé, pour la première fois dans l’histoire américaine, une forte intervention
de l’État. Cette crise a aussi permis l’émergence d’un puissant mouvement de
syndicalisme d’industrie. Elle a débouché sur la mise en place d’institutions
régulatrices de la relation d’emploi, destinées à fournir une protection collective
et mutualisée contre l’insécurité économique en complément de celles apportées
jusqu’alors par les grandes entreprises à leurs salariés dans le premier quart
du XXesiècle. Jusqu’aux années 1970, le modèle social américain a donc su
montrer une certaine effi cacité et apporté un réel progrès économique, favorisant
l’ascension sociale d’une partie au moins de la population américaine (principa-
lement, l’ouvrier blanc syndiqué de la grande entreprise). Sans vouloir idéaliser
ce modèle qui n’avait éliminé ni les discriminations raciales, ni la pauvreté (y
compris laborieuse) et qui laissait une partie de la population américaine à la
périphérie du contrat social de l’après-guerre, il a néanmoins permis l’émergence
d’une «société de classes moyennes», dans un contexte macroéconomique
[« La crise du modèle social américain », Catherine Sauviat et Laurence Lizé]
[Presses universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr]

LA CRISE DU MODÈLE SOCIAL AMÉRICAIN
12
caractérisé par une croissance soutenue, une faible ouverture de l’économie et
des grandes entreprises manufacturières encore compétitives.
Son démantèlement et son affaissement ont commencé dans les années
1980, l’arrivée de R.Reagan au pouvoir marquant le moment de la rupture.
Ce tournant a été de nature économique autant que politique et idéologique.
Au plan économique, il a coïncidé avec la montée en puissance des groupes
industriels japonais et leur pénétration sur le marché nord-américain. Il s’est
illustré par le développement privilégié d’une politique de l’offre fondée sur la
déréglementation d’un certain nombre de secteurs et des réductions d’impôt aux
entreprises et aux ménages les plus riches, dans un contexte d’accélération de la
mondialisation économique et fi nancière et de ralentissement de la croissance.
Au plan politique et idéologique, il s’est traduit par la victoire du néolibéralisme,
comme projet de régulation des comportements humains commandé par les
valeurs de marché. Celles-ci sont parvenues progressivement à s’imposer dans
la défi nition des objectifs désormais assignés aux politiques publiques, contre le
souci du bien commun et de l’intérêt général. Ces politiques ont été de plus en
plus soumises à une logique d’effi cacité et de profi t, entraînant ainsi une vaste
redistribution des risques et des responsabilités de l’État aux individus.
La crise fi nancière déclenchée en 2007 et la récession d’une ampleur sans
précédent depuis la grande crise de 1929 qu’elle a provoquée, ont mis à nouveau
en évidence les profondes lacunes du modèle social américain. Plus de 8millions
d’emplois ont été perdus entre décembre2007, date d’entrée offi cielle des États-
Unis dans la récession, et décembre2009, provoquant un doublement du taux
de chômage de 4,9% à 10% en l’espace de deux ans. Beaucoup de chômeurs
qui ne sont pas ou plus indemnisés, et qui ont perdu leur assurance maladie en
même temps que leur emploi, se tournent maintenant de plus en plus nombreux
vers l’aide sociale, dont les critères d’accès ont été rendus plus diffi ciles par la
réforme de 1996. Cet affl ux de nouvelles demandes, provoqué par la récession,
va constituer le premier véritable test de cette réforme et de la capacité des
États à répondre à la situation d’urgence sociale, alors qu’ils ont à faire face
à d’ énormes diffi cultés budgétaires à l’instar de l’État de Californie. Depuis le
début de l’année 2008, le nombre de bénéfi ciaires du programme d’aide alimen-
taire, aux conditions plus faciles d’accès, a augmenté fortement. Il a dépassé
le pic historique de 2005 consécutif à l’ouragan Katrina qui avait frappé tout
particulièrement les habitants de La Nouvelle-Orléans.
Les enseignements des récessions précédentes méritent d’être tirés au clair,
comme l’a souligné l’économiste P.Krugman dans un ouvrage récent 1 . Bien
après la date de la fi n offi cielle de la précédente récession en 2001, le marché
du travail a continué de se dégrader. L’emploi s’est en réalité détérioré pendant
1. Pourquoi les crises reviennent toujours, Paris, Seuil, coll. «Économie humaine», 2009,
p.201.
[« La crise du modèle social américain », Catherine Sauviat et Laurence Lizé]
[Presses universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION
13
deux ans et demi alors que la récession offi cielle n’avait duré que huit mois 2 .
Ce constat modifi e le regard porté sur la réactivité de l’économie américaine en
matière de chômage et d’emploi. Les enchaînements passés d’entrée et de sortie
de crise attestent d’une certaine fragilité des créations d’emploi, qui ont été en
partie dopées par des bulles spéculatives. Il permet surtout de relativiser les
performances exceptionnelles en matière de baisse du chômage réalisées entre
1993 et 2000, le taux de chômage étant même repassé en dessous de 4% en 2000
sans provoquer de tensions infl ationnistes. Selon Hughes et Seneca (2009), la
sortie de la récession actuelle pourrait donc également s’orienter vers une forme
de reprise «sans emploi».
La succession de faillites de grandes entreprises, celles qui ont commencé
avec Enron au début des années 2000 et celles plus récentes et encore plus haute-
ment symboliques de Chrysler et de General Motors dans l’industrie automobile
en 2009, met pleinement en lumière l’épuisement d’un système privé d’assurance
sociale, dont le coût n’est pas mutualisé et dont les risques ont été reportés sur
les salariés. Les entreprises ne peuvent être un fondement stable pour assurer
la sécurité sociale des travailleurs sur le long terme. Le système de protection
sociale de l’après Seconde Guerre mondiale, tel qu’il a été confi guré en partie
avec le soutien des syndicats, est devenu inadapté à une économie où de moins
en moins d’emplois sont offerts à vie. Le fait de lier l’assurance maladie et la
retraite complémentaire à l’emploi au sein d’une entreprise individuelle donnée
est devenu un non-sens économique aujourd’hui.
Un modèle social ne peut trouver sa seule justifi cation dans l’atteinte de
performances économiques, s’il laisse sur le bord du chemin des millions
de citoyens plongés dans la pauvreté, voire la pauvreté extrême. Un modèle
social est aussi un choix de société, héritage d’une façon de vivre ensemble et
d’une volonté de faire cohésion. Dans un article du New York Times de 2002,
P.Krugman, qui n’avait pas encore reçu le prix Nobel, évoquait déjà la dispa-
rition de la classe moyenne américaine, celle qui avait fait les beaux jours de
l’Amérique des années 1950 et 1960, au profi t de l’émergence d’un nouvel âge
d’or pour les riches. Le niveau atteint aujourd’hui par la concentration des
richesses n’est en effet pas sans rappeler l’Amérique des «barons voleurs», celle
d’avant les grandes réformes sociales du New Deal. La crise du marché des crédits
2. Les dates offi cielles de début et de fi n de récession sont fi xées par un comité indépendant
d’économistes associés au National Bureau of Economic Research (NBER). Ce comité prend
en compte l’évolution d’un indicateur composite qui comprend le PIB et le revenu natio-
nal, mais aussi le revenu des ménages (hors transferts publics), les ventes de l’industrie
manufacturière et des secteurs du commerce de gros et de détail, la production indus-
trielle et l’emploi. Lorsque tous ces indicateurs baissent de façon substantielle, l’économie
est déclarée en récession. Quand plusieurs d’entre eux remontent, la sortie de récession
est offi ciellement annoncée. Cette méthode d’appréciation explique pourquoi en 2001, la
production industrielle et le PIB pouvaient repartir à la hausse, grâce à la stimulation de
l’économie par la Banque centrale tandis que le marché du travail continuait de se détériorer.
Le même scénario paraît se reproduire avec la récession commencée en décembre2007.
[« La crise du modèle social américain », Catherine Sauviat et Laurence Lizé]
[Presses universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr]

LA CRISE DU MODÈLE SOCIAL AMÉRICAIN
14
hypothécaires est ensuite venue remettre en cause l’idéal social américain de
l’accession à la propriété pour tous. Elle a aussi contribué à renforcer encore plus
la précarité des ménages les plus pauvres, ceux qui s’étaient laissés tenter par les
subprimes. L’ancien président de la Banque centrale américaine, A.Greenspan,
pourtant peu suspect de sympathies avec les thèses libérales (au sens améri-
cain, c’est-à-dire progressistes), a pointé les dangers d’une telle situation et son
incompatibilité avec les fondements d’une société démocratique capitaliste. Son
successeur, B.Bernanke, a aussi mis en garde début 2007 contre les risques de
la montée des inégalités, qui sapent les valeurs fondamentales du modèle social
et du rêve américain.
Le principe de mobilité et de justice sociale cher à la société américaine
de classe moyenne est donc fortement ébranlé. C’est pourquoi la refondation
des principes au cœur du contrat social américain est l’une des tâches de la
nouvelle administration. B.Obama ne s’y est pas trompé. Il a fait de la réforme
de l’assurance santé l’une des priorités de son agenda politique. Il est aussi venu
rappeler avec force, lors d’un discours de campagne à Philadelphie début 2008,
que les inégalités raciales s’étaient à nouveau élargies, pointant là une autre faille
majeure du modèle social américain. La profondeur de la crise actuelle peut lui
fournir l’occasion de s’atteler à la mise en place d’un nouveau New Deal, car elle
redonne une légitimité à l’intervention publique dans les domaines économique
et social, même si celle-ci reste fortement contestée par de puissants lobbies.
Mais cette tâche exige des moyens fi nanciers importants. En raison de l’ampleur
de ceux attribués au sauvetage du système bancaire et au plan de relance écono-
mique, les marges de manœuvre budgétaires sont étroites. Seule une puissante
mobilisation sociale pourrait venir desserrer ces contraintes et modifi er l’ordre
des priorités. Son absence actuelle est l’une des différences majeures par rapport
à la situation des années 1930, de même que l’incapacité des syndicats à éviter
les suppressions d’emploi massives et les baisses de salaire imposées par les
employeurs dans la crise.
Dans une première partie, on analysera la façon dont les principales insti-
tutions du marché du travail, héritées du New Deal, ont été progressivement
affaiblies, voire vidées de leur fonction protectrice et régulatrice. La défense des
droits collectifs des travailleurs a reculé avec l’effritement du pouvoir syndical
et les diffi cultés qu’ont les syndicats, dans un contexte juridique de plus en
plus hostile et un espace économique concurrentiel de plus en plus exacerbé, à
défendre les intérêts des salariés et à promouvoir des solidarités plus larges que
celles de leurs adhérents. Le salaire minimum fédéral, en soixante-dix années
d’existence, a considérablement perdu de son effi cacité écono mique et sociale,
dont le but premier était d’apporter une sécurité économique aux travailleurs
à bas salaire et à leurs familles. Sa revalorisation dépendant du Congrès, il a
souvent été gelé pendant de longues périodes, affaiblissant sa fonction correctrice
des inégalités salariales. Mais surtout, il ne protège pas contre le sous-emploi,
[« La crise du modèle social américain », Catherine Sauviat et Laurence Lizé]
[Presses universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION
15
n’offrant qu’une garantie horaire (et non mensuelle) aux salariés concernés.
Enfi n, le système d’indemnisation du chômage a répondu à une logique d’ordre
contracyclique davantage qu’à la recherche d’une sécurisation du revenu. Conçu
sans avoir fait l’objet d’un compromis social, il n’a jamais été remis en cause par
les syndicats pas plus qu’il n’a connu de réforme majeure. Il apparaît pourtant
de plus en plus inadapté à un marché du travail où l’insécurité s’est considé-
rablement répandue, du fait des restructurations permanentes des entreprises,
processus que la crise économique a encore accéléré.
Cette insécurité se mesure mal à l’aune des indicateurs traditionnels du
marché du travail comme on le montrera dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Si le taux de chômage américain est resté faible sur longue période au regard de
nombre d’économies européennes, il masque en réalité un sous-emploi impor-
tant d’une partie de la population. Le dynamisme du marché du travail a été
une condition essentielle au fonctionnement du modèle social américain. Or
il s’est sérieusement affaibli depuis le début des années 2000. La tertiarisation
de l’économie a entraîné une dégradation dans la qualité des emplois, et a tiré
aussi les niveaux de salaire vers le bas. La dualisation du marché du travail a eu
comme conséquence d’enfermer certains salariés parmi les moins éduqués dans
des trappes à emplois peu qualifi és et à bas salaire.
La troisième partie est consacrée à l’analyse du délitement du mode de
protection sociale américain, caractérisé par le rôle primordial qu’y joue l’entre-
prise, et à l’examen de ses conséquences pour les travailleurs américains. Le
rôle assumé traditionnellement par l’«entreprise providence» a mal résisté à la
mondialisation économique et fi nancière et à la déréglementation de nombreux
secteurs. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause
les avantages sociaux promis à leurs salariés en matière de retraite et d’assurance
maladie, et à leur en transférer une partie des risques et des coûts. Ce système
est de moins en moins en phase avec un marché du travail caractérisé par la
fl exibilité, la mobilité et l’affaiblissement des marchés internes.
Enfi n, dans la dernière partie, on mettra l’accent sur le fossé qui s’est creusé
entre les riches et les pauvres, une partie de la classe moyenne américaine étant
tirée vers le bas. Cette évolution tient au fait que la grande masse des salariés a
dû subir une compression salariale, la progression de leurs salaires réels ayant
décroché par rapport à celle de la productivité. Ainsi a été encouragée par une
politique monétaire de faible taux d’intérêt la fuite en avant des ménages de la
classe moyenne et des pauvres dans un endettement croissant, comme moyen
privilégié de soutenir la croissance et de répondre aux besoins de consommation.
La hausse rapide du nombre de recours à la procédure de faillite personnelle
ces deux dernières décennies montre les risques et les conséquences engendrés
par une telle politique. Le processus ne s’est ralenti que suite à un durcissement
de la loi sur ce type de faillites, sous la pression des banques et des établisse-
ments fi nanciers qui refusent de supporter les pertes associées aux défauts de
[« La crise du modèle social américain », Catherine Sauviat et Laurence Lizé]
[Presses universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr]
 6
6
1
/
6
100%