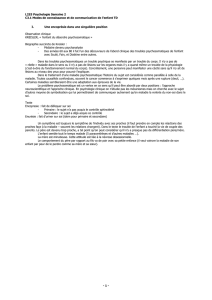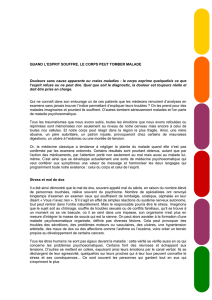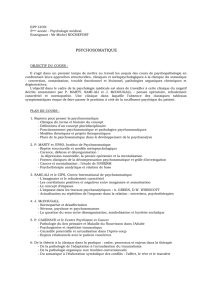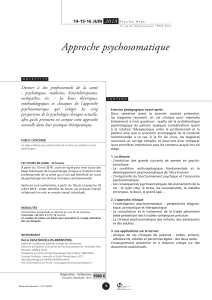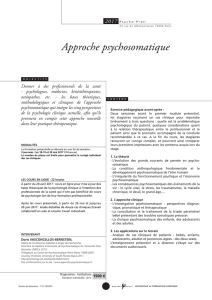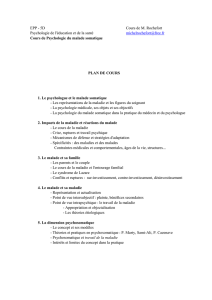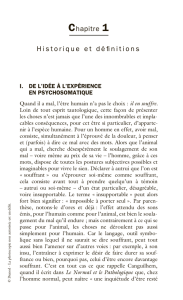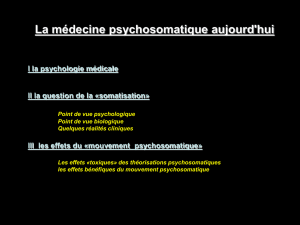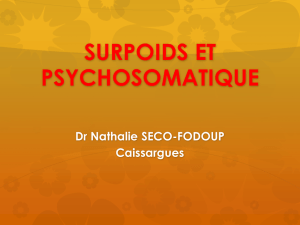Concepts récents et dynamique de la maladie psychosomatique

Concepts récents et dynamique de la maladie
psychosomatique. Applications en odontostomatologie
Recommander cet article
Christiane Mascrès : Docteur en chirurgie dentaire, DSO, PhD, professeur titulaire
Faculté de médecine dentaire, université de Montréal, département de stomatologie. CP 6128,
succursale Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3J7 Canada
23-449-A-10 (1995)
©1995 Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS - Tous droits réservés.
EMC est une marque de Elsevier SAS.
Plan
La médecine psychosomatique au coeur du paradigme de la médecine moderne
Maladie psychosomatique en stomatologie
Conclusion
Haut de page
La médecine psychosomatique au coeur du paradigme de la médecine
moderne
La maladie peut se définir comme une division de " soi avec soi " [82]. Selon les écoles de pensé
e, le
" soi " adopte une signification différente. Ainsi dès l'Antiquité, on discutait déjà de l'influence de l'â
me
sur le corps. Deux écoles de pensée de tradition médicale opposée se dressaient comme rivales.
L'é
cole de Cos, selon la tradition hippocratique, voulait que la maladie soit moins un processus
extrinsèque qu'un développement lié à la nature du malade [18], [42]. Elle était intimement lié
e au
tempérament de celui-
ci qui s'exprimait au niveau des " humeurs ", exsudats corporels et
manifestations psychiques [18]. Cette assertion a influencé aussi bien la pré
vention (on se souvient du
" mens sana in corpore sano " d'Hippocrate [20]), que le traitement de la maladie. L'é
cole de Cos
traitait l'homme dans sa totalité, souvent par des cures psychosomatiques dans des bâ
timents
d'incubation [18], [42]. Déjà avant Hippocrate, la médecine soignait donc l'âme pour obtenir la santé
du
corps.
L'école de Cnide était au contraire à tendance analytique et mécaniste, et l'organe malade était trait
é
isolément du contexte holistique des autres appareils physiologiques et de la personne [18], [42].
Le débat entre ces deux écoles de pensée est toujours d'actualité puisqu'il contient à
la fois le noyau
de la mé
decine classique et le germe des tendances nouvelles qui sont en train de progresser, donc
celui de la médecine à venir.
Descartes a fort bien décrit la relation entre l'âme et " les esprits animaux " [18], [42]
, l'interactionnisme
entre esprit et corps, tout en avançant le premier une théorie cérébrale des émotions [18]. Si " psych
é
" et " soma " sont complémentaires en état de santé, ils le sont aussi en é
tat de maladie, et forment
l'unité inséparable nommée " la vie " [20]. Cette notion d'unité symbolique était déjà solidement ancré
e
en médecine à ses débuts, lorsque celle-ci appartenait à une ère magique animiste, le Cé
sar
guérissant la maladie " pseudosomatique " d'un attouchement de son gros orteil [18], [20].
Accepter l'efficacité de ce traitement magique implique qu'on reconnaisse une étiologie psychique
à
la maladie et, après Descartes, la reconnaissance de l'effet de l'émotion.
On connaît en effet, depuis Eschyle, l'effet physique de la passion, de la tristesse, de la colè
re, etc.
[21]
. Ces
é
motions adoptent le langage du corps qui r
é
agit en somatisant, ou pr
é
sente des
Page
1
sur
16
EMC Consulte
07/08/2004
file://C:\DOCUME~1\kamel\Bureau\CONCEP~1.APP\20427.htm

[21]
. Ces
é
motions adoptent le langage du corps qui r
é
agit en somatisant, ou pr
é
sente des
symptômes plus graves souvent chroniques, dans le cas de maladies psychosomatiques [74]
. Un
malade ne souffre pas cependant en tant que " collection de symptô
mes ", mais comme un individu,
le corps étant un " lieu de passage entre un envers et un endroit " [56]. La maladie conç
ue par le
patient, moins somatopsychique que psychosomatique (c'est le terme innové
par Heinroth, interniste
et psychiatre, en 1818) [74], implique donc un passage du classique paradigme " biomédical ", à
un
paradigme " bio-psycho-socio-médical " plus ouvert.
Paradigme biomédical
Encore actuellement, l'acte médical est un acte vétérinaire qui devrait d'abord ê
tre scientifique.
Encore actuellement, la médecine psychosomatique est considérée par les mé
decins organistiques
comme une hérésie [20]. Les dossiers mé
dicaux ne contiennent pas le type d'informations
nécessaires aux études psychosomatiques [25]. Les médecins sont d'ailleurs encouragé
s par leur
formation à commettre des erreurs de type 1 (créer une non-maladie), plutô
t qu'une erreur de type 2
(passer à côté d'une vraie maladie) [105].
Le paradigme étant d'abord un " lieu de choix " [100], selon le paradigme biomédical, la mé
decine se
consacre à la sémiotique et à la thérapeutique, c'est-à-dire à la classification et au dé
chiffrage des
symptômes. Le médecin, savant dans son laboratoire, écoute le corps et en dé
chiffre le langage.
Constater lui importe plus qu'alléger, puisqu'il réduit l'être humain à un objet d'étude [54], [55], [79]
. La
médecine divisionniste, pointilliste, pratiqué
e depuis Virchow, se concentre d'abord sur la pathologie
d'organes. On en vient ensuite à la spécialisation à l'intérieur d'un mê
me appareil physiologique, puis
à une sur-spécialisation à l'intérieur d'une même discipline [48]. Le spé
cialiste devenu sans culture
générale tape sur le même clou en ignorant la forêt. Le choix des traitements standard est suscité
par
les résultats des examens de laboratoire. Le " bon mé
decin ", de plus en plus rare, pose son
diagnostic après anamnèse, palpation et déduction logique. L'autre ne s'é
carte pas des normes
biologiques et s'en tient souvent à la prescription de médicaments.
Le refuge préféré du médecin est souvent effectivement le côté technique de sa profession, où
la
dimension magique est répudiée au profit d'une idéologie scientiste limitée. Trop souvent l'idé
al
médical est simpliste, et la relation médicale un passage à l'acte déguisé. Avoir une maladie é
quivaut
à détecter le parasite, le traiter et en guérir [56], [82].
L'époque où la maladie pouvait être considéré
e comme un accident purement technique, donc partie
intégrante du paradigme biomédical, semble cependant révolue. Le patient - et parfois son médecin -
est confronté avec un besoin d'autre chose. La médecine retourne à la pathologie holistique, où
les
niveaux différents de l'homme global aspirent à
des traitements multiples. Cet abandon du paradigme
biomédical que nous vivons actuellement n'est possible que par un retour inconditionnel
à
l'enseignement d'Hippocrate, où il n'existait de maladie que psychosomatique.
La compré
hension de cette philosophie de la maladie implique le glissement d'un paradigme devenu
étriqué à une conception plus généreuse et plus humaine de l'ê
tre malade. La maladie somatique
appelle certes une aide technique, mais l'attente de la personne va au-delà de cette demande.
Maladie psychosomatique
L'homme étant sujet et objet, tout phénomène chez lui est psychosomatique [18].
Ainsi toute maladie incluant la phase terminale, la mort [70]
, si elle n'est pas somatopsychique, est
psychosomatique. Ce truisme n'est concevable qu'aprè
s effraction du cadre des sept maladies
psychosomatiques classiques inventoriées par Alexander [2].
Les maladies psychosomatiques se définissent comme polyétiologiques avec un rôle prépondé
rant
accordé
aux facteurs psychologiques. La focalisation sur un organe ou un appareil physiologique
particulier se fait par anachorèse à partir d'une prédisposition biologique ou héré
ditaire (le facteur X
d'Alexander [2]), impliquant donc le terrain de l'individu [42]. La médecine psychosomatique o
ù
s'inscrivent ces maladies est, davantage que la science exacte " biomédicale " qu'elle voudrait ê
tre,
une science humaine qui nous oriente vers la médecine de la personne dans sa globalité,
et qui
s'inscrit sous l'égide psychanalytique et pavlovienne.
Pour fuir une tension, une émotion incontrôlable, une situation psychologique intolé
rable, le malade
se réfugie dans la maladie physique. Le corps devient alors un alibi [56]
. Le trouble fonctionnel qui est
la plainte principale du malade est signalé à répétition sans qu'on puisse observer de lésions
à
proprement parler [29]. Devant ce tableau clinique qui lui échappe, le médecin peut se sentir dépassé
.
Le sympt
ô
me signal
é
se r
é
p
è
te et sa r
é
cidive conduit
à
la chronicit
é
,
ce qui provoque un rejet du
Page
2
sur
16
EMC Consulte
07/08/2004
file://C:\DOCUME~1\kamel\Bureau\CONCEP~1.APP\20427.htm

Le sympt
ô
me signal
é
se r
é
p
è
te et sa r
é
cidive conduit
à
la chronicit
é
,
ce qui provoque un rejet du
praticien, et, le symptôme étant perçu comme le signe d'autre chose, une propension chez celui-ci
à
envoyer le malade à un " expert des signes ", spécialiste de la santé mentale [5].
Si le malade psychosomatique parle avec ses viscères à
un niveau de communication qui emploie
d'abord les organes internes [33], ce langage est la traduction désadaptée de ses é
motions. La
maladie psychosomatique devient alors une maladie organique (avec troubles fonctionnels), mais
modifiée par les traits de personnalité, l'armure du caractère, ou la né
vrose du patient. Le malade est
psychosomatique, et non sa maladie [48].
Un certain nombre de charnières ont permis à la mé
decine moderne un glissement hors du
paradigme biomédical dont la philosophie et la pratique systématique deviennent désuè
tes et
inadaptées à la réalité de la vie actuelle.
L'une se concentre sur l'effet physiologique des émotions. Elle inclut l'effet du stress, lui-mê
me
générateur d'émotions. La seconde s'appuie sur le rô
le de l'inconscient dans la maladie. C'est dans
l'inconscient et à partir du développement psychique de la personnalité
qu'on retrouve les racines de
l'émotion. La dernière, enfin, est concentrée sur l'apprentissage et le conditionnement corticoviscé
ral
selon les lois pavloviennes qui ont servi de base au mouvement comportemental, ainsi que sur le
conditionnement des émotions.
Physiologie de l'émotion
Reprenant les donné
es de Claude Bernard sur la constance du milieu interne et l'influence
physicochimique du corps sur l'équilibre mental, le physiologiste Cannon a étudié
l'effet fonctionnel
des émotions comme l'angoisse ou la dépression sur l'homéostasie, par l'intermédiaire du systè
me
nerveux autonome (ou végétatif). Par exemple, les symptô
mes somatiques sympathicotoniques
accompagnant l'angoisse, ainsi que les symptômes sympathicomimé
tiques qui accompagnent la
dépression, font partie de la réaction d'alarme de Cannon [42], [82].
A partir de cette découverte capitale, l'étiologie neurovégé
tative des maladies psychosomatiques a
pu être analysée : une modification de l'équilibre physiologique, là où
Freud situait l'inconscient,
génère le trouble fonctionnel, signe de la maladie psychosomatique ou psychophysiologique.
Stress et émotion
Le stress, en déclenchant des émotions, perturbe la physiologie de l'individu. Toute é
motion mal
assumée provient d'un stress lui aussi mal assumé. La notion de stress générateur d'émotions a ét
é
formulée par Selye à partir de ses expériences sur des rats de laboratoire. Chez ces animaux,
à
l'aide de contraintes physiques ou " sociales ", il a provoqué des ré
actions de l'axe
hypophysosurrénalien, la réaction d'alarme initiale entraî
nant une phase d'adaptation, puis, si la
cause persiste, une phase de décompensation conduisant à l'épuisement [99].
Le stress pluriétiologique, composé de celui qu'infligent l'environnement, la société,
le travail, la
famille, etc., induit chez l'humain des ré
actions comparables. Des individus cotant haut, par exemple,
sur l'échelle de Holmes et Rahe, ont de fortes chances d'être malades dans les 6 mois à venir [108]
.
Les stimuli dans leur ensemble, et surtout les facteurs psychosociaux, ont une influence sur la
résistance immunologique qui détermine ou non la maladie. Des facteurs sociaux pouvant ê
tre
considérés comme négligeables chez une personne qui ré
agit " normalement " deviennent ainsi des
causes possibles de maladie.
De plus, le filtre du système limbique fait percevoir le stress, les difficultés existentielles, d'une faç
on
non stéréotypée et variable selon l'individu. Le bon fonctionnement ou le dérè
glement d'un organisme
sont ainsi liés à la façon dont l'individu se comporte face à
la vie, selon qu'il l'empoigne ou la subit
[102]. La personne, selon son tempérament ou l'orientation de son bagage cognitif, aura tendance
à
s'enfuir, à figer ou à combattre [76]. Ces trois options ont été décrites par Cannon, et L'é
loge de la
fuite a été érigée en philosophie par Laborit [51].
La physiologie du cerveau par où passent les émotions et la faculté d'être malade et d'en gué
rir,
régule donc le système immunitaire. Un stress perçu comme nocif devient alors iatrogè
ne et diminue
le fonctionnement de celui-ci. La solitude, une légè
re perturbation du mode de vie sont, par exemple,
associées à une baisse de l'activité des lymphocytes tueurs [76]. Le sujet se ressent alors vulné
rable
et susceptible à la maladie [19], [21], [42], [76], [79], [120].
Page
3
sur
16
EMC Consulte
07/08/2004
file://C:\DOCUME~1\kamel\Bureau\CONCEP~1.APP\20427.htm

Les émotions vont ainsi entraîner des modifications biochimiques par l'intermé
diaire d'une
perturbation des centres diencéphalo-hypophysaires régulateurs des mé
tabolismes. La maladie
psychosomatique peut alors s'installer, grâce à la libération é
motionnelle des automatismes par
rapport aux centres coordinateurs [18].
Racines de l'émotion
Les perturbations des noeuds d'émotions décrits par Bower [79], les é
motions trop fortes,
contagieuses, é
touffantes, leur amplification ou leur distorsion, peuvent se transformer en
traumatismes physiologiques.
Ce serait une erreur cependant de limiter l'émotion à un comportement dû à une sécré
tion du
système limbique ou des glandes surrénales. En effet, l'expression de l'émotion fait partie inté
grante
du caractère de l'individu, de son éventuelle né
vrose. Elle appartient ainsi, selon nous,
intrinsèquement au domaine psychanalytique.
Le cercle se boucle avec Freud qui, le premier, a ouvert une " voie royale " en soupç
onnant une
origine psychologique inconsciente aux perturbations organiques de l'hystérie de conversion, où
le
symptôme physique résoudrait un conflit intérieur, un refoulement, une névrose.
Freud a tenté
de poser, en effet, " la pulsion de mort " comme fil d'Ariane entre le psychisme et le
corporel, entre " soma " et " psyché " [8], la décrivant comme un signal d'alarme à l'inté
rieur du moi,
ou une réédition d'une névrose infantile dont on peut retracer la genèse en reconstituant les é
tapes
de la croissance de l'enfant dans sa relation avec sa mère.
Mais c'est essentiellement la personnalité du sujet, la structure profonde de son moi, qui dé
terminent
sa réactivité face au stimulus. La maladie qualifiée de " rupture existentielle " [82]
mobilise le
préconscient et l'inconscient. On a constaté en effet que des symptômes somatiques activé
s par les
événements de la vie du sujet émergent au début d'une psychanalyse [101].
Le symptôme pathologique qui permet ainsi à
l'inconscient d'utiliser le soma pour expliquer son
désarroi intègre une valeur de symbole [20], [22]. Une personne avec une personnalité
sadique anale
souffrira peut-être un jour, par exemple, d'un cancer de l'intestin [5]. On est aussi souvent tenté
de
conclure que la personne refoule ses affects, et les somatise pour combler ses besoins libidinaux et
ceux de punition.
Lorsque l'émotion ne peut s'exprimer, l'action concomitante du systè
me nerveux autonome reste
bloquée. Malgré
ses essais infructueux, le sujet finalement ne peut plus s'adapter. Comme l'affirme
Delay citant Sacha Nacht [18], l'énergie pulsionnelle que les fonctions du moi ne peuvent inté
grer, finit
alors par les désorganiser. L'énergie non libéré
e se transforme en angoisse et le refoulement
chronique conduit à la maladie.
Ainsi par exemple, lorsqu'une agression compétitive est vécue dans un milieu de travail, elle génè
re
des névroses neurovégétatives, responsables de migraine, d'hypertension arté
rielle, ou d'arthrite
rhumatoïde. Selon Alexander, le couple anxiété/culpabilité conduisant à une dé
pendance infantile,
devient responsable d'asthme bronchique, de colite ulcéreuse ou d'ulcère gastroduodé
nal ; la
dépression, enfin, entraînerait dysménorrhée et troubles de la fonction sexuelle [2].
Cette idée d'associer une émotion particulière avec une maladie spécifique comme l'a tent
é
Alexander et, à un niveau encore plus pointu, Dunbar, est apparue en son temps ré
volutionnaire. Elle
est actuellement relativement dépassé
e. En effet, il est certainement plus logique et plus proche des
mécanismes physiologiques de lui préférer la loi de la massivité de Klotz [48]
, comme fondement
explicatif de la dynamique de la maladie. D'après cet auteur, les stimuli pathogè
nes affectent
l'organisme dans son ensemble, et c'est l'organe déjà atteint par une déficience héré
ditaire ou
acquise qui va être le siège de la maladie, selon la loi de moindre résistance.
Cependant, Alexander est considéré comme un pionnier, et sa mé
thodologie de l'interrogatoire du
malade qui psychosomatise est efficace. En effet, des analystes entraînés à
ses techniques, et
soumettant différents types de malades psychosomatiques à
des interrogatoires psychiatriques, ont
fourni des diagnostics mé
dicaux corrects trois fois plus souvent que par chance, et deux fois plus
souvent qu'un groupe d'internistes [108].
Enfin, la topographie exacte de l'inconscient demeure encore un mystère. Selon Lagache [52]
: "
L'inconscient est le physiologique. Il est donc tout ". Cette
é
vidence
à
premi
è
re vue simpliste, bien
Page
4
sur
16
EMC Consulte
07/08/2004
file://C:\DOCUME~1\kamel\Bureau\CONCEP~1.APP\20427.htm

L'inconscient est le physiologique. Il est donc tout ". Cette
é
vidence
à
premi
è
re vue simpliste, bien
qu'elle soit calquée sur l'hypothèse de Freud, implique qu'il faudrait maîtriser déjà
une bonne
connaissance des réactivités physiologiques (le biologique), et d'une faç
on prioritaire, pour traiter
efficacement par contrecoup les émotions et le volet psychologique de l'individu.
Maladie : apprentissage...
La disposition de l'individu à la lutte ou à la fuite dans la maladie ne s'établit pas d'une faç
on
aléatoire, mais par apprentissage.
En effet, cette dernière charnière qui inté
resse le mouvement comportemental (behavioriste) se situe
au niveau du conditionnement et de l'apprentissage corticoviscé
ral, ainsi que du conditionnement des
émotions.
Le cerveau agit ainsi sur les viscères par l'intermédiaire du système nerveux autonome. L'activité
de
celui-ci se perpétue par conditionnement. La reconnaissance des travaux de Pavlov sur les ré
flexes
conditionnés conduit à définir la maladie psychosomatique comme une pathologie corticoviscé
rale
d'apprentissage, et la base de la médecine psychosomatique [12], [18], [42].
L'é
motion, enfin, expression d'une modification physiologique et d'une dynamique interne, peut aussi
s'apprendre, souvent selon un mode vicariant.
C'est dè
s les premiers mois de la vie que s'installe la matrice des troubles psychosomatiques. Elle
consiste en une régression à un stade de diffé
renciation insuffisante entre le biologique et le
psychologique [42]. Cette intimité de structure par absence de diffé
renciation, donc de cloisonnement,
serait le résultat d'un conditionnement ou de l'installation de réflexes conditionnés à
l'irritation
sympathique et au stress émotif [12], avec des renforcements souvent de nature sociale [7], [17]
. Elle
pourrait correspondre au facteur X d'Alexander, ou plus largement, créer le " terrain ".
C'est dans cette optique qu'on doit considérer le conditionnement corticoviscé
ral et le
conditionnement émotionnel, au cours de la maladie.
Conditionnement corticoviscéral
A partir des expériences de Pavlov, puis de Hull chez l'animal [119], on a conclu que le systè
me
nerveux central contrôlait les organes de la vie végétative. Intégrée dans le cortex, la ré
gulation
cérébroviscérale subit l'influence dominante de mé
canismes de conditionnement qui constituent le
mode de fonctionnement de l'écorce céré
brale. Un conditionnement complexe sous forme d'une suite
en chaîne de réflexes conditionnés réalise un stéréotype dynamique conduisant à
des automatismes
physiologiques pathogènes [48].
Les désordres viscéraux fonctionnels sont donc appris par conditionnement opé
rant (travaux de
Miller de 1967 à 1971 [29], [68]), les réactions étant renforcées par des réussites fortuites.
Il existe donc une interaction d'apprentissage entre les facteurs biologiques et psychologiques [32]
.
Certains auteurs répliquent cependant que le processus d'apprentissage selon le modèle S-
R
(stimulus-réponse), ou S-O-R (stimulus-objet-réponse), est artificiel et strictement opposé
au
processus phénoménologique [61].
En fait, l'influence de l'environnement ne se résume pas par la formule S-
R. Elle s'articule aux
contraintes génétiques et historiques selon des modalités que seule l'analyse dé
veloppementale
permet de préciser [35]
. De ces contraintes, cependant, le behaviorisme ne tient aucun compte. En
effet, l'empreinte génétique, c'est-à-dire l'inéluctabilité déterminé
e par les chromosomes, ainsi que les
séquelles psychologiques cicatricielles que pré
sente l'individu (et qui constituent son histoire), ne sont
abordées et analysé
es que par le mouvement psychodynamique, et non par le mouvement
comportemental.
Conditionnement émotionnel
L'émotion est apprise à
travers le conditionnement classique pavlovien (par exemple : le petit Albert
conditionné par Watson à la peur des animaux à fourrure) [3].
Page
5
sur
16
EMC Consulte
07/08/2004
file://C:\DOCUME~1\kamel\Bureau\CONCEP~1.APP\20427.htm
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%