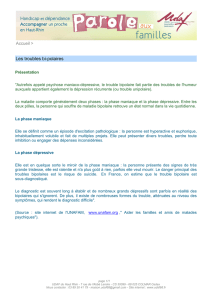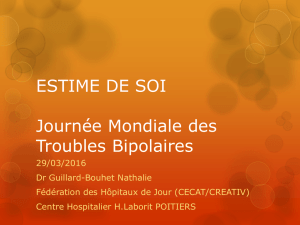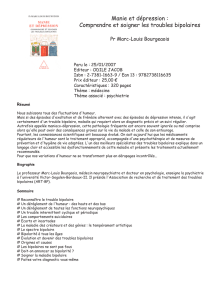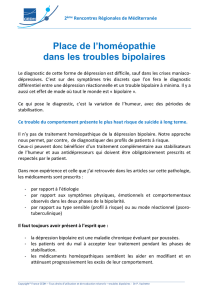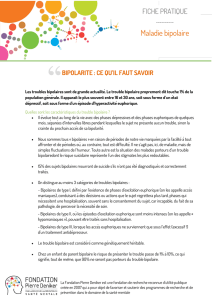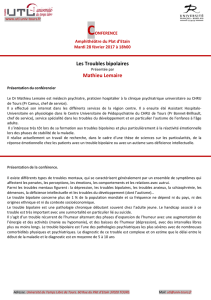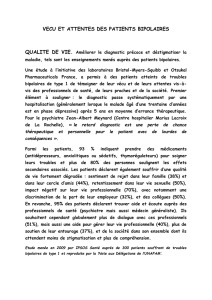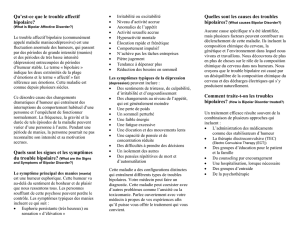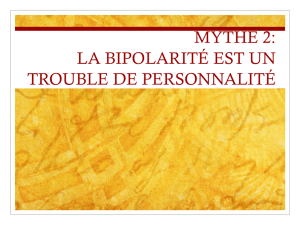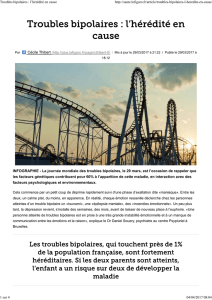Enquête sur le vécu des patients bipolaires

Enquête sur le vécu des patients bipolaires
P. Courtet*, S. Guillaume
INSERM U1061Département d’Urgence et Post Urgence Psychiatrique, Université Montpellier,
CHRU Montpellier, Hôpital Lapeyronie, 34295 Montpellier, France
L’Encéphale (2011) 37, 18-22
© L’Encéphale, Paris, 2011. Tous droits réservés.
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
Correspondance.
Adresse e-mail : p-courtet@chu-montpellier.fr (P. Courtet).
ces données montrent que l’échantillon n’était pas parfai-
tement représentatif de la population française des bipo-
laires, ou du moins des patients auxquels nous consacrons
l’essentiel de notre pratique quotidienne.
Le retentissement social
Tous les indices retenus pour évaluer l’impact social, le
« fardeau » de la maladie bipolaire, montre que cette
pathologie a un pronostic social très lourd. Ainsi, la majo-
rité des patients considère que le trouble bipolaire est une
maladie grave (87 %), qu’il gâche la vie de ceux qui en sont
atteints (92 %) ; en conséquence, le diagnostic leur fait
peur (88 %). Les patients considèrent que les troubles bipo-
laires retentissent de manière importante sur l’estime de
soi (72 %), sur le bonheur et l’évolution professionnelle
(73 %), sur les relations avec la famille et les amis (54 %),
sur les relations sexuelles (50 %). Ils ressentent des diffi cul-
tés à se projeter dans l’avenir (65 %), des diffi cultés dans
les tâches quotidiennes (44 %). L’impact sur la qualité de
vie est quantifi é en moyenne à 6,4 sur une échelle de 10, et
les phases dépressives sont ressenties comme plus gênantes
que les phases maniaques (76 % vs 43 %).
Un autre aspect du retentissement social, particulière-
ment mis en évidence dans cette enquête, est le sentiment
d’isolement et de stigmatisation. Deux tiers des patients
jugent que les troubles sont sources de rejet, et trois quart
déclarent avoir déjà été l’objet d’attitudes de rejet ou de
discrimination directement liées à leur maladie, de la part
de collègues de travail (50 %), de leur employeur (32 %), de
Le discours des patients et de leurs familles est de plus
en plus pris en compte, en médecine et en psychiatrie,
avec des incitations légales et réglementaires, et l’intérêt
d’une collaboration avec les associations de patients et de
familles devient évident.
Pourtant, la littérature concernant le domaine du vécu
des troubles bipolaires rapporté par les patients est très
peu fournie ; on peut rappeler deux études, l’une améri-
caine [4], l’autre européenne [8,9], réalisées auprès d’as-
sociations de patients dépressifs et bipolaires.
L’enquête dont les résultats sont présentés ici est l’en-
quête « ECHO » (perception du vécu chez des patients bipo-
laires), première étude française de ce type, et qui avait
pour objectif d’évaluer le vécu de patients souffrant de
trouble bipolaire de type I (de type I uniquement afi n d’évi-
ter des interprétations erronées du fait de la grande hété-
rogénéité du trouble bipolaire) [2]. Au total, 300 patients
ont été sélectionnés par la méthode des quotas de repré-
sentativité nationale par un recrutement diversifi é (psy-
chiatres, médecins généraliste, association, panel d’institut
de sondage). Les patients étaient interviewés par télé-
phone par des interviewers préalablement formés, au cours
d’un entretien semi-directif avec un questionnaire de
32 items. Quatre domaines d’intérêt étaient explorés :
l’histoire et le vécu de la maladie, les attentes des patients,
les relations avec l’environnement social et familial, et la
prise en charge. Dans l’échantillon de 300 patients, l’âge
moyen était de 40 ans, 67 % étaient des femmes, 50 %
vivaient en couple, 74 % avaient une activité profession-
nelle et 54 % un niveau d’étude supérieure. Rapportées aux
connaissances épidémiologiques sur le trouble bipolaire,

Enquête sur le vécu des patients bipolaires 19
Dans l’ouvrage de référence sur les troubles de l’hu-
meur et le trouble bipolaire, Goodwin et Jamison [1] résu-
ment le pronostic du trouble bipolaire en soulignant que
sur le plan des manifestations cliniques, seul un tiers des
patients atteint la rémission complète, tandis qu’un sur
cinq présente des manifestations de la maladie de façon
constante, et la moitié n’est pas indemne de symptôme.
Sur le plan du fonctionnement social, les auteurs considè-
rent que seuls 30 % des patients ont une récupération fonc-
tionnelle complète, tandis que 30 % présentent un véritable
handicap social, 40 % présentant un handicap plus modéré
mais réel.
La persistance de symptômes dits résiduels, après l’ob-
tention d’une rémission de la dépression ou de la manie,
constitue un autre enjeu thérapeutique majeur. En
témoigne l’étude naturaliste prospective STEP-BD
(Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar
Disorder) portant sur 1 500 patients, où durant le suivi de
deux ans, 58 % seulement des patients sont en rémission, et
49 % ont récidivé, le risque de récidive étant accru en pré-
sence de symptômes résiduels [10].
Le moment du diagnostic
Parmi les marges de progression dont on dispose pour amélio-
rer la prise en charge des patients souffrant de troubles bipo-
laires, une diminution du retard au diagnostic est l’une des
plus importantes. Dans l’étude ECHO, la quasi totalité des
patients a consulté au moins une fois avant l’établissement du
diagnostic de trouble bipolaire, pour des symptômes du
registre bipolaire : trouble du sommeil, anxiété, troubles
dépressifs, fatigue, troubles du comportement (Fig. 1)
L’acteur-clé du diagnostic reste le psychiatre : dans la
majorité des cas, le psychiatre est l’intervenant de santé
qui a posé le diagnostic, alors que 74 % des patients étaient
déjà suivis par un médecin généraliste au moment du dia-
gnostic, le diagnostic étant souvent posé à l’occasion de la
première hospitalisation.
Le trouble bipolaire est un trouble qui se manifeste
tôt : dans l’enquête ECHO, l’âge moyen des premières
manifestations du trouble est de 25 ans, l’âge moyen au
moment du diagnostic est de 30 ans, coïncidant souvent
avec une hospitalisation (schéma de la diapositive 18). On
peut également relever que près de 40 % de sujets avaient
présenté une symptomatologie avant 18 ans, le diagnostic
ayant été porté avant 18 ans chez 15 % des sujets. Ces don-
nées sont cohérentes avec celles de l’étude euro-
péenne [8,9], dans laquelle 33 % des patients avaient
présenté leurs premiers symptômes avant 20 ans ; les
chiffres nord-américains [4] montrent, même, que les pre-
miers symptômes apparaissaient avant 20 ans chez 50 % des
patients.
L’enquête ECHO [4] souligne un point essentiel : malgré
une communication importante dans le grand public autour
leurs amis (44 %), ou de leur famille (36 %). Si l’ensemble
des patients disent avoir au moins un interlocuteur pour
parler de leurs troubles, il s’agit essentiellement de profes-
sionnels de santé (95 %), et encore trop rarement de la
famille (43 %) ou des amis (52 %).
Ces données sont en accord avec celles de l’étude euro-
péenne [8,9], où les patients notaient majoritairement un
impact notable de la maladie sur leur vie passée ou
actuelle, et relevaient fréquemment des interférences de
la maladie avec leurs relations familiales, amicales, conju-
gales, professionnelles, le trouble bipolaire ayant, pour 30
à 40 % d’entre eux, constitué un handicap pour leur car-
rière professionnelle.
Le devenir fonctionnel doit être in fi ne notre préoccu-
pation majeure. Ainsi, dans Tohen et al. [11] objectivaient
ce retentissement social, en montrant que 2 ans après une
première hospitalisation pour manie, si la grande majorité
des patients (98 %) étaient en rémission syndromique, et
une large proportion étaient en rémission symptomatique
(72 %), seuls 43 % étaient en rémission fonctionnelle.
Le vécu de la maladie
D’une manière générale, les sujets bipolaires ont conscience
de la chronicité de la maladie. La majorité d’entre eux
pensent que les troubles bipolaires peuvent être soignés
(61 %) et qu’ils sont maîtrisables (68 %). Mais une majorité
également a peur de la rechute (69 %) et ressent la néces-
sité d’efforts permanents pour contrôler la maladie (64 %).
Même si les patients étaient considérés par leur théra-
peute comme en phase d’euthymie pour être inclus dans
l’enquête, ils se sentent mal stabilisés dans 42 % des cas,
avec une symptomatologie résiduelle surtout dépressive
(31 %), mais aussi qualifi ée « d’agitation » (11 %) ou proche
de « l’agitation » (10 %). En conséquence, l’acceptation de
la maladie est diffi cile ; et 56 % des patients seulement se
sentent personnellement bipolaires, 10 % ne se sentant pas
bipolaires, et 33 % variant d’opinion selon les jours.
Ceci fait écho aux résultats des fameuses études de
l’équipe de Judd [5,6], ayant suivi des patients bipolaires I
et II durant plus de 10 ans, avec des agendas de l’humeur
renseignés de façon hebdomadaire, et qui montrent que les
patients passent près de la moitié de leur temps avec des
symptômes, le plus souvent dépressifs (32 %, dont 24 % sub-
syndromiques et 8 % en épisode dépressif majeur). De plus,
les patients changent de statut thymique en moyenne 6 fois
dans l’année, et changent 3 fois par an au moins de pola-
rité. En dehors des épisodes dépressifs et maniaques francs,
visibles, persistent souvent des symptômes : dépression,
fatigue, manque d’énergie ou au contraire agitation, exci-
tation. Tout ceci a nécessairement un retentissement sur
leur fonctionnement social, professionnel et familial, et
ce, dès lors qu’existent des symptômes thymiques, qu’ils
soient dépressifs ou maniaques.

P. Courtet, S. Guillaume20
par un psychiatre – libéral dans 545 % des cas –, 55 % par un
médecin généraliste, et 14 % par un psychologue ou psycho-
thérapeute.
Plus de 90 % indiquent prendre des médicaments, mais
sont capables de citer le nom de ce médicament. La poly-
thérapie est assez fréquente, puisque 24 % des patients
prennent deux médicaments, 13 % en prennent 3, et 5 %
plus de 3. Alors que les recommandations insistent toutes
sur la nécessité d’un traitement thymorégulateur, seuls
34 % des sujets interrogés dans cette enquête déclarent
être sous régulateur de l’humeur : lithium, anticonvulsi-
vant, ou antipsychotique de seconde génération. Par
ailleurs, 44 % reçoivent un antidépresseur, et 38 % un anxio-
lytique ou un sédatif. Pour contribuer à l’amélioration de la
prise en charge des patients atteints de trouble bipolaire,
citons les récentes recommandations formalisées d’experts
françaises pour le dépistage et la prise en charge du trouble
bipolaire [7].
Concernant les effets indésirables du traitement, 84 %
des patients de l’enquête ont ressenti des effets secon-
daires suite à leur traitement actuel, et 42 % ont ressenti
au moins 3 effets secondaires. Les plus fréquemment
du trouble bipolaire, le délai moyen entre la première
consultation et le diagnostic reste très important en ce
début de XXIe siècle : il était de 5,7 ans dans l’enquête euro-
péenne, il reste d’environ 5 ans dans l’enquête ECHO.
Dans cette enquête, 60 % des patients ont été hospita-
lisé pour la première fois à l’occasion d’une phase dépres-
sive ou d’une tentative de suicide, ce qui laisse penser
qu’on pourrait améliorer le dépistage du trouble bipolaire
chez les jeunes sujets admis pour tentative de suicide
(Fig. 2).
Ainsi, un travail de l’équipe de Montpellier [3] a com-
paré le risque suicidaire lors d’un épisode dépressif chez
des patients bipolaires et chez des patients dépressifs
récurrents. Ce travail montre que le diagnostic de trouble
bipolaire est associé avec la sévérité de la tentative de
suicide et avec l’existence d’une histoire familiale de sui-
cide. L’existence de ces variables doit donc inciter le clini-
cien a recherche de façon encore plus ardente l’existence
d’un trouble bipolaire.
La prise en charge
En phase dépressive, l’enquête ECHO montre que les
patients sont majoritairement hospitalisés à leur demande,
alors qu’en phase maniaque ils le sont à la demande d’un
médecin, d’un tiers, ou des pouvoirs publics (Fig. 3).
Les patients ont un vécu contrasté de leur hospitalisation :
si en grande majorité ils se sont sentis aidés et en sécurité à
l’hôpital, 52 % se sont sentis enfermés, et 21 % rejetés par
l’entourage et le monde extérieur (Fig. 4). Plus surprenant
peut-être, 42 % des patients restituent une indifférence vis-à-
vis de la situation d’hospitalisation qu’ils vivent.
Concernant la prise en charge externe, la totalité des
patients étaient suivis par un professionnel de santé : 73 %
Des troubles du sommeil
Des symptômes dépressifs
Des crises d’angoisses
Une grande fatigue
Des troubles alimentaires
Plus d’une fois Une fois
53
52
51
46
33
10 35
27
38
36
57
59
63
71
60
62
41
39
19
9
8
2
2
2
2
2
29
16
30
NSP
Jamais
Des troubles du comportement
tel que irritabilié, agressivité, violence
Figure 1 Les 1ers signes amenant à consulter. 99 % des patients ont consulté au moins une fois pour ces Sp.
Phase dépressive
Épisode d’agitation
et d’exaltation
(accès maniaque)
Tentative de suicide
Autre
41 %
38 %
18 %
Figure 2 Motif de première hospitalisation. 60 % des
patients pour une phase dépressive ou une TS.

Enquête sur le vécu des patients bipolaires 21
expriment par la demande de voir diminuer les idées reçues
sur le trouble bipolaire dans la société. Autant de défi s pour
les psychiatres et leurs partenaires naturels, patients et
familles.
Confl its d’intérêt
P. Courtet, S. Guillaume : Enquête ECHO soutenue par les
laboratoires BMS.
Références
[1] Goodwin FK, Jamison KR. Manic-depressive illness : Bipolar
disorders and recurrent depression. New York, Oxford Univer-
sity Press, 2007.
décrits étaient la fatigue (41 %), la sécheresse buccale
(41 %), une prise de poids (35 %), des troubles digestifs
(33 %), et des troubles du sommeil (27 %).
Conclusion
La dernière partie de l’enquête ECHO portait sur les besoins
que ressentent les patients atteints de troubles bipolaires :
ceux-ci font ressortir un besoin de dialogue, une prise en
charge plus personnalisée, qui nécessiterait de mieux
prendre en compte l’âge, le sexe du patient, le moment
évolutif de la maladie (Fig. 5). Ils demandent également
d’être aidés pour retrouver un meilleur fonctionnement
psychosocial, et souhaitent une amélioration des représen-
tations sociales de la maladie, une déstigmatisation, qu’ils
57
À la demande du patient
Demande d’un médecin
Demande d’un tiers (HDT)
Demande des pouvoirs
publics (HO)
78 % pour accès
maniaque
65 % pour phase
dépressive
% patients
57 %
37 %
36 %
8 %
Figure 3 Demande d’hospitalisation…
En sécurité 38 46
51
23
23
18
27
28
33 35
25
20
13
97
6
1
1
5
30
29
19
13
21
42
52
81
84
% patients
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
NSP
Base population n = 300
Aidé
Enfermé
Indifférent
Rejeté
Figure 4 Ressenti des hospitalisations.

P. Courtet, S. Guillaume22
[7] Llorca PM, Courtet P, Martin P, et al. Recommendations for-
malisées d’experts : Dépistages et prise en charge du trouble
bipolaire. Encephale 2010;36S4:S86-102.
[8] Morselli PL, Elgie R. GAMIAN-Europe/BEAM survey I – -global
analysis of a patient questionnaire circulated to 3450 mem-
bers of 12 European advocacy groups operating in the field of
mood disorders. Bipolar Disord 2003;5:265-78.
[9] Morselli PL, Elgie R, Cesana BM. GAMIAN-Europe/BEAM survey
II: cross-national analysis of unemployment, family history,
treatment satisfaction and impact of the bipolar disorder on
life style. Bipolar Disord 2004;6:487-97.
[10] Perlis RH, Ostacher MJ, Patel JK, et al. Predictors of recur-
rence in bipolar disorder: primary outcomes from the System-
atic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder
(STEP-BD). Am J Psychiatry 2006;163(2):217-24.
[11] Tohen M, Zarate CA Jr, Hennen J, et al. The McLean-Harvard
First-Episode Mania Study: prediction of recovery and first
recurrence. Am J Psychiatry 2003;160(12):2099-107.
[2] Guillaume S, Courtet Ph, Chabannes JP, et al. Prises en
charge, besoins et attentes de patients souffrant de troubles
bipolaires I’Etude ECHO – France. L’Encéphale (in press).
[3] Guillaume S, Jaussent I, Jollant F, et al. Suicide attempt charac-
teristics may orientate toward a bipolar disorder in attempters
with recurrent depression. J Affect Disord 2010;122(1-2):53-9.
[4] Hirschfeld RM, Lewis L, Vornik LA. Perceptions and impact of
bipolar disorder: how far have we really come? Results of the
national depressive and manic-depressive association 2000
survey of individuals with bipolar disorder. J Clin Psychiatry
2003;64:161-74.
[5] Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, et al. The long-term natural
history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder.
Arch Gen Psychiatry 2002;59(6):530-7.
[6] Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, et al. Psychosocial disabil-
ity in the course of bipolar I and II disorders: a prospective,
comparative, longitudinal study. Arch Gen Psychiatry
2005;62(12):1322-30.
Plus de dialogue avec les professionnels de santé
Un travail valorisant
Une aide pour gérer la vie professionnelle
Plus de soutien des proches
Des médicaments avec moins d’effests secondaires
Davantage d’explications sur les traitements
médicamenteux
Une prise en charge plus personnalisé
Davantage de conseils pratiques, des astuces
Moins d’idées reçues sur les troubles bipolaires
dans la société
Autre
Aucun
% patients
51
46
40
37
35
34
34
32
30
4
1
Figure 5 Les besoins des patients bipolaires : des perspectives de progrès.
1
/
5
100%