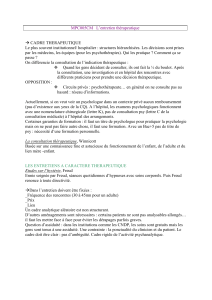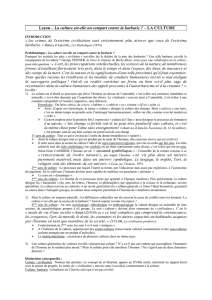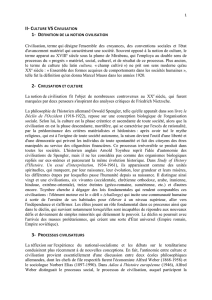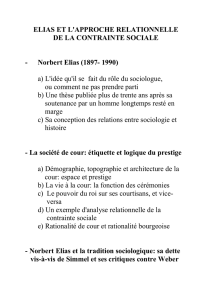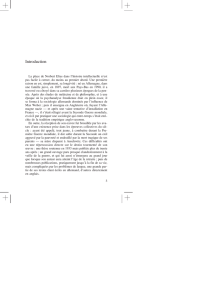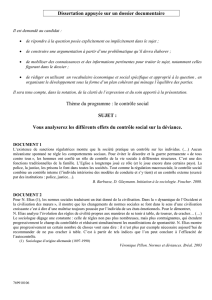Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias

Laurent Martin, « Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias, Adorno et Horckheimer »,
Histoire@Politique, n° 26, mai-août 2015, www.histoire-politique.fr
1
Le pessimisme culturel.
Civilisation et barbarie
chez Freud, Elias, Adorno et Horkheimer
Laurent Martin
Dans l'histoire conceptuelle longue de la notion de « barbarie », la première moitié
du XXe siècle marque une inflexion décisive. Les deux conflits mondiaux, avec leur
cortège d'horreurs planifiées, la guerre industrielle et l'extermination de masse,
donnent à penser que la barbarie n'est pas l'antonyme de la civilisation moderne mais
pourrait être son ombre portée. C'est une idée ancienne, présente déjà chez
Montaigne, réactivée au XIXe siècle par des philosophes comme Schopenhauer ou
Nietzsche, des écrivains comme Baudelaire ou Flaubert, mais qui prend à l'époque
qui nous intéresse un tour nouveau du fait des massacres à grande échelle (comme en
témoigne le doute qui saisit l'historien anglais Arnold Toynbee au retour d'un voyage
en Turquie au début des années 1920 pendant la guerre gréco-turque : ce progressiste
libéral, futur auteur d'une histoire universelle, se demande si le sens de l'histoire est
bien celui du progrès général de l'humanité...)1.
Quatre auteurs ont abordé frontalement cette question ; ils ont pour point commun
d'avoir privilégié l’approche psycho-historique, mais leurs analyses présentent
cependant d’intéressantes différences, en dépit des similitudes entre leur parcours
biographique et intellectuel. Ces auteurs sont Sigmund Freud, Norbert Elias, Theodor
Adorno et Max Horkheimer. Quatre intellectuels juifs de culture et de langue
germaniques, quatre exilés ayant fui l’Allemagne dans l’entre-deux-guerres en raison
des menaces qui pesaient sur eux du fait de leur judéité, de leurs opinions politiques,
de leurs recherches, en somme, de ce qu’ils représentaient aux yeux des nazis. Quatre
penseurs que les circonstances, l’expérience qu’ils vécurent, autant que les objets sur
lesquels ils travaillaient, obligèrent à réfléchir avec une particulière acuité sur la
violence, la guerre, le meurtre de masse, et sur le phénomène étrange d’un pays, situé
au cœur de l’espace et de l’époque les plus « civilisés », faisant apparemment retour
vers la barbarie. Ces noms dessinent les contours d’une famille de pensée qui, en
dépit de tout ce qui sépare ses membres, se caractérise par son pessimisme culturel :
la civilisation, essentiellement répressive et pathogène, enserre les Européens des
XIXe et XXe siècles dans un ensemble de contraintes toujours plus fortes et engendre
sa propre forme de barbarie, distincte de celle, historique ou mythique, exotique ou
domestique, contre laquelle la civilisation européenne s’était édifiée depuis le
XVIIIe siècle dans le culte du progrès tout à la fois matériel et moral. Comment
penser ce paradoxe historique, telle est la question commune ; voyons maintenant les
réponses que chacun d’entre eux apporta.
1 Voir les travaux de Pierre-André Taguieff sur l'histoire du progrès et de ses adversaires, notamment Le
Sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Paris, Flammarion, « Champs », 2006.

Laurent Martin, « Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias, Adorno et Horckheimer »,
Histoire@Politique, n° 26, mai-août 2015, www.histoire-politique.fr
2
Sigmund Freud ou la barbarie comme constante
biologique et anthropologique
La psychanalyse de Freud constitue-t-elle, comme le soutient Odo Marquard, une
« forme réduite », un « palier réduit » de la philosophie de l’histoire2 ? Je dirais
plutôt que la psychanalyse hérite d’un certain nombre de thèmes, de concepts, de
problématiques issus du corpus de la philosophie de l’histoire qu’elle traduit dans ses
propres termes. Mais le problème qui se posait à Freud est moins celui de l’usage de
notions issues de la philosophie que de la montée en généralité d’observations
réalisées dans l’exercice de la clinique. Freud ne se considérait ni comme un
philosophe, ni comme un historien mais comme un médecin. Le passage de la
clinique, observation située, directe, individuelle, à fin thérapeutique, à des
considérations plus vastes, potentiellement universelles, et sur une séquence
temporelle à l’échelle de l’humanité, a toujours constitué, pour lui-même comme
pour ses successeurs, un problème épistémologique et méthodologique aigu, en
même temps que l’un des angles d’attaque privilégiés par ses adversaires. On
remarquera d’ailleurs que les ouvrages engageant des réflexions sur l’évolution des
sociétés humaines sont relativement tardifs dans l’œuvre de Freud : Totem et Tabou
date de 1913, Considérations actuelles sur la guerre et la mort de 1915, Psychologie
des masses et analyse du Moi de 1919-1920, L’Avenir d’une illusion de 1927, Malaise
dans la culture de 1929, Pourquoi la guerre ?, écrit avec Einstein, de 1932, Moïse et
le monothéisme de 1934. Parmi ceux-ci, Malaise dans la culture apparaît comme la
synthèse la plus aboutie de la métapsychologie freudienne et je prendrai donc mon
élan à partir de ce livre3.
Dans cet ouvrage, Freud constate un paradoxe étonnant : la culture est la somme des
réalisations les plus hautes de l’homme et de celles qui le protègent des fureurs de la
nature ; et pourtant, l’homme n’est pas heureux parmi ses œuvres. La clef de ce
mystère réside dans la nature répressive de la culture. Celle-ci a pour fonction de
combattre les tendances agressives et autodestructrices de l’homme que Freud,
depuis le réaménagement de sa théorie des pulsions, en 1920, désigne par le terme de
« Thanatos ». Pour ce faire, la culture inhibe et détourne à son profit les pulsions de
vie, les pulsions érotiques. L’ « Éros » inhibé et détourné quant à son but produit de
l’estime, de la tendresse, de l’amitié et même des philosophies de l’amour, tous liens
qui rassemblent les hommes, leur permettent de faire face à la nécessité et modèrent
leur propension à s’entretuer. Mais la non-satisfaction des pulsions érotiques, la
dissimulation du rôle de la sexualité dans la société européenne corsetée par les
interdits produit un « malaise » qui peut devenir insupportable à l’individu.
Ce malaise provient aussi de l’instauration du droit appuyé sur la force, de la
culpabilisation par la conscience morale, de l’exigence éthique, autres moyens forgés
par la culture pour prévenir la violence naturelle de l’homme. Ici, plus encore qu’avec
le détournement des pulsions de vie, la nécessité de recourir à une vision de l’histoire
2 Odo Marquard, Des difficultés avec la philosophie de l’histoire, Paris, MSH, 2002. Selon cet auteur,
« la théorie psychanalytique ne doit pas être comprise comme une opposition mais plutôt comme un état
déterminé de la philosophie de l’histoire : comme la figure désenchantée de la philosophie de la nature
fondée sur la philosophie transcendantale telle qu’elle a été développée par Schelling (…). En
transformant les problèmes de philosophie de l’histoire en problèmes de philosophie de la nature, (elle)
constitue elle-même une forme, mais une forme réduite de la philosophie de l’histoire : un palier réduit »
(p. 15-16).
3 Sigmund Freud, Le Malaise dans la culture, Paris, PUF, 1995 (1929).

Laurent Martin, « Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias, Adorno et Horckheimer »,
Histoire@Politique, n° 26, mai-août 2015, www.histoire-politique.fr
3
– à défaut d’une philosophie conceptuellement articulée — apparaît avec évidence.
Les mythes de la horde et du meurtre primordial, la thèse, empruntée au biologiste
darwiniste Haeckel, d’une récapitulation onto-phylogénétique, l’explication de la
culpabilité par le remords, inscrit en chaque individu, du meurtre du premier père
par ses fils plongent l’anthropologique dans le biologique et le présent dans l’histoire
la plus lointaine. À mesure que le groupe s’élargit, que le clan devient tribu puis
nation, l’agressivité est de plus en plus intériorisée sous forme de conscience morale.
Là encore, le malaise apparaît comme le prix à payer pour renforcer la cohésion du
groupe contre ses ferments de discorde :
« Comme la culture obéit à une impulsion érotique intérieure qui lui ordonne de
réunir les hommes en une masse intimement liée, elle ne peut atteindre ce but que par
la voie d’un renforcement toujours croissant du sentiment de culpabilité. Ce qui fut
commencé avec le père s’achève avec la masse. Si la culture est le parcours de
développement nécessaire menant de la famille à l’humanité4, alors est
indissolublement lié à elle, comme conséquence de l’éternel désaccord entre amour et
tendance à la mort, l’accroissement du sentiment de culpabilité, porté peut-être à des
hauteurs que l’individu trouve difficilement supportable5. »
Selon Freud, l’humanité doit faire face à un double défi : d’une part, trouver un
« équilibre approprié » — c’est-à-dire porteur de bonheur — entre les revendications
individuelles à la satisfaction des pulsions, et les revendications culturelles de la
communauté à la cohésion et à la survie ; d’autre part, contrôler les forces d’agression
et d’auto-anéantissement. Quant au premier point, Freud esquisse, dans Malaise
dans la culture quelques « propositions thérapeutiques » limitées visant à abaisser
les exigences du surmoi culturel, à accorder aux pulsions érotiques une satisfaction
partielle, et surtout à mieux éduquer les individus à la réalité des rapports humains.
Quant au second, il recommande, dans Pourquoi la guerre ?, de renforcer toutes les
formes d’identification et de cohésion — l’Éros —, de détourner les penchants
agressifs vers d’autres objets que la destruction (on songe ici au rôle des passions
sportives qu’analysera Elias) ou encore, renouant avec l’aristocratisme intellectuel
hérité de Platon, de constituer une « classe supérieure » d’individus ayant soumis
leur vie pulsionnelle à la « magistrature de la raison » et auxquels reviendrait de ce
fait la direction des masses.
Ces divers subterfuges, plus ou moins convaincants, ne feront pas disparaître les
instincts agressifs de l’humanité. Ceux-ci sont ancrés dans la mémoire de l’espèce et
l’on peut tout au plus les contenir, non les supprimer. Dans les Considérations
actuelles sur la guerre et la mort, déjà, rédigées à la sombre lumière de la Première
Guerre mondiale, Freud estimait que la guerre, en nous dépouillant des acquis de la
civilisation, met à nu « l’homme originaire » qui est en nous, révèle la vraie nature du
descendant d’une « série infiniment longue de générations de meurtriers qui (…)
avaient la passion du meurtre dans le sang6 ». La guerre moderne, mécanisée,
industrialisée, n’invente rien, sinon les moyens d’une totale destruction mutuelle.
Entre Éros et Thanatos, le combat perdure, l’enjeu est simplement plus élevé — « qui
peut présumer du succès et de l’issue ? » s’interroge Freud dans une dernière phrase
4 Souligné par moi.
5 Sigmund Freud, op. cit., p. 76.
6 Sigmund Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, édition électronique de l’université
de Chicoutimi, Québec, 2002 (1915), p. 24 : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.frs.con2 (lien consulté le
12 mai 2015)

Laurent Martin, « Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias, Adorno et Horckheimer »,
Histoire@Politique, n° 26, mai-août 2015, www.histoire-politique.fr
4
ajoutée au Malaise dans la culture dans l’édition de 1931, comme un codicille
angoissé. Deux ans plus tard, Hitler parvenait au pouvoir en Allemagne et lançait ce
pays sur la voie de nouveaux meurtres de masse, à une échelle encore jamais vue.
« Nous vivons un temps particulièrement curieux » note Freud en 1934 dans Moïse et
le monothéisme : « nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte
avec la barbarie », parlant encore d’une « régression vers une barbarie presque
préhistorique du peuple allemand7. »
Que la barbarie soit régression, retour vers un état originel de l’homme, mais en
même temps révélation d’une constante biologique et anthropologique interdit à
Freud les facilités du passéisme ou les illusions utopiques de la société harmonieuse.
Malgré les frustrations engendrées par la culture, on ne trouvera chez lui aucune
nostalgie pour un âge d’or ni aucun espoir d’un avenir débarrassé des contradictions
qui torturent l’humanité. En fait, Freud partageait largement la vision hobbesienne
de l’histoire : comme chez Hobbes, les humains sont des organismes soumis aux
pulsions de plaisir et à la douleur mais un principe d’utilité gouverne leurs actions ;
constituant les uns pour les autres une menace mortelle, ils échangent une part de
leur liberté pour un surcroît de sécurité et abandonnent à une autorité centrale et
supérieure le soin de la concorde (c’est la théorie classique de la « réunion des
faiblesses »). Selon Freud, l’État hérite de l’omnipotence du père primordial et
instaure une autorité qui pacifie les violences individuelles. La violence du chef puis
de l’État, intériorisée par les individus comme surmoi, s’exerce contre ceux qui
refusent de se soumettre à la volonté du souverain, c’est-à-dire de la majorité, et
contre les communautés étrangères, tout l’enjeu consistant pour les nations, à l’heure
des armes de destruction massive — Freud n’emploie évidemment pas cette formule
mais l’idée est bien celle-là —, de trouver le moyen de se passer de cette violence
dirigée vers l’extérieur des communautés. Là encore, la nécessité d’une autorité
centrale, cette fois supranationale, à laquelle sera conféré le droit de légiférer dans
tous les conflits d’intérêts, s’impose : la Société des Nations (SDN) incarnera et
trahira, tout à la fois, cet espoir et cette nécessité.
Indépendamment de l’évolution de l’actualité internationale et de sa propre vie, il y a
donc une tension dans la pensée de Freud entre, d’une part, un pessimisme foncier,
lié au caractère indépassable car biologiquement fondé de la pulsion de mort,
notamment sous sa forme agressive, ainsi qu’au caractère nécessairement répressif
de la culture, et, d’autre part, un optimisme hérité des Lumières8. Un dépassement du
fatum semble possible par la modification des attitudes psychiques, le bridage
organique des pulsions, la naturalisation de l’interdit — c’est ainsi qu’il interprète
l’intolérance qu’éprouvent les pacifistes de conviction envers la guerre : « Les
conceptions psychiques vers lesquelles l’évolution de la culture nous entraîne se
trouvent heurtées de la manière la plus vive par la guerre, et c’est pour cela que nous
7 Cité par David Benhaim, « Freud et la question de la guerre », dans Topique, revue freudienne, n° 99,
« Psychanalyse, violence et société », 2007, p. 177-183.
8 Philippe Rieff notait justement que l’on pouvait faire deux lectures de Freud historien des guerres et de
la violence : la première voit en lui l’héritier des Lumières qui considère que les guerres ne sont que des
épisodes régressifs qui ne remettent pas en cause le progrès général ; la seconde fait de Freud le clinicien
des échecs répétés de la civilisation, prise dans un mouvement cyclique scandé par les guerres. (Philippe
Rieff, « La signification de l’histoire et de la religion dans la pensée de Freud », dans Alain Besançon
(dir.), L’Histoire psychanalytique : une anthologie, Paris-La Haye, éd. Mouton, 1974, p. 40-67.) Freud
n'adhérait en tout cas pas à la conception de la modernité comme temps nouveau et nouveauté sans
précédent, comme idée de progrès en phase d’accélération croissante, comme disponibilité de l’histoire
ou comme capacité normative des hommes à faire leur histoire.

Laurent Martin, « Le pessimisme culturel. Civilisation et barbarie chez Freud, Elias, Adorno et Horckheimer »,
Histoire@Politique, n° 26, mai-août 2015, www.histoire-politique.fr
5
devons nous insurger contre elle ; nous ne pouvons simplement plus du tout la
supporter9. » C’est cette intuition d’une modification des attitudes psychiques par le
processus de civilisation que devait explorer Norbert Elias.
Norbert Elias ou la barbarie comme régression
historique
Comme on sait, Norbert Elias développe sa théorie du processus (ou procès) de
civilisation dans son livre Über den Prozess der Zivilisation paru en 193910. On peut
la résumer à très grands traits en disant qu’elle articule changement social et
modification des sensibilités et des comportements individuels. Considéré sur une
longue période — du Moyen Âge au XXe siècle —, le changement social voit s’allonger
et se densifier la chaîne des interdépendances entre les individus et entre les classes
sociales, une différenciation et une division croissante des fonctions sous la pression
de la compétition qui régit la vie dans des communautés de plus en plus larges. Dans
le même temps se constituent des monopoles de la contrainte physique et de l’impôt,
les États modernes, qui instaurent une paix intérieure et luttent entre eux pour
l’hégémonie européenne puis planétaire. Ce ne sont pas les facteurs économiques ni
les facteurs politiques seuls qui expliquent le mouvement d’ensemble — il n’y a pas de
première ou de dernière instance, d’infra- ou de super-structure comme dans la
théorie marxiste — mais un tissu d’interactions en tension et en évolution constantes.
Ces changements de grande ampleur — quoique passant souvent inaperçus, tant leur
marche est progressive et continue — ont, selon Elias, une incidence directe sur la
façon dont les individus pensent et agissent. « Les contraintes d’interdépendance qui
agissent si manifestement dans le sens d’une modification plus ou moins rapide des
institutions et des interrelations humaines s’accompagnent tout aussi manifestement
de transformations équivalentes au niveau de l’âme et des structures psychiques de
l’homme11. » Ces transformations vont toutes dans le même sens, celui d’une maîtrise
toujours plus efficace de leurs émotions par les individus, un remplacement
tendanciel du contrôle exercé par les autorités extérieures par un autocontrôle dont le
fonctionnement est en partie conscient, en partie automatique. La complexification
des rapports dans lesquels sont pris les individus rendant plus coûteuse la
manifestation incontrôlée de leurs émotions, ils apprennent dès l’enfance à les
réfréner pour se conformer aux modèles de comportement qui leur sont inculqués. La
rationalisation des organisations sociales va donc de pair avec la rationalisation des
systèmes hérités de dispositions, ou habitus.
Pour construire cet édifice théorique, Elias a emprunté à plusieurs auteurs : à
l’historien Huizinga pour l’histoire des sociétés européennes et l’historicité du
psychisme humain ; à Max Weber pour l’analyse du changement social, la
rationalisation, la division des fonctions, la monopolisation de la violence légitime ; à
Freud, enfin, pour l’idée d’une culture essentiellement répressive, bâtie sur le
refoulement des pulsions. La dette d’Elias envers Freud me semble particulièrement
9 Sigmund Freud, Pourquoi la guerre ?, édition électronique de l’université de Chicoutimi, Québec, 2006
(1933), p. 20 : http://dx.doi.org/doi:10.1522/24751170 (lien consulté le 12 mai 2015).
10 Traduit en français en deux tomes chez Calmann-Lévy, le premier paru sous le titre La Civilisation des
mœurs en 1973, le tome second sous le titre La Dynamique de l’Occident en 1976.
11 Norbert Elias, La Dynamique de l’Occident, op. cit., p. 305.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%