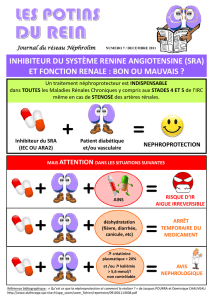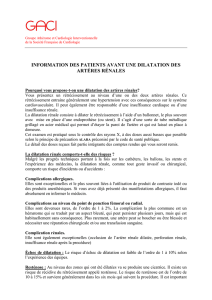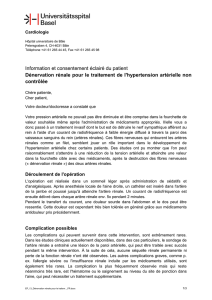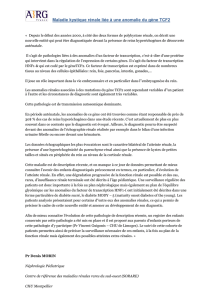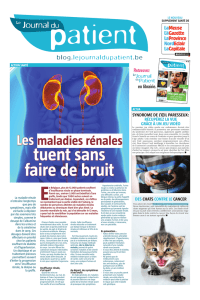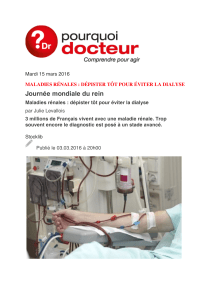HYPERTENSION

La Lettre du Cardiologue • n° 442 - février 2011 | 29
HYPERTENSION
Cette rubrique
a été réalisée avec
le soutien institutionnel
du Laboratoire MENARINI.
Elle témoigne de l’engagement
de MENARINI dans le domaine
de l’hypertension artérielle.
Coordonnée par
le Pr J.J. Mourad
Dans le respect total de l’indépendance scientifique et éditoriale.
Références bibliographiques
1. Bax L, Woittiez AJ, Kouwenberg HJ et al. Stent placement in patients with
atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized
trial. Ann Intern Med 2009;150(12):840-8.
2. Plouin PF, Bax L. Diagnosis and treatment of renal artery stenosis. Nat Rev
Nephrol 2010;6(3):151-9.
Pr C. Jacquot, service de néphrologie,
hôpital européen Georges-Pompidou, Paris
Quelles sont les principales indications de dilatation
des sténoses d’artères rénales ?
Dans le cas particulier de l’HTA secondaire à une sténose de l’ar-
tère rénale par fibrodysplasie de la femme jeune ou de l’enfant,
l’angioplastie permet d’obtenir d’excellents résultats. À l’opposé, il
n’existe aucun intérêt à dilater de façon systématique les sténoses
athéroscléreuses des artères rénales. Les conclusions de 5 grands
essais prospectifs randomisés sont sans appel et ne montrent
aucun bénéfice de l’angioplastie par rapport à un traitement
médical bien conduit : pas d’amélioration de la fonction rénale, pas
ou peu d’amélioration de l’HTA et absence de bénéfice en ce qui
concerne le pronostic cardiovasculaire et vital (1, 2). Ce message
très négatif doit cependant être tempéré, car ces essais ont des
limitations importantes : faiblesse des effectifs pour 4 d’entre
eux, exclusion a priori de certains patients (les plus susceptibles
d’en bénéficier), insuffisance rénale modeste ou absente, défini-
tion photographique et non fonctionnelle de la sténose (> 50 ou
60 %), ce qui peut en expliquer en partie leurs résultats. Un nouvel
essai multicentrique international destiné à évaluer l’intérêt de
la dilatation des seules sténoses supérieures à 70 % a été lancé.
Mais, en dépit des résultats de ces grands essais, le clinicien “de
terrain” sait, par expérience, que l’angioplastie peut sauver un
petit nombre de patients dans des situations cliniques bien parti-
culières et peu fréquentes.
En pratique, quels patients peuvent être
concernés par cette procédure ? Les œdèmes
aigus du poumon à répétition du sujet âgé
peuvent-ils constituer une indication ?
L’angioplastie doit être discutée chez les patients âgés, hyper-
tendus et avec une athérosclérose diffuse et symptomatique – ces
critères constituant une indication incontournable de traitement
par IEC ou sartan – lorsqu’on assiste à l’apparition ou l’aggravation
rapide de la fonction rénale à l’introduction de ces classes théra-
peutiques. Il faut alors chercher une sténose des artères rénales
par échographie-Doppler, si la morphologie du patient le permet,
ou par angio-IRM. Ce dernier examen a cependant tendance à
surestimer le degré de sténose. Si la sténose est bilatérale ou sur
rein unique, serrée (> 70-80 %), et si le rein en aval mesure plus
de 80 mm de haut, l’angioplastie doit être tentée si l’état des axes
iliaques et de l’aorte le permet. Son succès permet de maintenir
les IEC/ sartans et de préserver ou d’améliorer la fonction rénale.
Pourquoi je décide
de dilater une artère
rénale sténosée ?
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, les insuf-
fisances cardiaques sévères et réfractaires associées à une insuf-
fisance rénale doivent effectivement faire penser à une sténose
serrée bilatérale des artères rénales, de même que des œdèmes
aigus du poumon (OAP) à répétition (OAP flash) : on en trouve
dans 7 à 10 % des cas. Le diagnostic n’est pas toujours évident, en
particulier dans un contexte de bas débit cardiaque où l’hyperten-
sion artérielle peut avoir disparu et l’échographie-Doppler être
mise en défaut. Lorsque la situation cardiaque paraît désespérée
et que le traitement médical maximal est en échec, il faut savoir
aller jusqu’à l’artériographie diagnostique, en utilisant une faible
quantité de produit de contraste iodé pour éviter ou limiter une
aggravation de l’insuffisance rénale. Mais le risque majeur de
l’artériographie est en fait représenté par les embols de choles-
térol (compris entre 5 et 10 %) à partir des plaques d’athérome,
ulcérées de l’aorte, qui sont particulièrement à redouter chez les
patients sous anticoagulants. Il est souhaitable de les arrêter avant
la procédure tout en conservant les antiagrégants plaquettaires.
Doit-on encore réaliser en 2010 des tests
d’imputabilité pour affirmer le caractère
hémodynamique de ces sténoses ?
Il n’existe aucun test sensible et spécifique – y compris scintigra-
phique – qui permette d’imputer une insuffisance rénale, une HTA
ou une insuffisance cardiaque réfractaire à une sténose athéro-
scléreuse des artères rénales. Pour conclure, je voudrais faire
2 dernières remarques : l’aggravation d’une insuffisance rénale
sous IEC ou sartan est loin d’être toujours en rapport avec une
sténose des artères rénales. Elle est le plus souvent la conséquence
d’une déplétion hydrosodée trop poussée et d’un mauvais équilibre
entre vasodilatateurs et diurétiques. Les sténoses des artères
rénales ne doivent pas constituer, malgré les questions d’internat,
une contre-indication à l’emploi, certes prudent et étroitement
surveillé, des IEC et des sartans. Ces classes thérapeutiques amélio-
rent le pronostic vital et même rénal des patients souffrant de
sténose athéroscléreuse des artères rénales qui sont tous à très
haut risque cardiovasculaire. Une angioplastie pourra toujours
être effectuée en cas de dégradation menaçante de la fonction
rénale. Le cœur doit primer sur le rein : plus des trois quarts de
ces patients décèdent avant d’arriver au stade de l’épuration
extrarénale. ■
1
/
1
100%