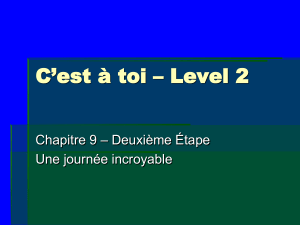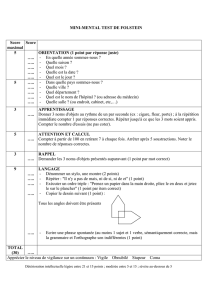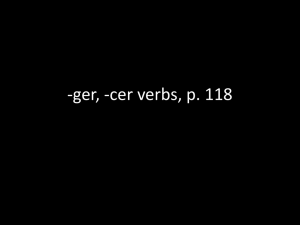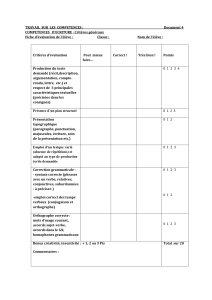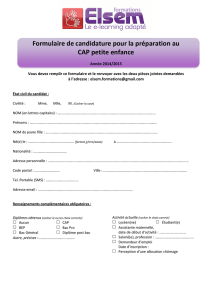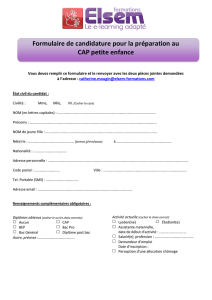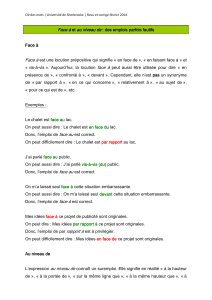télécharger cet article - l`Institut d`Histoire sociale

L
’AMÉRIQUE LATINE EST ENCORE LARGEMENT DOMINÉE par l’idée que les
gouvernements de droite, ou dits tels, sont a priori et a posteriori illégitimes. Les
décennies de dictatures de droite qu’a connues ce continent expliquent en partie cette
idée, comme si l’opposition militaire et révolutionnaire, notamment les guérillas, avait
résumé à elle seule le refus de ces dictatures, et comme si elle avait en quelque sorte diffusé
sa légitimité à l’ensemble des mouvements et partis de gauche, même réformistes, parta-
geant ses valeurs: dénonciation des oligarchies, de l’impérialisme américain, indulgence
envers l’idée révolutionnaire. Comme si aussi la détestation bien compréhensible suscitée
par les dictatures de droite pouvait presque sans réserve s’appliquer à la droite tout entière,
fut-elle modérée et hostile à toute dictature.
On ne s’étonnera pas dans ces conditions que, lorsque la gauche tente de se maintenir
au pouvoir de façon illégitime, les protestations soient maigres. Ainsi, Daniel Ortega, au
Nicaragua, pour se représenter aux élections, a fait interpréter la Constitution en sa faveur
par une Cour suprême tout acquise. Hugo Chávez, au Venezuela, est bien parti pour garder
le pouvoir indéfiniment si la maladie ne l’en empêche pas.
En revanche, lorsque le Colombien Álvaro Uribe laissa s’engager une procédure de
réforme constitutionnelle en vue de sa réélection en 2010, des voix de tous bords se sont
élevées (à raison nous semble-t-il) pour s’indigner de la tentation autoritaire dont ce geste
témoignait.
Depuis la vague démocratique qui a touché l’Amérique latine dans les années quatre-
vingt puis quatre-vingt-dix, l’opinion publique et le paysage intellectuel ont changé. Mais il
reste un certain nombre de propagandistes de la foi révolutionnaire, cachés ou clairement
désignés, dans les universités (surtout publiques) ou dans tel ou tel «collectif d’avocats» ou
de défense des droits de l’homme. Sans doute faut-il nettement distinguer ces «dino-
saures», défenseurs d’une idéologie dont les traces peuvent se trouver dans nombre d’arti-
LE « POLITIQUEMENT CORRECT »
Méandres du «politiquement correct»
en Amérique latine
par Stephen Launay*
DOSSIER
N° 46
53
*
Politiste, auteur, notamment, de Chávez-Uribe. Deux voies pour l’Amérique latine?, Paris, Buchet-Chastel, 2010.

cles, de l’ensemble de la population, qui ne
nourrit plus aucune dilection pour les
mouvements d’extrême gauche. Ceci est
visible lors des élections, qui sont dans la plupart des pays gagnées par des candidats
modérés, de droite ou de gauche.
Quelques signes: désormais, lorsque la question «Citez quelques dictatures de votre
région» est posée à l’université, Cuba est citée. Quant aux États-Unis, ils ne sont plus vitu-
pérés comme avant car perçus par les étudiants comme un pays qui offre des possibilités
professionnelles (avec le Canada).
La population latino-américaine a dans l’ensemble rejeté l’idéologie et les méthodes des
groupes d’extrême gauche. Mais toutes les leçons n’ont pas été tirées de l’échec de la lutte
armée «de gauche» en Bolivie (dans les années 1960), au Chili (dans les années 1970) et
ailleurs, ni du fait que la «dynamique politique» latino-américaine, surgie des urnes, fut
animée par des gens de centre gauche ou de centre droit. Comme s’il valait mieux avoir tort
avec le castrophile Garcia Márquez que raison avec le libéral Vargas Llosa.
Il reste donc dans l’opinion publique un certain nombre de clichés caractérisant le
«politiquement correct». Il est en général le fait d’une certaine gauche, mais il n’épargne
pas non plus la droite.
On peut en citer trois: la nécessité de la «participation» en système démocratique, celle
du «dialogue» envers et contre tout et enfin la défense de l’indigénisme.
HISTOIRE &LIBERTÉ
54
OCTOBRE 2011
Alvaro Uribe
© Neil Palmer (CIAT)
Mario Vargas Llosa
© Pontificia Univ. Católica de Chile

Le premier, qui découle de la démocratisation, concerne le thème de la participation.
Voilà une notion qui se retrouve dans toutes les démocraties, avec toutefois une intensité et
une «philosophie» sous-jacente différente selon les cas. Mais dans le cas latino-américain, la
«participation», qui invite les travailleurs ou les citoyens à débattre de sujets considérés
comme importants pour l’entité sociale ou économique, ou pour l’ensemble de la société,
est bien souvent confondue avec sa lointaine parente, la «démocratie participative», qui vise
l’utopie d’une implication directe dans les prises de décision, voire, chez les plus imprégnés
d’effusions collectives sentimentales (et para- ou post-marxistes), avec la «démocratie
directe». Cet attrait découle de la critique marxiste et léniniste classique faite à la démo-
cratie bourgeoise, qui ne permet l’expression de la volonté populaire qu’une fois tous les
trois, quatre ou cinq ans… Voir les «indignés» de la Puerta del Sol cette année… Cette
confusion explique l’acceptation par beaucoup de régimes tyranniques ou tendanciellement
dictatoriaux, perçus comme des «démocraties participatives» et donc justifiés.
Deuxième cliché «politiquement correct»: le «dialogue». Celui-ci est cousin de notre
consensus mais est apparu bien avant dans les discours politiques latino-américains. C’est
donc un point de passage obligé pour tout homme politique. Uribe lui-même, quand il est
arrivé au pouvoir en Colombie, en 2002, élu sur un programme de fermeté à l’égard des
guérillas, faisait référence dans son discours à une ouverture (conditionnelle): «mano firme,
corazón grande» était sa devise (« main ferme, grand cœur») et il a eu, à plusieurs reprises,
MÉANDRES DU « POLITIQUEMENT CORRECT » EN AMÉRIQUE LATINE
N° 46
55
Hugo Chávez
© Victor Soares - ABr

des gestes en faveur de discussions.
Dans l’ensemble de l’Amé rique
latine, le «dialogue» est une obses-
sion. La multiplication des organi-
sations régionales en est un signe,
justifiée avant tout par la nécessité
du rapprochement entre «frères»
(hermanos) latino-américains. La
dernière en date de ces créations
est celle de l’Unasur (Union des
nations sud-américaines) en 2008,
sous l’égide du Brésil. Il faut dire
que le Brésil a développé, depuis
plus d’un siècle, une tradition de
diplomatie «douce» qui va dans ce
sens. L’argumentaire même de
l’érection de cette organisation
souligne la nécessité du règlement
pacifique de tout différent, en un
continent où, malgré la prédomi-
nance de la gauche (surtout en
2008), les frictions, pour le moins,
ont été nombreuses.
Le comble a été atteint depuis l’annonce de la maladie de Hugo Chávez. Que ce soit en
Colombie ou au Venezuela, les souhaits de bon et prompt rétablissement se sont multipliés,
que ce soit chez les caciques de la politique ou chez les lecteurs des journaux d’opposition, ou
anti-chavistes en Colombie. Le président colombien lui-même a déclaré que le président
vénézuélien était un facteur de stabilité, aussi bien à l’intérieur de son pays que dans la région
sud-américaine. Pourquoi cette amabilité alors que tout le monde sait que la disparition de
Chávez ne serait pas un mal pour la Colombie, même si elle risque de déclencher une guerre
civile au Venezuela même ?
Quant à la nécessité du «dialogue» avec les guérillas, en Colombie tout particulière-
ment, il s’agit d’un cliché récurrent jusqu’au début des années deux mille, et reste l’antienne
de certains milieux idéologiquement proches du marxisme. Cette idée semble avoir vécu
car l’histoire récente a bien montré que les Farc refusaient ce dialogue (le cas de l’ELN est un
peu différent), puisque leur projet (totalitaire) n’est pas négociable et que nombre de fronts,
si ce n’est l’organisation dans son ensemble, profitent de la manne du narco-trafic et ne
voudront jamais y renoncer. Toutefois, le «dialogue» reste présent dans le discours de
HISTOIRE &LIBERTÉ
56
OCTOBRE 2011
Le président bolivien Evo Morales
© Marcello Casal Jr./ABr

nombreux politiques et universitaires ingénus ou imprégnés de marxisme-léninisme, et qui
– « politiquement correct oblige » – ne se sentent pas en droit de transgresser le tabou inter-
disant le combat manu militari contre une organisation révolutionnaire.
Ce type d’ingénus est surnommé par trois auteurs latino-américains (un Colombien,
Plinio Apuleyo Mendoza, un Cubain en exil, Carlos Alberto Montaner et un Péruvien,
Álvaro Vargas Llosa) «l’idiot latino-américain», appellation faisant évidemment référence
aux «idiots utiles» de Lénine et au fait qu’il s’agit de l’idéal-type de l’intellectuel au sens
sociologique, ou du semi-habile comme disait Voltaire, qui ne voit pas qu’il fait un usage
faux de son intelligence. Les deux ouvrages qu’ils ont publiés rassemblent une bonne partie
du «politiquement correct» latino-américain[1].
Dans leur dernier ouvrage, El regreso del idiota[2], ils examinent un troisième cliché, celui
de l’indigénisme. Dans un chapitre intitulé «Indigènes ou déguisés?» les auteurs analysent
la résurrection de l’indigénisme, qu’ils ne confondent pas avec l’attention légitime portée au
passé pré-colombien. «Nous nous référons, écrivent-ils, à l’escroquerie idéologique par
MÉANDRES DU « POLITIQUEMENT CORRECT » EN AMÉRIQUE LATINE
1. Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, Manual del perfecto idiota latinoameri-
cano, Plaza & Janés, Barcelona, 1996; puis, des mêmes: El regreso del idiota (Le retour de l’idiot) Random House
Mondadori, Debate, Bogotá, 2007.
2. El regreso del idiota, op. cit.
N° 46
57
DOSSIER
Gabriel García Márquez et la ministre colombienne de la Culture Paula Moreno
au gala inaugural du Festival international du Cinéma à Gudalajara le 19 mars 2009.
© Festival Internacional de Cine en Guadalajara
 6
6
 7
7
1
/
7
100%