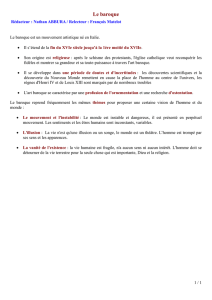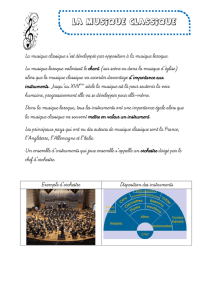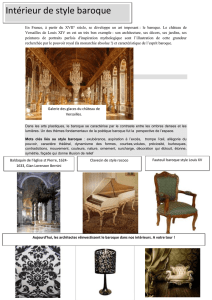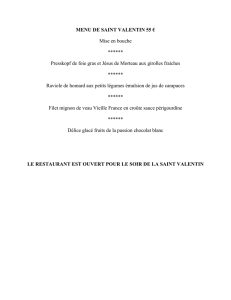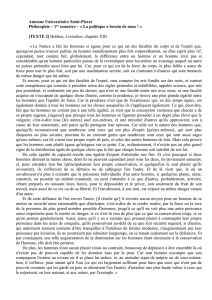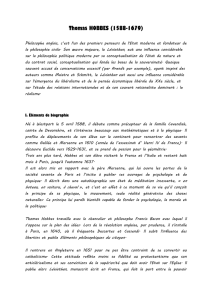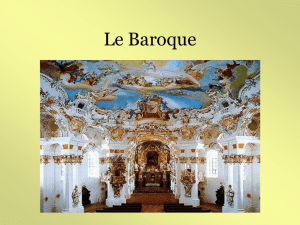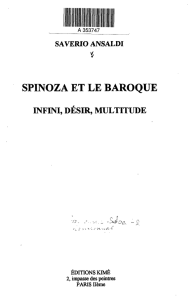Weltanschauung : qu`est-ce qu`un tableau

Le Bulletin Freudien n°23-24
Décembre 1994
Weltanschauung : qu’est-ce qu’un tableau ?
!
! !" ## $ $%
&'( )$ ! ! $ *$
* + $ *$,*"* $ $
$*!! *$-$ !
!!!*'!.
! /0$
**( $#*#% $# $ *$ ! $
*. ** ! ! $ 1!-
2 ! $# $ *$( !
!11 !11 ! (
*,* !" 2 ## !-
, #3 !# ! )
!$#'*$##'($4(
$*$!2*$5%
!!*
#.#!!!)
+ ** $(
!!*+2*(
**2##*(6**
$!!(+2*(2$
2$*.

7 !( ! * $* 8
+12$*$*$$*
!9%(:(!!9(!
$ ##* $+ ;
*$ #( *"* 5! **(
$#*# ! + $* !9
!;!
<(!112(**$(
**$$#%)$1+*
$!!+$(855(*)!$
$ *- ! !! ) !
!$$*!$!*$.)$
+*!!!)!!+*
$ !! $ 2 ) 2( 2 +
.
!$( * *$ 2
,! !11 !!, !
#*$##.#(2
+1$+$)!!$$#($
$ ; , #
) *-( ! 5*!( +
=#+ ;> $ !1 #+
$ ? ,( $ + $
*$( *"* ( !# $
* 8 ; ! $ * $
##!!!)#.@5*!%*$'
! ! !! 5 3 =* ;$ !
!! ) 5 ;$# =*(
$ *$3 ) #! *# 8 #+ 2
!! A( # ! !! ( 2 +
1$+!!$3BCD(
*$( # #+$** ( *$ !!
$ ) + # D3 )
) =1*$ ( *$ $# ! ##
! ;* !!( ( )
$#.E$##$#
$*-$!.
FG 2( * $% !!*(
'**>$ .
5!H < ! $ $# $ .
! $ BDCC -. D +I 2 *#
#( + * -'( + J $ *#

( ) ' . D ! 5*!( $5 !
*'4 $ @ $ -+.
(*$3!$$$$
!#1;.!
"
#
)$ *$(
! $ !#( ** '
*3 ', #1*' ' (
,$ '#(
$(!'#($#(#'$#)
$*$(#315(
$ $ !( ; 4' ! $
!# !#( $ +
# !!* *!).
* $ *' ; ! !#.
BCD # !# !#
*"*$$*$.
<(#$',+*
$I( ( * !!
$),(A(#+ (!$
"**$.$ $1K##*
#+($5*$3$
$'($L'+#
,)$ * + '#*#
$+ ;* '#*#, $#' (
**$(**#.E+
$ + + M$ ' ( )
J$*#($5!#.
<(!5$ %1(
$ 5!#* ; $ !#
#* * $ ! $ !#. <
* $# $ *$ * $
N$#$!#($*-.
+
75-* ##* $ #O5, $
! *( 2 + +,( + *(
2$!)3$(*(
##*$-#$P*!;
1Scilicet, nº 1, pp. 31 et 32.

$*.=*($*$(#!#
$+*($$#$!).
$!$+!$5$Q#
4*% )$ **# + $+# )
4 $ '* $ $. < ( !(
( $ 2 $ '( $ !
!! 5 ; !!P
!!'.
7 *-( + I ! $5 5*!
$55*!!*$(*$(
! *'( $( * $(
$*#!+.*$
+ 8 ! #'#(
+ $ $ $* *
2, ' - $*,( *
2$#.
* 2 $ *# *#
$!*7'($$7'3
2*$%!!!$BCB$#
$$?1$(!*$
(!-(!'$$#+#
***+()$#!-(
2+#(5*$!-,(2(
)K*,* $$ !$
#)!;!(!+(!$(!
$:# ! $ ( ; $ ;
!( ** !+ ! ) (
! ;% $# $ ( *'#
$#$!;(*'# ();
!$$*##*$!.J(
)+*$#!R.
' ,2 + ! ! $ A
! ' $ * A ! $ # $
'!-*,(*$#)"
**$3 ! ) S**$( ) "
* * $ ( ) $ $ # * . * *
!#,$*( J + ! $
$*$-#)$*$%
7 +# *$,( ** !#
$( ( $ **
! L* ) ;. )$ *$(
,)$ !( +#( $#,
**$I**31)#!(
BDCC( O $ # #'!.

( *"* * +
'#*#.' 2((#$#
$ # ! ( + I( $+$
'#*# 8 $+# $ ;* ## $#
$ * $ +. 7 *"*( $ (
! *1 $# # $
( # $ ! $ '( # +(
# $ $ 8 !5 ! . 7:# +
! 8 ** , !
$ $ ! $ # I
A, ! !! ) $' 5#3
*(++I(!$!$
$ = 1*# 5 $ # *'4
; $ *! !9 ' $
#'E7*.
5A$#)#);
** ! $ + ! !! ) # $
.@A(#.'+3%
& ' (
( ( ) *
'
(
+"
$ $ $ $ A.
=*I $ $ !( $ #( )
! $ $( T)$ $ +
** * ! ! ! # $
'( ) ! ** $ *( #+(
$#$(*(*
$$+!$#(!$(I
A(+");!!
; $ ** ! $##'
+# ) . *$ # ! $!(
(*=!#+$5
#.
!5**!*#$)$*
1 ) I A ( (
#!$*$**
2Voir les livres de Jean ROUSSET sur la littérature baroque.
3Je cite une thèse de A-L. ANGOULVENT, Hobbes ou la crise de l’État baroque, Paris, PUF, 1992.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%