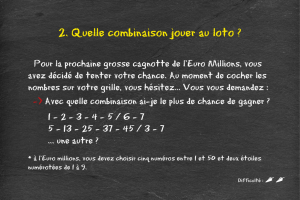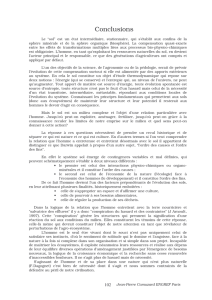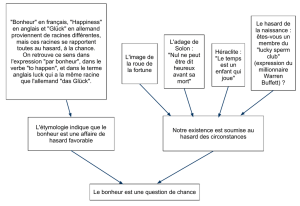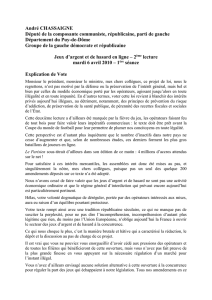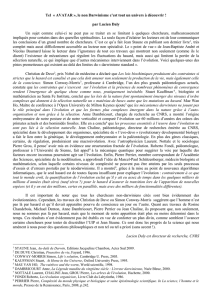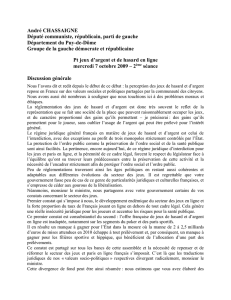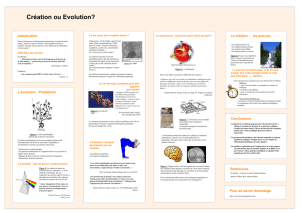LIRE - UNamur

Discours inaugural prononcé à l’occasion du
Congrès des sciences tenu à Gembloux en août
Évolution
C D
En acceptant de prendre la parole à votre congrès, malgré des contraintes
professionnelles et familiales particulièrement lourdes, cette semaine, j’ai vou-
lu souligner l’importance que j’accorde à la mission que vous remplissez. En
eet, dans notre monde moderne, l’enseignement de la biologie joue un rôle
capital.
Rôle d’information, d’abord. Par le canal des mouvements écologiques, la
biologie a pris pied dans la politique. Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité – et c’est très bien – on se préoccupe des eets nocifs que l’activité
humaine exerce sur la nature. C’est très bien, pour autant que le public soit
correctement informé et ne soit pas manipulé par des groupes de pression et
des mouvements politiques plus soucieux d’électoralisme que de rigueur
scientique.
Mission de formation, également. L’humanité vient d’entrer dans l’êre de
la biotechnologie, appelée à révolutionner de vastes secteurs de l’activité éco-
nomique et industrielle. Dans bien des domaines, les biologistes vont rempla-
cer les ingénieurs et les chimistes. Pour cela, il faut les former.
Mission d’éducation, enn. Les progrès de la biologie nous mènent à
réexaminer la place de l’homme dans l’univers, dans le contexte de son ori-
gine, de son évolution et de son avenir. L’honnête homme de cette n du e
siècle ne peut pas ignorer cet apport fondamental. Il doit pouvoir aussi juger
Revue des Questions Scientiques, , () : -

d’une manière critique les thèses philosophiques, parfois contradictoires, que
la biologie moderne a engendrées.
Si donc je m’associe de tout cœur à vos débats et à vos préoccupations, je
n’en reste pas moins embarrassé par le choix d’un thème susceptible de
s’inscrire dans le cadre général que vous vous êtes donné. En eet, si je devais
caractériser son évolution personnelle, je serais tenté de dire: Du DNA à
Darwin et au-delà, plutôt que le contraire. Dans mon œuvre scientique, en
eet, j’appartiens indiscutablement au camp dit réductionniste. Devant la
complexité de la cellule vivante, je me suis toujours eorcé de suivre le second
précepte de Descartes « de diviser chacune des dicultés que j’examinerais en
autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre »,
suivant en cela les recommandations du fondateur, trop souvent ignoré, de
l’expérimentation biologique moderne, Claude Bernard, qui écrivait en :
« Pour arriver à résoudre ces divers problèmes, il faut en quelque sorte décomposer
successivement l’organisme, comme on démonte une machine pour en connaître et
en étudier tous les rouages. » « Il faut donc », conclut-il, « recourir à une étude
analytique successive des phénomènes de la vie. »
Cela étant, je m’empresse d’ajouter que le réductionnisme est une mé-
thode, non une théorie philosophique. Réduire un problème à une dimension
accessible pour l’étudier n’est pas l’équivalent d’en sous-estimer l’ampleur. Ici
encore, je ne puis mieux faire que de citer à nouveau Claude Bernard: « Il faut
donc bien savoir », écrit-il, « que, si l’on décompose l’organisme vivant en isolant
ses diverses parties, ce nest que pour la facilité de l’analyse expérimentale, et non
point pour les concevoir séparément ». Et il ajoute ; « Il faudra donc toujours, après
avoir pratiqué l’analyse des phénomènes, refaire la synthèse physiologique, an de
voir l’action réunie de toutes les parties que l’on avait isolées. » C’est clair.
Dans un sens, je soupçonne que Charles Darwin lui-même ne désavoue-
rait pas l’appellation de réductionniste. De son voyage sur le Beagle il a ra-
mené nombre d’études minutieuses et essentiellement ponctuelles. Et ce n’est
qu’en , ans après son retour, qu’il publie sa grande synthèse. Je ne
doute pas qu’il eût été en même temps émerveillé et profondément satisfait
par les découvertes de la biologie cellulaire et moléculaire moderne. Celles-ci
sont autant de triomphes de la démarche analytique, ce qui ne les empêche
pas de déboucher sur une synthèse encore plus grandiose que celle de Darwin.
Cette synthèse est encore en pleine élaboration. À côté de certaines données
que j’oserais qualier de certitudes, malgré le danger d’utiliser ce mot en

science, il en est d’autres qui donnent lieu à de vives controverses, même entre
experts. Avec votre permission, j’aimerais essayer de dégager quelques aspects
de cette nouvelle tentative de synthèse, telle que je la vois du bout de ma lor-
gnette réductionniste.
�
Il y a d’abord, parmi les certitudes, le fait de l’évolution, déjà solidement
établi par Darwin et ses successeurs sur la base d’observations essentiellement
morphologiques, et que l’on a maintenant reconnu dans la trame moléculaire
de la vie, inscrit en un langage que seuls les ignorants et les malhonnêtes peu-
vent encore récuser. Vous connaissez les faits. Lorsque l’on compare les sé-
quences d’acides aminés de protéines homologues appartenant à diérentes
espèces, on trouve que le nombre de diérences , c’est-à-dire de substitutions
d’un acide aminé par un autre, ou éventuellement d’additions ou de délétions
d’acides aminés, est d’autant plus élevé que les espèces comparées sont plus
éloignées évolutivement de leur ancêtre commun, en d’autres termes, que le
temps durant lequel les protéines homologues ont pu évoluer séparément est
plus long. Ainsi, pour le cytochrome c, l’homme dière du macaque par un
seul acide aminé, du chien par , du thon par , du froment par et de la
levure par . Même dans ce dernier cas, il reste plus de acides aminés in-
changés, preuve évidente de la parenté des deux molécules.
À l’aide de ce genre de données, on peut construire des arbres phylogéné-
tiques. La méthode est loin d’être simple et laisse de nombreuses incertitudes.
On est étonné, néanmoins, des concordances remarquables entre les résultats
qu’elle a fournis et ceux de la paléontologie. On trouve certaines divergences,
c’est exact. Mais celles-ci ne sont pas toujours à mettre au passif de la méthode
moléculaire; et elles s’eacent ou s’expliquent au fur et à mesure que le nombre
de comparaisons eectuées augmente.Aujourd’hui, on a déjà appliqué cette
méthode à de nombreuses protéines et on l’a étendue aux séquences de nu-
cléotides dans des RNA et dans des gênes. Éventuellement, grâce à l’aide
d’ordinateurs, on devrait aboutir à la reconstitution historique détaillée et
univoque de la liation des êtres vivants, au dépens de l’empreinte qu’elle a
laissée dans leur structure moléculaire.
On n’est pas encore là, encore que certaines révisions importantes de nos
notions aient déjà été introduites ou proposées. On songe, notamment, au
chercheur américain Carl Woese, qui le conduisent à postuler une séparation

très précoce d’une forme vivante ancestrale primitive, qu’il appelle progénote,
en trois branches: les eubactéries, d’où seraient issues la plupart des bactéries
actuelles, les « urkaryotes », précurseurs des eucaryotes végétaux et animaux, et
enn les archébactéries, dont quelques formes bactériennes spécialisées, telles
que méthanogènes, halophiles ou thermoacidophiles, seraient des descen-
dants.
Mais ce sont là des détails – certains très importants, c’est entendu –
dans la structure de l’arbre évolutif. La réalité de cet arbre est, elle, indéniable.
L’évolution n’est plus une hypothèse, encore moins une doctrine. C’est un
fait. L’alternative dite « créationniste » que certaines sectes fondamentalistes
américaines veulent lui imposer est une insulte au Créateur qu’elles croient
honorer, en en faisant un être facétieux, sinon malicieusement irresponsable,
qui aurait trué son œuvre de fausses pistes moléculaires, dans le seul but,
apparemment, de confondre ceux qui tenteraient de la comprendre.
Heureusement, les créationnistes ne sévissent pas dans notre pays et vous
n’avez pas à vous en préoccuper. Sur le plan de l’enseignement, on peut – je
dirais plutôt, on doit – présenter l’évolution des êtres vivants et l’origine
d’êtres plus complexes, y compris l’homme, à partir de formes ancestrales
plus simples, comme des faits acquis. Point n’est besoin de tergiverser ou de
prendre des précautions oratoires par souci exagéré d’objectivité.
�
Un deuxième point à propos duquel la biologie moderne est quasi for-
melle concerne le mécanisme de l’évolution. Quiconque connaît le rôle de la
trilogie DNA-RNA-Protéines dans la transmission des caractères héréditaires
est pratiquement forcé de souscrire à l’armation de Jacques Monod lorsqu’il
écrit: « Le hasard est seul à la source de toute nouveauté, de toute création, dans
la biosphère. » Armation qu’il renforce d’ailleurs, dans un style étonnam-
ment catégorique pour un scientique, en ajoutant: « Cette notion centrale de
la biologie moderne n’est pas aujourd’ hui une hypothèse, parmi d’autres possibles
ou au moins convenables. Elle est la seule concevable, comme seule compatible
avec les faits d’observation et d’expérience. »
On voudrait pouvoir protester contre une déclaration aussi arrogante.
Mais quelle alternative y-a-t-il, du moins dans le cadre du déterminisme scien-
tique? Pour ma part, je n’en vois pas. La chaîne de causalité qui relie le

message génétique à son expression est telle qu’une perturbation extérieure ne
peut en aucune manière induire une modication adaptative du contenu du
message, autrement, comme le dit si bien François Jacob, « qu’à travers le long
détour d’une boucle de rétroaction qui ajuste la qualitédu message par la quan-
tité de la descendance. » Ce détour est celui de la sélection naturelle, qui re-
tient, parmi toutes les modications accidentelles que subit le programme
génétique, celles qui confèrent un certain avantage reproducteur à l’individu
aecté et à sa progéniture.
�
Cependant, en présentant ce point, j’ai dit que la biologie moderne est
quasi formelle à son propos. Je n’ai pas dit « formelle ». La raison en est que
nous ne savons pas aujourd’hui quel est le rôle dans l’évolution, s’il en est un,
d’une forme d’hérédité qui pourrait ne pas être transmise par le DNA (ou
éventuellement par le RNA) et qui dès lors pourrait avoir une composante
Lamarckienne. Je songe ici, notamment, au rôle que pourraient jouer cer-
taines stuctures en tant que « patrons » de leur propre reproduction. Le mode
d’implantation des cils à la surface de certaines paramécies en est un exemple
classique, clairement étudié par Tracy Sonneborn. La structure des cytomem-
branes en est un autre, du moins possible. On doit remarquer, en eet, que les
membranes biologiques, à l’encontre de beaucoup d’autres structures, ne nais-
sent jamais de novo, par auto-assemblage. Elles se forment par addition à des
membranes préexistantes, dont la structure pourrait dès lors inuencer la sé-
lection des matériaux et la manière dont ils sont assemblés. Tout cela à l’inté-
rieur d’un déterminisme strictement Mendélien, bien entendu, mais qui
pourrait laisser latitude à diverses variantes adaptatives transmissibles par un
mécanisme non-Mendélien.
�
Un problème plus important est celui de l’évolution culturelle, objet au-
jourd’hui de violentes polémiques, souvent plus idéologiques que scienti-
ques, suscitées notamment par la sociobiologie d’ Edward Wilson. C’est un
thème très important, mais beaucoup trop délicat et complexe pour pouvoir
être traité au cours d’un bref exposé
�
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%