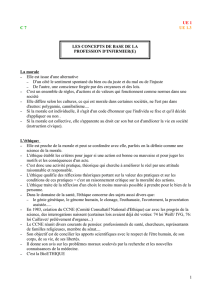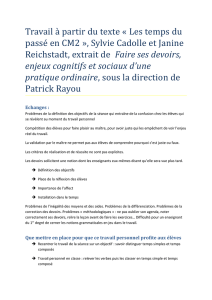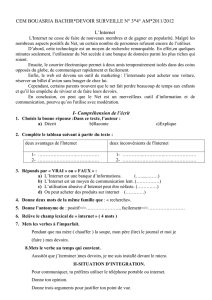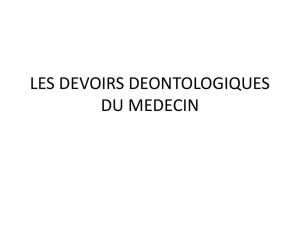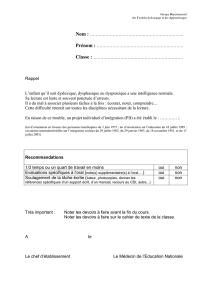Préface de Edwige Rude-Antoine

Préface
Les thèses de doctorat sur la notion de devoir en droit de la famille
sont rares, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un essai d’une théorisation
éthique dans ce domaine qui renvoie à la recherche du «bon comportement»
de la famille et à l’idée de responsabilité plutôt qu’à l’idée de valeurs transcen-
dantales.
En se lançant dans une recherche de longue haleine, aux croisements
de plusieurs champs disciplinaires, le droit et l’éthique, sur les devoirs juri-
diques dans le champ familial, Monsieur Richard Ouedraogo avait donc un
sérieux défi à relever et il l’a fait magistralement.
Dès l’introduction, Monsieur Richard Ouedraogo distingue très net-
tement les deux concepts «éthique» et «morale», comme le fait d’ailleurs la
plupart des auteurs s’intéressant aux questions morales. Il entend par morale
cet ordre normatif qui se rapporte à une pensée universelle, et dont l’objet est
de faire la part du bien et du mal, au moyen d’impératifs comportementaux
et d’interdictions. Il considère l’éthique comme cette manifestation souple
de la morale, qui recherche le «bon» comportement chez l’être humain et
discrédite, sans forcément condamner, le «mauvais» comportement chez le
sujet. En clair, l’éthique renvoie à l’idée de responsabilité, alors que la morale
désignerait un ensemble de valeurs transcendantales. Il précise qu’il a opté de
ne pas distinguer les deux concepts car, de toute évidence, cela n’aurait pas
vraiment eu des conséquences majeures dans l’analyse de la régulation des
comportements familiaux. Son positionnement assumé consiste à avoir une
vision unitaire des deux notions, voyant dans l’éthique la traduction contem-
poraine de la morale.
Monsieur Richard Ouedraogo définit la notion de devoir en droit
de la famille comme la norme comportementale d’ordre moral et social qui
s’impose à l’individu et circonscrit son domaine d’investigation aux devoirs
conjugaux, mais aussi aux devoirs de filiation et aux devoirs parentaux. Il
situe sa réflexion dans le cadre des mutations qui accompagnent l’institu-
tion familiale – dépérissement des règles juridiques du lignage au profit de
NODEFRA-tekst.indd 9 1/17/2014 3:45:09 PM

la notion de devoir en droit de la famille
10 BRUYLANT
l’alliance, contractualisation du mariage, fragilisation du couple, éclatement
des modes de vie en union, crise de l’autorité, désinstitutionnalisation de la
famille, passage d’un ordre public matrimonial non négocié au triomphalisme
de la volonté individuelle, diminution de l’impérativité des normes, consécra-
tion des droits subjectifs, sacralisation des droits fondamentaux, crise des
valeurs.
Il présente ainsi un plan très clair. La première partie est consacrée àla
règle morale dans la pluralité juridique des liens de couple. Il examine les fon-
dements moraux des devoirs conjugaux ainsi que les ruptures morales dans
le pluralisme des modèles conjugaux. L’auteur met ainsi en évidence les bou-
leversements idéologiques qui ont conduit à la déconstruction de l’institution
matrimoniale découlant d’une part, de la fragilisation du couple et d’autre
part, de l’éclatement des modes de vie en union. Il porte une interrogation
sur la perte du caractère transcendant du mariage, sur le rôle de l’affection,
sur l’éthique du juge, sur le droit au bonheur, sur la contractualisation du
mariage.
Monsieur Richard Ouedraogo apporte un éclairage sur la complexité
conceptuelle et normative liée à l’évolution familiale. Cela est parfaitement
illustré par le débat sur l’admission d’une dimension extra-patrimoniale dans
le PACS ou contrat libre de tout engagement contraignant, notamment avec
l’extension par le juge de l’exigence de fidélité ou de loyauté d’ordre public.
Cela l’est aussi par le refus dans un premier temps de la juridisation de l’union
libre – définie comme une situation de fait – puis l’évolution, sous l’influence
des mouvements de contractualisation des rapports de concubinat amorcé en
jurisprudence visant à renforcer la stabilité juridique de l’épanouissement des
individus au sein d’une vie de couple, vers un droit moderne avec des normes
juridiques contraignantes pour les concubins.
Monsieur Richard Ouedraogo affirme que si les rapports juridiques des
époux ont été au fil des décennies progressivement équilibrés, il reste que le
devoir de fidélité et le libéralisme des mœurs s’ouvre à un conflit notionnel.
Il se demande alors si le droit positif peut s’affranchir d’une certaine tutelle
de la morale familiale.
La seconde partie aborde la règle morale dans la régulation norma-
tive du rapport d’autorité. Cette notion d’autorité parentale n’échappe pas
non plus à la mutation, sous des influences diverses, morales, philosophiques,
politiques et idéologiques. L’analyse des devoirs de filiation dans un premier
temps, puis des devoirs parentaux dans un second temps, révèle qu’ils font,
eux aussi, l’objet de multiples bouleversements, à la fois dans les mentalités et
dans le droit positif. Monsieur Richard Ouedraogo montre que l’enfant, dont
les droits ont été démesurément renforcés par le législateur contemporain,
n’a presque plus de devoirs envers ses père et mère, tandis que les ascendants
se voient affligés du respect de toutes les normes juridiques contraignantes
«reflétant l’ingérence normative de l’idéologie libertaire postmoderne dans
NODEFRA-tekst.indd 10 1/17/2014 3:45:09 PM

Préface
BRUYLANT 11
les relations familiales». Et il n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit d’une arti-
culation de nouveaux principes d’éthique familiale, quasiment dénués de la
rigidité normative du droit, et fondés précisément sur le respect de l’auto-
nomie de l’enfant, l’entraide intergénérationnelle, la solidarité et l’affection
mutuelle.
Les métamorphoses de la famille remettent par conséquent en cause la
notion d’autorité (ou c’est la notion d’autorité qui a remis en cause la struc-
ture de la famille). L’ensemble est subtil et nous entraine dans un monde où il
est question d’un équilibre entre l’excès d’amour qui étouffe et l’insuffisance
d’amour qui ignore et rejette - dans un monde où il est question d’un non-
droit des devoirs réciproques entre parents et enfants.
Monsieur Richard Ouedraogo dessine avec justesse une autorité paren-
tale bousculée en permanence, chahutée de ne plus savoir qui est l’enfant ou
le père ou la mère. Il importe d’ailleurs de relever des passages extrêmement
intéressants de la thèse relatifs à la quête de l’intérêt supérieur de l’enfant qui
s’ouvre à l’interrogation d’un devoir moral des parents.
Monsieur Richard Ouedraogo montre la difficulté pour le droit contem-
porain de penser la place de l’enfant «individu-autonome», dans le sens où
la notion de devoir filial se heurte au conservatisme du Code civil qui conçoit
l’idée de piété filiale comme un principe éthique perpétuant l’autorité natu-
relle des père et mère. Pour autant, l’articulation des règles du droit de la fi-
liation avec les considérations éthiques aboutit à un désengagement de l’idée
de contrainte dans les règles obligatoires de la filiation. Enfin en partant de
la définition de l’autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et en affirmant que l’autorité n’est
pas une puissance mais une protection, on constate que la notion de l’intérêt
de l’enfant vient brouiller les repères traditionnels de l’autorité parentale car
le juge en contrôlant les comportements parentaux s‘immisce de plus en plus
dans les attributs de l’autorité parentale.
Dans sa conclusion générale, il emprunte une phrase de Marie Hé-
lène Renault – que la famille d’aujourd’hui n’est plus celle du Code civil et
qu’elle change sous nos yeux beaucoup plus sous l’action des mœurs et de
l’économie que par l’effet des modifications législatives.
La thèse montre l’influence prégnante de la morale sur le devoir dans le
couple, dans la filiation et dans l’autorité parentale et la complexité concep-
tuelle et normative liée à l’évolution familiale. L’auteur propose au législateur
contemporain d’articuler l’ordre moral nouveau centré sur l’épanouissement
individuel, avec des sentiments moraux valorisant la liberté, l’égalité, l’en-
traide, la solidarité au sein du groupe familial pour garantir une juste régula-
tion de cette notion de devoir. On voit ici qu’il peut y avoir des reculs ou des
renforcements de l’impérativité normative des devoirs familiaux.
NODEFRA-tekst.indd 11 1/17/2014 3:45:09 PM

la notion de devoir en droit de la famille
12 BRUYLANT
La thèse fait une utilisation judicieuse de l’approche éthique comme outil
de compréhension des nouvelles valeurs qui accompagnent la famille dans
notre société contemporaine. Toutes les théories, qu’elles proviennent de la
doctrine chrétienne du mariage ou des courants du droit naturel n’appré-
hendent que partiellement la complexité juridique du droit de la famille mo-
derne. Le juriste est obligé de faire appel à la philosophie, voire à la sociologie
et même à l’anthropologie; Mais il s’agit là d’éclairer le débat juridique sur
le devenir du couple en essayant de rechercher ce que devrait être le «bon
comportement» à partir de méthodes rigoureuses. Pour autant, il n’est pas
possible dans cette analyse des devoirs familiaux d’aller vers une théorisation
éthique unique du fait que sur le plan des devoirs conjugaux, la conception
égalitaire prédomine et sur le plan des devoirs parentaux, il s’agit plutôt d’un
lien de protection de l’enfant qui repose sur une hiérarchie naturelle.
Les interrogations posées tout au long de la thèse ne sont sans doute
pas insolubles. Le propos de Monsieur Richard Ouedraogo n’était pas de leur
apporter des réponses toutes faites, mais de susciter la réflexion, notamment
qu’il n’est pas évident de réduire les transformations juridiques de la famille à
l’idée de déclin de la morale traditionnelle. Le lecteur admirera, nous l’espé-
rons, et quelles que soient ses opinions sur le fond du problème, la richesse de
ce travail qu’une analyse technique classique des règles juridiques n’aurait pu
à elle seule apporter.
Edwige R-A
Directrice de recherche au CNRS
NODEFRA-tekst.indd 12 1/17/2014 3:45:09 PM
1
/
4
100%