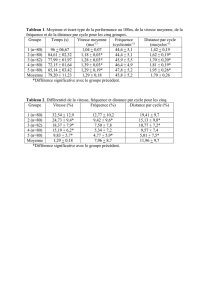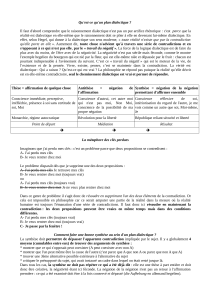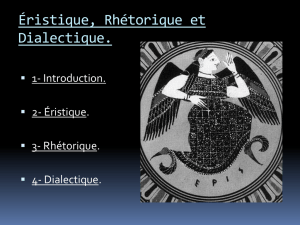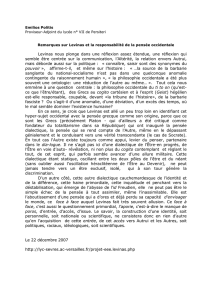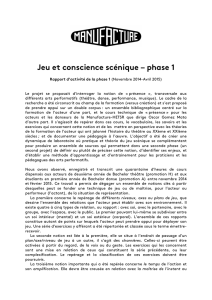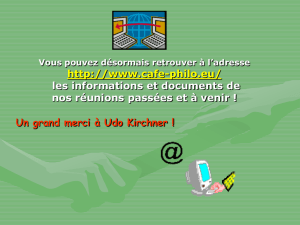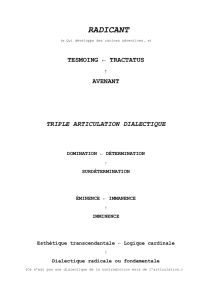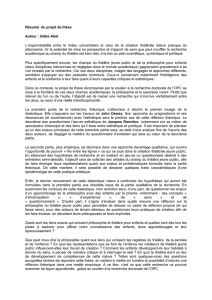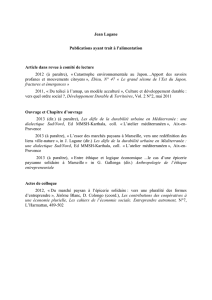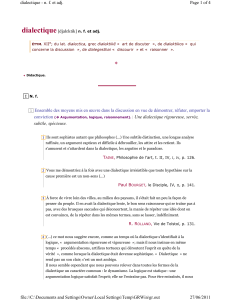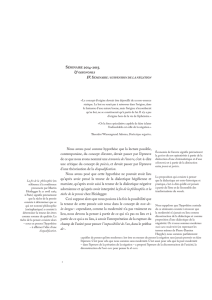avant-propos

avant-propos
Ce livre est le troisième volume de Dialectique et société
1
,
ouvrage qui veut traiter de manière systématique de la connaissance
de la société autant sur le plan épistémologique que théorique et
méthodologique. Son objet est le mode de constitution de la société
comprise en son unité, comme totalité, et il a été précédé par La
connaissance sociologique et Introduction à une théorie générale du
symbolique où le problème de la spécificité de la réalité sociale était
abordé au plus haut niveau de généralité comme problème de
l’action significative. Il sera suivi d’un quatrième volume consacré
à l’analyse typologique des formes historiques de la société. Le
cinquième abordera enfin la question de la méthode telle qu’elle
se pose dans la perspective de la connaissance compréhensive,
c’est-à-dire selon une approche phénoménologique, herméneutique
et interprétative 2. Le tout correspond à un plan d’ensemble qui a
déjà été réalisé partiellement dans une thèse de doctorat soutenue
en 1973. Comme Dialectique et société forme un tout et que la
publication de ses parties a dû être échelonnée sur plusieurs années,
1. Pour éviter les confusions, notamment en ce qui a trait à la numérotation
des volumes de Dialectique et société, nous avons fait les retouches nécessaires
pour tenir compte de la réédition augmentée du premier volume en deux
volumes. nde
2. Freitag prévoyait à l’origine encore un autre volume, La perte de la trans-
cendance. Ébauche d’une critique de la postmodernité, « consacré à une réflexion
critique sur les transformations structurelles en cours dans les sociétés contem-
poraines ». Dans la présentation de La connaissance sociologique, il souligne que
« ce volume a déjà été partiellement réalisé dans L’oubli de la société. Pour une
théorie critique de la postmodernité », paru en 2002. nde
Culture, pouvoir 042013.indd 9 13-04-11 09:15

Dialectique et société10
il paraît nécessaire de situer brièvement la place qu’occupe le présent
volume dans l’ensemble de l’ouvrage, et de montrer particulière-
ment comment il s’articule aux premiers volumes déjà parus.
1. L’objet de Dialectique et société est la connaissance de la
société. Mais la connaissance de la société est aussi déjà l’objet des
sciences sociales dont le concept, à moins de rester complètement
indéterminé, ne peut guère être défini autrement que par l’intention
d’appliquer à la connaissance de la société (et de tout ce qui se
trouve constitué en elle selon le mode de la socialité : les faits
sociaux, les rapports sociaux, les structures sociales, les problèmes
sociaux, les identités sociales, les représentations sociales, les déter-
minismes sociaux, l’imaginaire social, etc.), les préceptes épisté-
mologiques et méthodologiques qui caractérisent ce qu’on appelle
tout à fait généralement la démarche scientifique. Or cette position
prise par les sciences sociales pose un double problème. D’un côté,
la visée d’objectivité empirique et d’univocité significative carac-
téristique de la démarche scientifique comporte une précompré-
hension de la réalité objective comme réalité inanimée ou positive,
non signifiante en elle-même et par elle-même. Or, par contraste
avec un tel mode d’objectivité, la réalité sociale-historique est
précisément constituée entièrement par des pratiques significatives
ou plutôt signifiantes. D’autre part — et cela n’est qu’une consé-
quence —, les sciences sociales sont elles-mêmes incluses dans la
société et dans l’histoire, à titre de pratiques significatives particu-
lières qui se donnent la vocation d’être une modalité historique et
formelle privilégiée de connaissance de soi de la société. Cette
double condition existentielle de la réalité sociale et de sa connais
-
sance suffit donc à mettre fondamentalement en question les
modèles méthodologiques, épistémologiques et ontologiques impli-
qués par le projet d’une connaissance scientifique de la société, ou
impose à tout le moins que les sciences sociales redéfinissent le
concept de scientificité à leur propre compte, de manière à ce qu’il
ne désigne plus pour elles un mode de connaissance positive, mais
critique et réflexive. C’est alors en fonction d’une visée de connais-
sance critico-réflexive que l’exigence d’objectivité empirique pour-
rait être à nouveau assumée, mutatis mutandis. (C’est cette question
qui fera l’objet du cinquième volume.)
Sur la base d’un tel constat, le premier volume de Dialectique
et société a procédé à une critique du modèle positiviste et scientiste
de connaissance auquel les sciences sociales se sont généralement
rapportées explicitement ou implicitement pour fonder leur pré-
Culture, pouvoir 042013.indd 10 13-04-11 09:15

Avant-propos 11
tention à la scientificité. C’est à partir de cette critique que l’on a
été conduit dans le deuxième, logiquement, à mettre en évidence
les caractéristiques ontologiques de la pratique significative, catégorie
générale dont l’activité d’objectivation scientifique ne représente
finalement qu’une modalité formelle particulière. Conformément
à la dynamique heuristique inhérente à toute démarche dialectique,
la question épistémologique soulevée par l’autoréflexion critique
conduisait donc nécessairement à une interrogation portant sur
les caractéristiques ontologiques de son objet, la pratique cognitive,
et par ce biais sur celles qui appartiennent à toute activité signifi-
cative, en tant qu’elle est toujours orientée aussi par un principe
normatif qui détermine sa spécificité tout en garantissant son
effectivité de pratique réelle. La question portant sur les conditions
de la connaissance de la société s’est donc transformée, de l’inté-
rieur, en une question portant sur le mode d’être de la société
comprise comme une réalité comportant dans sa condition phé-
noménale essentielle l’autocompréhension de soi et l’objectivation
d’une altérité (celle du monde pour l’ensemble des sujets sociaux,
celle des autres sujets pour chaque sujet particulier, et celle des
formes de société différentes pour chaque société historique qui
se saisit elle-même selon une identité déterminée). Mais le point
de départ épistémologique limitait cependant la portée de cette
interrogation et le champ de description objective sur lequel elle
débouchait : il ne permettait de saisir le concept de pratique signi-
ficative que du point de vue de sa constitution formelle et générale
(voir à ce sujet, dans le volume 2, l’analyse qui est faite des niveaux
sensorimoteur, culturel-symbolique et formel du rapport d’objec-
tivation). Certes, ce mode d’opérativité formelle de l’activité com-
prise comme activité symbolique impliquait déjà, dans sa
constitution, l’intervention de l’intersubjectivité et de la référence
à autrui et, à travers ces termes, c’était déjà la société qui se trouvait
désignée comme a priori de l’existence de la pratique en tant que
telle, c’est-à-dire en tant que pratique significative. Mais cet a
priori, la société, n’y était encore saisi que comme un horizon que
l’analyse critique devait bien sûr postuler, mais dont elle n’avait
pas encore alors à problématiser directement le mode propre d’exis-
tence en tant que totalité réelle, concrète et déterminée.
Je résume maintenant brièvement le contenu du premier
volume de Dialectique et société. La connaissance sociologique tente
d’abord de faire le point sur le problème du rapport entre la théorie
et la pratique, et donc sur celui du rapport entre les sciences de la
Culture, pouvoir 042013.indd 11 13-04-11 09:15

Dialectique et société12
nature et la connaissance de la société, en abordant la question de
manière historique. La première partie de l’ouvrage étudie d’une
part l’évolution du rapport entre les sciences sociales et le modèle
de scientificité établi par les sciences naturelles, et d’autre part le
rapport qu’elles ont toujours entretenu avec la société, en tant que
modalité d’autocompréhension « idéologique » de celle-ci. La
deuxième partie est ensuite consacrée à une critique systématique
de la problématique positive et de ses formulations épistémologi-
ques depuis le positivisme classique jusqu’à Thomas S. Kuhn, en
passant par le néopositivisme et le rationalisme critique de Karl
R. Popper. Le but de cette critique était d’établir la non-pertinence
du modèle positiviste, compris au sens le plus large, s’agissant du
projet de connaissance de la société, dès le moment qu’on admet
que la réalité sociale est fondamentalement constituée par des
pratiques significatives et qu’elle ne peut donc pas être adéquate-
ment décrite en pure extériorité. Cette deuxième partie permettait
donc déjà de dégager de manière formelle, quoique encore négative,
les caractères fondamentaux de l’objet social. Le deuxième volume,
Introduction à une théorie générale du symbolique, présentait ensuite
une typologie des modalités du rapport d’objet, à savoir une des-
cription différentielle de ses modalités sensorimotrice, culturelle-
symbolique et formelle. La deuxième partie de l’ouvrage, de loin
la plus longue et la plus élaborée, était consacrée à l’analyse struc-
turelle-fonctionnelle du rapport d’objet en général, dans laquelle
six moments épistémiques étaient définis. Cette typologie se pré-
sentait en même temps comme une épistémologie générale et
comme une théorie générale de la pratique significative, ou encore
une théorie générale du symbolique, conformément au titre choisi.
Son originalité était, d’une part, de fusionner une épistémologie
et une théorie de l’action, puisqu’elle intégrait la première dans
la seconde ; elle consistait d’autre part dans le fait qu’elle mettait
déjà en lumière, au niveau d’une analyse purement formelle de
l’objectivation significative (problème classique de l’épistémologie
entendue au sens large de théorie de la connaissance, et non au
sens étroit de théorie de la connaissance scientifique), les conditions
de structuration et de reproduction d’ensemble des pratiques
significatives particulières (problème fondamental d’une sociologie
générale, comprise dans la perspective d’une théorie de l’action
sociale et selon une approche compréhensive). Elle permettait du
même coup d’intégrer, comme on vient de le dire, une théorie de
l’action et une théorie de la structure (ou encore : Marx et Weber,
Culture, pouvoir 042013.indd 12 13-04-11 09:15

Avant-propos 13
pour simplifier), tout en dépassant l’opposition entre diachronie
et synchronie que les théorisations structuralistes formalistes ont
habituellement établie.
2. La théorisation entreprise dans Dialectique et société com-
prend la société comme procès d’autoreproduction en même
temps expressif et réflexif, et place donc les pratiques sociales
concrètes, à caractère subjectif et symbolique (« significatif »), au
fondement ontologique de toute réalité sociale-historique, et cela
inclut aussi les diverses modalités phénoménales de l’identité
subjective et de l’objectivité. Dans cette perspective, la société
peut alors être définie comme la structure d’ensemble des rapports
sociaux, c’est-à-dire des rapports entre les pratiques sociales, mais
pour autant précisément que cette structure soit impliquée dans
le procès de reproduction.
Cette conception implique d’emblée que l’on fasse intervenir
une distinction analytique entre le niveau des pratiques sociales
et le niveau de la société, et c’est sur cette distinction qu’est
construite l’articulation entre le deuxième volume de Dialectique
et société et les deux suivants consacrés à l’étude de la société et de
son historicité. Il s’agit là d’une distinction analytique, puisque
toutes les pratiques concrètes sont toujours déjà spécifiées et struc-
turées socialement ou sociétalement (que ce soit d’une manière
immanente par le biais de la référence symbolique qu’elles com-
portent toutes ou, d’une manière externe, par le biais des régulations
institutionnelles ou opérationnelles auxquelles elles sont soumises),
et puisque inversement l’ordre d’ensemble de la société ne se réalise
jamais qu’au travers des pratiques concrètes, particulières et sin-
gulières. Mais cette réciprocité dialectique ne supprime pas l’ex-
tériorité réelle de ces deux niveaux l’un par rapport à l’autre, ni
par conséquent les tensions qui peuvent se produire entre les deux :
le concept de « pratique » (ou d’action) se rapporte en premier lieu
à l’individu sensible et agissant qui est en même temps la personne
dotée de la capacité de représentation, de compréhension et d’ex-
pression symbolique. À ce niveau, le concept fondamental est donc
celui du rapport sujet-objet, du rapport significatif au monde, à
autrui et à soi-même, et c’est ce rapport qu’il s’agit de définir en
sa nature et d’analyser en sa structure. Tel a été, essentiellement,
l’objet du deuxième volume. Le concept de « société », de son côté,
se rapporte fondamentalement aux mécanismes qui assurent l’as-
sujettissement des pratiques significatives à un ordre d’ensemble,
et la reproduction ou la transformation de cet ordre ou de cette
Culture, pouvoir 042013.indd 13 13-04-11 09:15
1
/
5
100%
![La Dialectique pour Changer de Gestion.p[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/006693961_1-54d6c839807c0640c8e99a10ccf70169-300x300.png)