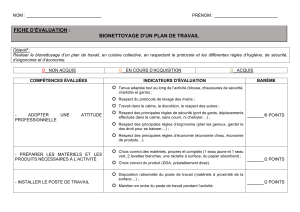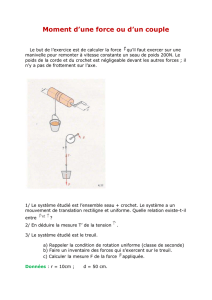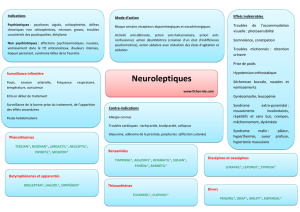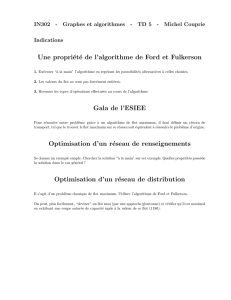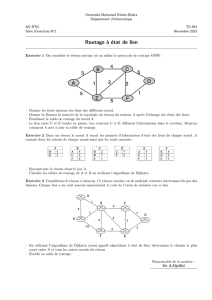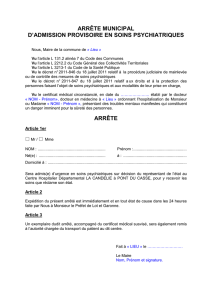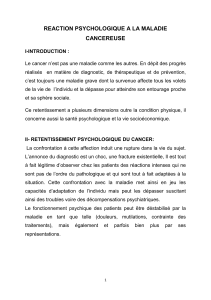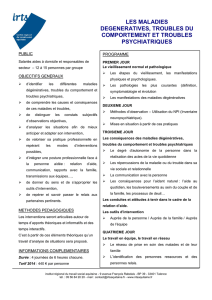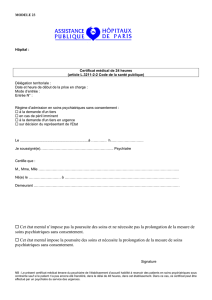Étude qualitative des attentes d`un réseau sanitaire et social pour

L’Enc´
ephale (2007) 33, 751—761
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
M´
EMOIRE ORIGINAL
´
Etude qualitative des attentes d’un r´
eseau sanitaire
et social pour suivi des troubles psychiatriques
s´
ev`
eres dans la communaut´
e夽
Qualitative study of a social and health network’s
expectations for community treatment of severe
mental health problems
C. Bonsack∗, M. Schaffter, P. Singy, Y. Charbon, A. Eggimann, P. Guex
D´
epartement universitaire de psychiatrie adulte (DP-CHUV), site de Cery, 1008 Prilly, Lausanne, Suisse
Rec¸u le 9 septembre 2005 ; accept´
e le 27 juin 2006
Disponible sur Internet le 4 Septembre 2007
MOTS CL´
ES
R´
eseau
sociosanitaire ;
Psychiatrie
communautaire ;
Organisation des
soins ;
D´
esinstitutionalisation
R´
esum´
eParlad
´
esinstitutionalisation, le r´
eseau sanitaire et social se trouve plus directement
confront´
e aux personnes souffrant de troubles psychiatriques s´
ev`
eres, tels que la schizophr´
enie
ou les troubles bipolaires. De nombreuses personnes sont impliqu´
ees, depuis les voisins et
les proches, jusqu’aux professionnels du secteur psychiatrique, en passant par le m´
edecin
g´
en´
eraliste ou la police. Les attentes contradictoires vis-`
a-vis des secteurs psychiatriques entre
soins, contrˆ
ole social et respect des libert´
es individuelles deviennent difficiles `
ag
´
erer sans une
meilleure coordination des services. Malgr´
e de nombreuses incitations de politique de sant´
e
dans plusieurs pays, la mise en place d’une collaboration de r´
eseau et son ´
evaluation restent
difficiles. En particulier, la phase initiale d’´
evaluation des probl`
emes et de n´
egociation des
objectifs du r´
eseau est souvent trop sommaire et nuit au bon d´
eveloppement ult´
erieur. Le but
de cette ´
etude est d’examiner par des m´
ethodes qualitatives les difficult´
es rencontr´
ees par
les acteurs d’un r´
eseau sociosanitaire dans le suivi des troubles psychiatriques dans la commu-
naut´
e avant la mise en place d’une collaboration de r´
eseau. Vingt-cinq entretiens approfondis
et six focus groupes ont ´
et´
er
´
ealis´
es aupr`
es de personnes impliqu´
ees dans le suivi de troubles
psychiatriques s´
ev`
eres dans le r´
eseau social et sanitaire (g´
en´
eralistes, psychiatres, infirmiers,
travailleurs sociaux, police, juge de paix, proches et repr´
esentants des patients). L’analyse de
contenu a permis de regrouper diff´
erents th`
emes selon un mod`
ele matriciel 3 ×3 distinguant le
niveau du probl`
eme identifi´
e (population, institution ou individu) et le domaine consid´
er´
e (les
valeurs, les processus et l’articulation avec l’environnement). Selon cette analyse, les comptes
夽Cette recherche a ´
et´
e financ´
ee par un fonds de l’association «R´
eseau de la communaut´
e sanitaire de la r´
egion lausannoise »(Arcos).
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : Charles.bonsack@chuv.ch (C. Bonsack).
0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2008.
doi:10.1016/j.encep.2006.06.001

752 C. Bonsack et al.
rendus dactylographi´
es des entretiens ont ´
et´
e segment´
es en 1479 propositions et group´
es en
52 th`
emes. Dix-sept probl`
emes cl´
es ont ´
et´
e identifi´
es au niveau individuel, de population, de
processus de soins et du r´
eseau et valid´
es par les focus groupes. La d´
esinstitutionalisation
est consid´
er´
ee comme un changement positif pour la plupart des acteurs du r´
eseau sociosa-
nitaire, mais implique une adaptation des pratiques de soins psychiatriques et une meilleure
consid´
eration des attentes du r´
eseau non psychiatrique. Selon les acteurs du r´
eseau, la den-
sit´
eetlasp
´
ecificit´
e des soins psychiatriques devraient ˆ
etre mieux pr´
ecis´
ees par une politique
de sant´
e mentale `
a l’intention des patients les plus vuln´
erables. Les efforts doivent ˆ
etre
diff´
erenci´
es selon les probl`
emes identifi´
es : une formation des professionnels de premier recours
pour les patients suicidaires et les doubles diagnostics, un soutien direct aux services d’aide
sociale pour les patients difficiles `
a engager dans les soins et une meilleure coordination des
services psychiatriques pour les hauts utilisateurs. L’identification de probl´
ematiques com-
munes entre les acteurs impliqu´
es constitue une premi`
ere ´
etape pour favoriser la collaboration
dans le r´
eseau. Le mod`
ele de secteur devrait ˆ
etre adapt´
e pour permettre le d´
eveloppement
d’´
equipes de suivi intensif dans le milieu (assertive outreach) et accentuer la liaison avec les
soins primaires, deux domaines consid´
er´
es comme des ´
el´
ements essentiels d’un dispositif de
collaboration en r´
eseau.
© L’Encéphale, Paris, 2008.
KEYWORDS
Delivery of health
care;
Community mental
health;
Community networks;
Community
psychiatry
Summary Treatment of severe mental illness in the community is gaining interest under
ethical, clinical and economical pressure, which has led to mental health reform and deins-
titutionalisation. However, this can lead to conflicts between all the parties involved in the
community. Several countries have initiated extensive efforts to coordinate health services
to enhance quality of care without increasing costs. According to Gray [Hum Relat 38 (1985)
911—936.], the first conditions facilitating interorganizational collaboration are the identifica-
tion of common problems, recognition of partners (legitimacy and expertise) and interest in
collaborating gains to be made from such collaboration [Int J Health Plann Manage 17(4) (2002)
315—32.].
Aims. — The aims of the study were to assess the representation of problems and needs from
people dealing with psychiatric patients in the community with a model of action research. The
action part of the study meant to influence collaboration and objective setting in the network.
The research part intended to identify the main problems experienced while dealing in the
community with people suffering from severe mental illness.
Methods. — In depth interviews were conducted with 25 persons involved in the community
network (GPs, psychiatrists, nurses, social workers, police, judge, relatives, and users). Five
open-ended questions on experienced problematic situations, network’s collaboration, and
expectations were asked. Content analysis of individual interviews was validated through dis-
cussion in six focus groups. Qualitative analysis used a 3 ×3 matrix model inspired from Parsons
[Social systems and the evolution of action theory. Free Press; 1977, 420 p.; Health Serv Manage
Res 11(1) (1998) 24—41 discussion 41—8.], and Tansella and Thornicroft [Psychol Med 28(3)
(1998) 503—508.].
Results. — One thousand four hundred and seventy-nine propositions were grouped in 52
themes. Seventeen key problems were identified at individual, population, care-process and
network levels, and were validated by the focus groups. Main problems were linked to a
change in values regarding the role of psychiatric patients—from paternalistic social control
to free empowered citizens—without adequate tools to deal with this in the community. Crisis
management, intensive home care, and network cooperation were considered as insufficient,
particularly for suicidal, dual diagnosis and difficult to engage patients.
Conclusion. — Deinstitutionalisation and more respect of patients’ rights were considered as
positive changes for most patients, but as a risk for the most vulnerable ones. Clearer mental
health policy targets were requested for suicidal, difficult to engage and dual diagnosis patients.
Collaborative efforts must focus on teaching primary care professionals for suicide and dual
diagnosis patients, on direct help to welfare services for difficult to engage patients and on
psychiatric services for high users. Intensive home care and liaison with primary care are viewed
as key components. Identifying common targets in the network may enhance collaboration.
Pathways to care need to be studied, including people involved outside a “classical” health
network, such as police, welfare services and patients or carers associations.
© L’Encéphale, Paris, 2008.

´
Etude qualitative pour suivi des troubles psychiatriques s´
ev`
eres 753
Introduction
Le mouvement de d´
esinstitutionalisation initi´
e dans les
ann´
ees 1960 par la cr´
eation des secteurs psychiatriques
s’acc´
el`
ere depuis une dizaine d’ann´
ees, renforc´
e par des
motifs ´
ethiques, cliniques et ´
economiques. Au niveau
´
ethique, les associations de patients et de proches et
l’´
evolution sociale ont favoris´
e un meilleur respect des
libert´
es individuelles et une appropriation du pouvoir par
les usagers au d´
epend du privil`
ege th´
erapeutique et du
contrˆ
ole social. La meilleure connaissance de leur ´
evolution
et de leur traitement, le d´
eveloppement des interventions
pr´
ecoces et de r´
ehabilitation ont am´
elior´
e le pronostic
et l’espoir d’int´
egration sociale de troubles psychiatriques
s´
ev`
eres tels que la schizophr´
enie ou les troubles bipolaires.
Enfin, la n´
ecessit´
e de contenir les coˆ
uts de la sant´
e limite
´
egalement le recours aux soins hospitaliers, sinon encou-
rage de d´
eveloppement d’alternatives ambulatoires aux
traitements. Apr`
es l’int´
egration hospitalo-ambulatoire par
la cr´
eation des secteurs psychiatriques, l’ouverture et la
coordination avec les services sociaux et les soins de premier
recours constitue un enjeu essentiel de sant´
e publique pour
assurer le traitement des troubles psychiatriques s´
ev`
eres
dans la communaut´
e.
Plusieurs pays ont envisag´
e la constitution de r´
eseaux de
soins pour organiser la collaboration entre les partenaires,
contrecarrer la duplication et la fragmentation des services,
am´
eliorer leur qualit´
e et leur acc`
es, avec l’espoir d’amener
ces am´
eliorations sans n´
ecessairement ajouter de nouvelles
ressources [8]. Selon l’Anaes, «un r´
eseau de sant´
e constitue
une forme organis´
ee d’action collective apport´
ee par des
professionnels en r´
eponse `
a un besoin de sant´
e[...] compos´
e
d’acteurs [...] du champ sanitaire et social [1]. La consti-
tution d’un r´
eseau de soins implique soit une int´
egration
structurelle dans une mˆ
eme organisation (int´
egration ver-
ticale), soit la cr´
eation de liens entre les acteurs et des
´
echanges r´
eciproques qui d´
epassent le simple passage du
client d’un intervenant `
a un autre (int´
egration virtuelle)
[7]. En psychiatrie, le mod`
ele de secteur a constitu´
e une
premi`
ere ´
etape d’int´
egration verticale des services hospi-
taliers et ambulatoires pour faciliter leur coordination et
rapprocher les soins de la communaut´
e. Ce mod`
ele a per-
mis d’accompagner le mouvement de d´
esinstitutionalisation
par le d´
eveloppement de centres de soins ambulatoires ou
interm´
ediaires sans d´
esorganiser les services. Le travail en
r´
eseau constitue une ´
etape suppl´
ementaire d’ouverture vers
la communaut´
e, en associant plus fortement les nombreux
autres partenaires impliqu´
es dans le suivi des troubles psy-
chiatriques s´
ev`
eres : les usagers eux-mˆ
emes, leurs proches,
les m´
edecins g´
en´
eralistes, les soins `
a domicile, les services
sociaux, la police, la justice de paix et d’autres encore.
Le r´
eseau implique d’aller `
a l’encontre d’un mod`
ele qui
identifie le d´
eveloppement de la sant´
e`
a la promotion de
la m´
edecine technique et limite la production de sant´
e`
a
la consommation de soins techniques et de concilier les
dimensions individuelles et collectives : la sant´
e n’est pas
seulement un ph´
enom`
ene biologique individuel, mais aussi
un ph´
enom`
ene social [12]. Pour les personnes qui souffrent
de troubles psychiatriques s´
ev`
eres, l’int´
egration d’un r´
eseau
de soins signifie aussi offrir un acc`
es `
a des services vari´
es
durant les p´
eriodes de crises aigu¨
es et au-del`
a et de ren-
forcer la solidarit´
e, l’assistance mutuelle et l’appropriation
du pouvoir dans la population [8]. Confront´
e`
alan
´
ecessit´
e
d’offrir des soins vari´
es et sp´
ecialis´
es tout en restant proche
de la communaut´
e, le secteur psychiatrique joue un rˆ
ole cl´
e
dans l’articulation avec le r´
eseau.
Toutefois, la mise en r´
eseau des diff´
erents acteurs des
soins ne peut pas simplement ˆ
etre impos´
ee d’en haut.
Dans ce cadre, les perceptions que les acteurs ont les
uns des autres jouent un rˆ
ole important dans la possibi-
lit´
ed’
´
etablir une coop´
eration saine et fructueuse, d’autant
que certains aspects sp´
ecifiques aux troubles psychiatriques
peuvent constituer des obstacles s´
erieux... Il s’agit aussi
d’introduire une culture et une pratique de l’organisation
du travail entre des professionnels tr`
es diff´
erents par leur
statut, leur formation, leurs r´
ef´
erences culturelles et leur
registre d’action [16]. Selon Gray [11], cette collaboration
entre diverses organisations d´
epend de trois conditions suc-
cessives :
•l’identification de probl`
emes communs et la reconnais-
sance d’une interd´
ependance ;
•la recherche d’objectifs communs ;
•la redistribution du pouvoir et l’implantation de pratiques
interorganisationnelles [9,11].
Ainsi, chaque réseau doit construire collectivement son
projet en tenant compte des aspirations de ses membres
et en prenant le temps de la négociation et d’un appren-
tissage [2]. L’Anaes souligne l’importance de ce temps
d’apprentissage et de négociation collective pour facili-
ter le travail ultérieur du montage du réseau, tout comme
l’importance d’associer le travail d’évaluation dès cette
première phase [2]. Par cette étude, nous souhaitons mettre
en évidence, par des méthodes de recherche qualitative, les
points de vue des différents acteurs du réseau sociosanitaire
de la région de Lausanne sur la coopération, les moyens mis
en œuvre et les problèmes rencontrés dans le suivi de per-
sonnes souffrant de troubles psychiatriques sévères dans un
contexte de désinstitutionalisation, en préalable à la mise
en place d’une collaboration de réseau.
M´
ethode
Notre ´
etude vise `
a produire des connaissances et `
a
r´
ealiser un objectif de changement sur le mod`
ele de la
recherche—action [15], en examinant les probl`
emes ren-
contr´
es par les acteurs du r´
eseau sociosanitaire de la
r´
egion de Lausanne dans le suivi des personnes souffrant
de troubles psychiatriques s´
ev`
eres. Les soins psychiatriques
de la r´
egion sont organis´
es en secteur pour une population
principalement urbaine de 240 000 habitants. Les services
psychiatriques adultes sont constitu´
es par un hˆ
opital de
107 lits aigus et des centres de consultation ambula-
toires en ville. Depuis 1998, ces services sont organis´
es en
fili`
eres sp´
ecialis´
ees par diagnostics, tout en gardant une
responsabilit´
e de secteur (troubles du spectre de la schizo-
phr´
enie, troubles de la personnalit´
e, troubles de l’humeur,
d´
ependances), avec un service d’urgences psychiatriques
ambulatoire, une unit´
e d’investigation et une unit´
e hos-
pitali`
ere d’admission. Cette organisation par sp´
ecialisation
des fili`
eres de soins a ´
et´
ed
´
ecrite pr´
ec´
edemment [4]. Elle a
´
et´
e accompagn´
ee d’une ouverture de l’hˆ
opital et d’une aug-

754 C. Bonsack et al.
mentation des interactions entre le secteur psychiatriques
et de nombreuses instances dans la communaut´
e, accen-
tuant la n´
ecessit´
e d’une r´
eflexion sur la collaboration en
r´
eseau, par ailleurs initi´
ee par les orientations de la poli-
tique de sant´
e du canton [25]. Dans ce cadre, l’association
R´
eseau de la communaut´
e sanitaire de la r´
egion lausannoise
(Arcos) a initi´
elapr
´
esente recherche. Vingt-cinq acteurs du
r´
eseau sociosanitaire ont ´
et´
e interrog´
es de mani`
ere appro-
fondie sur les probl`
emes des patients qui rendent difficile le
maintien `
a domicile, sur la collaboration entre les interve-
nants et ses limites, ainsi que sur leur vision de l’avenir.
Ces personnes provenaient de divers horizons, mais sont
impliqu´
ees directement dans des interventions aupr`
es de
personnes souffrant de troubles psychiatriques, de fac¸on
`
a fournir des regards crois´
es sur la collaboration dans le
r´
eseau sur la base d’une pratique et non de convictions
id´
eologiques. Il s’agissait de deux m´
edecins, deux infirmiers
et deux assistants sociaux de l’institution psychiatrique du
secteur, la directrice, un assistant social et une interve-
nante de l’association locale des patients, deux psychiatres
priv´
es, quatre infirmi`
eres en psychiatrie et une responsable
travaillant dans un centre g´
en´
eraliste de soins `
a domicile,
un juge de paix, deux infirmi`
eres d’un h´
ebergement psychia-
trique, deux m´
edecins g´
en´
eralistes, deux collaborateurs des
services sociaux de la ville et deux policiers.
Production des donn´
ees
Nous avons proc´
ed´
e en deux phases successives. La premi`
ere
consiste en 25 entretiens individuels semi-directifs (dur´
ee
approximative : 1 heure) effectu´
es aupr`
es des personnes
identifi´
ees plus haut entre d´
ecembre 2001 et mars 2002.
Un bref questionnaire pr´
ealable sur les populations sui-
vies par chacun ainsi que ses partenaires de r´
eseau a
servi de point de d´
epart aux entretiens semi-directifs. Une
dizaine de questions a ´
et´
e utilis´
ee lors de la conduite
de chaque entretien, questions abordant successivement
les soins, la collaboration, les probl`
emes de collaboration
et l’avenir souhait´
e pour celle-ci. Une phase pilote (cinq
entretiens) nous a permis de reformuler partiellement le
protocole. Les 25 entretiens ont ´
et´
e enregistr´
es (audio) et
retranscrits.
La seconde phase de production des donn´
ees a pris la
forme de focus groups [18]. Concr`
etement, six groupes
de discussions ont ´
et´
e amen´
es `
a prendre position au
sujet des th`
emes d´
egag´
es lors des entretiens initiaux. Les
quatre th`
emes en question ´
etaient : les caract´
eristiques
des patients dont le maintien `
a domicile est difficile, la
collaboration entre institutions, la gestion des situations
de crise et ce que chacun attend des autorit´
es de sant´
e
publique. Quatre des groupes de discussion r´
eunissaient des
populations homog`
enes en termes institutionnels (patients
et proches, lieux de vie, m´
edecins, d´
epartement de psy-
chiatrie) ; les deux groupes restants rassemblaient des
partenaires d’horizons institutionnels divers (acteurs de ter-
rain, responsables institutionnels).
Analyse des donn´
ees
Les donn´
ees ont ´
et´
e transcrites et analys´
ees par th`
emes dans
un cadre conceptuel adapt´
e de Parsons [19] et de Tansella
et Thornicroft [24]. Le conceptuel de Parsons consid`
ere que
tout syst`
eme social poursuit un but et fonctionne selon une
influence r´
eciproque entre valeurs, processus et interactions
avec l’environnement. Il a ´
et´
e propos´
e pour analyser les
organisations de sant´
e[22]. Dans le cas pr´
ecis, en prenant
comme but le maintien `
a domicile des personnes souf-
frant de troubles psychiatriques s´
ev`
eres, il s’agit d’examiner
les valeurs des diff´
erents acteurs et des institutions qu’ils
repr´
esentent (comme favoriser l’autonomie ou la protec-
tion de la personne), puis de voir comment ces valeurs ont
une influence sur la mani`
ere d’intervenir aupr`
es des per-
sonnes (par exemple, pour hospitaliser ou laisser rentrer `
a
domicile une personne) et enfin quelles interactions cela
provoque avec les autres acteurs ou institutions concern´
es
(par exemple, avec la police lors de fugues). De mani`
ere
r´
ecursive, ces interactions peuvent ensuite modifier les
valeurs et recommencer un cycle d’influences successives
(par exemple, en ´
elaborant un protocole de collabora-
tion entre psychiatrie et police). Ce cadre conceptuel est
appliqu´
e aux niveaux de la population, des institutions et
des individus, sachant que les valeurs, les processus et les
interactions diff`
erent entre les niveaux et parfois mˆ
eme
s’opposent [12,13]. Par exemple, des valeurs au niveau de
la population de contrˆ
ole social peuvent diff´
erer des valeurs
de promouvoir l’autonomie au niveau institutionnel, voire
s’opposer `
a des valeurs de respect des libert´
es au niveau de
l’individu. Suivant ce mod`
ele, les th`
emes extraits des entre-
tiens ont ´
et´
e regroup´
es dans une matrice 3 ×3 comportant
verticalement les niveaux consid´
er´
es (population, institu-
tion et individu) et horizontalement les aspects de valeurs,
processus et interactions.
R´
esultats
Selon cette analyse, les comptes rendus dactylographi´
es
des entretiens ont ´
et´
e segment´
es en 1479 propositions et
group´
es en 52 th`
emes r´
epartis dans les neuf cases de la
matrice (Tableau 1).
Les r´
esultats sont pr´
esent´
es ici sous forme de synth`
eses
qui ont ´
et´
e´
elabor´
ees de mani`
ere `
a rapporter les propo-
sitions des interlocuteurs aussi fid`
element que possible ;
ils refl`
etent l’avis des personnes interrog´
ees et non celui
des auteurs. Selon le nombre de propositions, certains
th`
emes ont ´
et´
e synth´
etis´
es de mani`
ere regroup´
ee par case
de la matrice, d’autres ont ´
et´
e analys´
es en d´
etail. Les
obstacles principaux identifi´
es pour le maintien `
a domi-
cile des troubles psychiatriques s´
ev`
eres sont r´
esum´
es sur la
Figure 1. Seuls une partie des r´
esultats sont pr´
esent´
es ici de
mani`
ere r´
esum´
ee. Un extrait repr´
esentatif d’une transcrip-
tion d’entretien illustre le th`
eme consid´
er´
e.
Population
La psychiatrie «parent pauvre de la sant´
e»
Selon les termes d’un responsable de sant´
e publique dans
un focus groupe, la psychiatrie reste «le parent pauvre
de la sant´
e. »Dans les entretiens, les acteurs apparaissent
d´
esabus´
es quant `
alacoh
´
erence d’une politique de sant´
e
mentale ou la logique de r´
epartition des ressources :

´
Etude qualitative pour suivi des troubles psychiatriques s´
ev`
eres 755
Tableau 1 Matrice 3 ×3: th
`
emes et nombre de propositions.
Valeurs et normes nbre Processus nbre Interactions nbre
Population Int´
egration 2 Lieux de vie 7 Action politique 3
Loi 5 Population effective 47 Influence 1
Population cible 4 Ressources 14 Opinion publique 2
Institution Compl´
ementarit´
e 8 Crise 11 Collaboration institutions 271
Exp´
erience 2 Contrainte 12 Recherche 6
Finances
Humanit´
e
Mission
Savoirs
Solidarit´
e
Souplesse et rigidit´
e
7
9
44
5
1
6
Formation continue 10 Contacts 23
Hi´
erarchie interne 26 Formation 10
Intervention 137 Hi´
erarchie 19
Limites institution 164 Echange d’information 62
Pr´
evention 7 Limites du r´
eseau 121
Suivi dans le milieu 40 Partenariat 18
R´
eseau 155
Soutien 14
Stages 20
Questionnaire pr´
ealable 7
Individu Autonomie 17 Prise de conscience 2 Liens 9
Int´
egration 7 Limites personnelles 6 Marginalisation 9
Libert´
e 6 Maintien `
a domicile 6 Monde du travail 10
Qualit´
e de vie 2 Occupation 3
Conformit´
e10D
´
efinition du probl`
eme 66
Valeurs personnelles 4 Sp´
ecificit´
es personnelles 22
«Dans la constitution des r´
eseaux, ilyaunpaquet
d’argent, il y en aura qui seront mieux servis que
d’autres, c’est clair. »
La r´
esignation des acteurs de terrain et le sentiment
«d’absence »qui se d´
egage sont confirm´
es dans les focus
groupe o`
u cette question a ´
et´
e pos´
ee. La psychiatrie
apparaˆ
ıt orpheline de la politique, sans voix. Certains
acteurs comme les psychiatres priv´
es sont d´
ebord´
es par
le nombre et les attentes de leurs clients, faute de pou-
voir d´
efinir des objectifs prioritaires ou des populations
cibles. Un sentiment d’abandon par les pouvoirs publics se
d´
egage malgr´
e les pr´
eoccupations affich´
ees sur les risques
de violence et le contrˆ
ole social. Les acteurs expriment
Figure 1 Probl`
emes identifi´
es par les acteurs du r´
eseau.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%