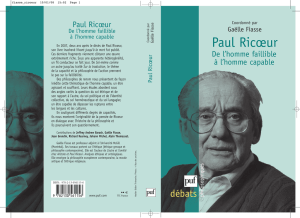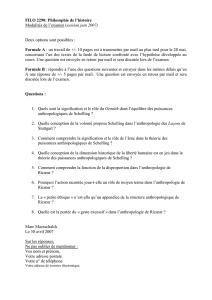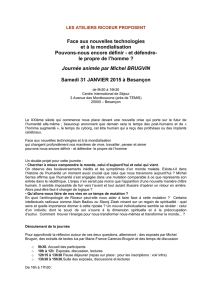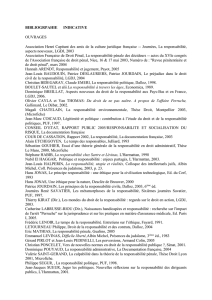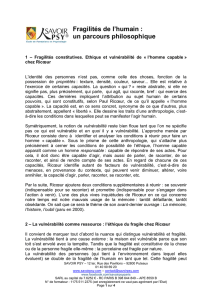En quoi la pensée de Paul Ricœur peut-elle nous

!
!
!"
"
"#
#
#$
$
$%
%
%&
&
&'
'
'(
(
(%
%
%#
#
#$
$
$%
%
%)
)
)'
'
'*
*
*&
&
&&
&
&"
"
"+
+
+,
,
,'
'
'-
-
-%
%
%.
.
.#
#
#/
/
/&
&
&%
%
%#
#
#)
)
)%
%
%'
'
''
'
'*
*
*/
/
/)
)
)0
0
0%
%
%#
#
#$
$
$*
*
*/
/
/)
)
)#
#
#1
1
1%
%
%2
2
2"
"
",
,
,&
&
&3
3
3##
#
#
#
#
4&-%)5%&-,*%#6,%))%78+,5,%)#9*&-%,+:#;*0-%/)#%&#$<,+*'*$<,%#$*+,-,=/%:#0<%)0<%/)#
"''*0,(#"/#>*&1'#?,0@/)#
!
"#!$%&'!()!*"#+""!,"!*)%(!-'./%-!*"%01"(("!#&%+!)',"-!)!.&2*-"#,-"!
(3'#+0'0%0'&#!*&('0'$%"!)%4&%-,35%'!6!
#
#
#
6%)2%--%A72*,#1%#5*/'#1,)%#2%'#)%2%)0,%2%&-'#+%'#$+/'#0<"+%/)%/B#$*/)#5*-)%#
,&5,-"-,*&:#%-#2*,C#$+",',)#1%#$*/5*,)#2D"''*0,%)#"/E*/)1D</,#"/B#-)"5"/B#1DF'$),-#
0,5,=/%G#4+#2D"#(-(#1%2"&1(#1D"H*)1%)#1%5"&-#5*/'#0%#=/%#+"#$%&'(%#1%#6"/+#?,0@/)#
"$$*)-%#"/E*/)1D</,:#'D"I,''"&-#1%#+D,&'-,-/-,*&#$*+,-,=/%G#J(#,+#K#"#0%&-#"&'#%B"0-%2%&-:#
1,'$")/#%&#LMMN:#0%#$<,+*'*$<%#%'-#+D"/-%/)#1D/&%#@/5)%#0*&',1()"H+%#=/,#0*2$-%#$"'#
2*,&'#1%#=/")"&-%70,&=#+,5)%'#%-#$+/'#1%#</,-#0%&-'#")-,0+%'#%&#C)"&O",':#$*/)#&%#$"'#
$")+%)#1%'#"/-)%'#+"&I/%':#1%'#0*/)':#1%#+"#0*))%'$*&1"&0%#*/#1%'#-%B-%'#)%'-('#P#+D(-"-#1%#
&*-%'#2"&/'0),-%'G#Q"#)(C+%B,*&#$*)-%#'/)#1%'#-<(2"-,=/%'#"/'',#1,5%)'%'#=/%#+"#5*+*&-(:#
+D"0-,*&:#+%#+"&I"I%:#+D<,'-*,)%:#+%#)(0,-:#+D,1%&-,-(:#+D,2"I,&",)%#'*0,"+:#+D(-<,=/%GGG#Q,#H,%&#=/%#
+%#$*+,-,=/%:#$*/)-"&-#H,%&#$)('%&-:#-%&1)",-#P#$"''%)#/&#$%/#,&"$%)O/#1"&'#+D%&'%2H+%:#
"+*)'#2R2%#=/D,+#%�*&'-,-/%#+D/&%#1%'#$)(*00/$"-,*&'#0*&'-"&-%'G##
#
S)T'#-U-:#+"#5,%#1%#6"/+#?,0@/)#%'-#2")=/(%#$")#+%#1(0T'#1%#'*&#$T)%:#2*)-#%&#VWVN#P#+"#
I/%))%:#$/,'#1%#'"#2T)%#%-#1%#'"#'@/)G#8)$<%+,&:#$/$,++%#1%#+"#&"-,*&:#,+#%&#I")1%)"#/&%#
-)"0%#$%)0%$-,H+%#1"&'#'%'#(0),-'#P#-)"5%)'#/&%#)(C+%B,*&#)(0/))%&-%#'/)#+"#&*&75,*+%&0%#%-#
+%#$"0,C,'2%#%-:#'K2(-),=/%2%&-:#'/)#+"#=/%'-,*/#2"+:#K#0*2$),'#%&#$*+,-,=/%G#
#
?,0@/)#&D"#1*&0#$"'#5,&I-#"&'#+*)'=/%#9*/&,%)#C*&1%#+"#)%5/%#F'$),-#%&#VWXLG#Y$$%+(#P#
%&'%,I&%)#P#Q-)"'H*/)I#P#$")-,)#1%#VWZ[:#,+#$")-,0,$%#"/#I)*/$%#\#F'$),-#]#1%#0%--%#5,++%G#
6/,':#(+/#P#+"#Q*)H*&&%#%&#VWN^:#'"#$)*B,2,-(#1%#$%&'(%#"5%0#+%#$%)'*&&"+,'2%#0*&1/,-#
?,0@/)#P#'D,&'-"++%)#P##_<`-%&"K79"+"H)K#$*/)#)%E*,&1)%#+%'#9*/&,%):#+%'#;*2%&"0<:#+%'#
9"))*/#"/B#\#9/)'#a+"&0'#]G#;"&'#?(C+%B,*&#C",-%#bVWWNc:#?,0@/)#'*/+,I&%#+/,72R2%#
+D,&C+/%&0%#1%#+"#\#0*&E*&0-,*&#%&-)%#$%)'*&&%#%-#0*22/&"/-(#]:#0<T)%#P#9*/&,%):#1"&'#
'*&#$)*$)%#-)"5",+G#F++%#0*&-),H/%#P#2")=/%)#0<%A#+/,#+"#1,2%&',*%#+D%&I"I%2%&-#1/#
$<,+*'*$<%#1"&'#+"#_,-(G#!*,%#'D,'*+%)#1"&'#+"#)(C+%B,*&:#,+#'D"I,-#1%#'D%B$*'%)#P#
+D(5(&%2%&-:#'*/0,#=/,#'%#$)*+*&I%#0<%A#?,0@/)#$")#/&%#,2$*)-"&-%#$<,+*'*$<,%#1%#
+D"0-,*&G#8&#-)*/5%#%&0*)%#1%'#(0<*'#%B$+,0,-%'#1%#0%#0*2$"I&*&&"I%#"5%0#9*/&,%)#1"&'#
/&#%&-)%-,%&#$/H+,(#%&#&*5%2H)%#VW[[#1"&'#/&#&/2()*#1%#+"#)%5/%#Y/-)%2%&-#'/)#+%#
-<T2%#\#Y#=/*,#$%&'%&-#+%'#$<,+*'*$<%'#3#]G#d/%'-,*&#P#+"=/%++%#?,0@/)#)($*&1#$")#/&%#
"++/',*,)%0-%#P#+D")-,0+%#1%#9*/&,%)#,&"/I/)"&-#+%#$)%2,%)#&/2()*#1DF'$),-#.#
\#eD"--%&1'#+"#?%&",''"&0%#]G#;%#2R2%:#?,0@/)#$/H+,%#%&#VWWM#1"&'#0%--%#1%)&,T)%#)%5/%#
/&#")-,0+%#',I&,C,0"-,5%2%&-#,&-,-/+(#\#Y$$)*0<%'#1%#+"#$%)'*&&%#]G#Q*)-%#1%#$)('%&-"-,*&#
1/#$)*$*'#0%&-)"+#1%#Q*,72R2%#0*22%#/&#"/-)%:#=/,#$")"f-#"+*)'#',2/+-"&(2%&-:#?,0@/)#
',-/%#1%#2"&,T)%#%B$+,0,-%#'*&#&*/5%"/#+,5)%#1"&'#+%#$)*+*&I%2%&-#1/#S)",-(#1/#

0")"0-T)%#1%#9*/&,%)G#6)*+*&I%2%&-#,+#K#":#0")#+D,1(%#$%)'*&&"+,'-%#'%+*&#+"=/%++%#+%#\#E%#]#
'%#0*&'-)/,-#I)`0%#P#'*&#)"$$*)-#P#/&#\#-/#]#'%#$*/)'/,-#0<%A#+/,#$")#+"#)%+"-,*&#P#/&#\#,+#]:#
P#/&#-,%)':#=/,#C,I/)%#+%#'*/0,#1%#-*/':#+%#'*/0,#1/#\#0<"0/&#]:#1/#\#'"&'75,'"I%#]G#?,0@/)#
',-/%#",&',#+"#)%+"-,*&#E%g-/#"/#0*22%&0%2%&-#1/#'%&'#1%#+"#E/'-,0%#=/,#1*,-#H(&(C,0,%)#P#
-*/'#%-#0*&'-,-/%)#+%#C*&1%2%&-#1%#+D,&'-,-/-,*&G#
#
!%#C,+#)*/I%#%'-#",&',#)"$$%+(#=/,#0*&1/,-#1/#E%g-/#$%)'*&&"+,'-%#0<%A#9*/&,%)#P#
+D,&'-,-/-,*&#-%++%#=/%#+"#0*&O*,-#?,0@/):#%-#&*-"22%&-#1%#+D,&'-,-/-,*&#$*+,-,=/%G#
Y$$)(<%&1(%#1%#+"#'*)-%:#0%--%#1%)&,T)%#%'-#P#$%&'%):#0*&C*)2(2%&-#"/#I)"&1#$)*E%-#=/,#
"&,2%#?,0@/):#%&#")-,0/+"&-#(-<,=/%#b)%+"-,*&#E%g-/c#%-#$*+,-,=/%#b'*/0,#1/#,+cG#h%&*&'7%&#
P#$)('%&-#"/B#-)*,'#I)"&1%'#C*)2/+"-,*&'#'/00%'',5%'#"/B=/%++%'#/&#-%+#$)*I)"22%#
1*&&%#+,%/G#
#
7!8!(39:;<9<=<9>:!?>@@A!B>C>:<D!E>=!CF!G>C9<9H=AI!
#
F&#*0-*H)%#VWN^:#0D%'-#+D,&5"',*%#a/1"$%'-#$")#+%'#0<")'#'*5,(-,=/%'G#?,0@/)#%'-#
,&1,I&(:#(H)"&+(G#F&#VWNi:#1"&'#+D")-,0+%#1D*/5%)-/)%#1D/*'',%)#1DF'$),-#0*&'"0)(#P#0%#
'/E%-:#,+#%&-%&1#)($+,=/%)#P#+"#1*/H+%#1(),5%#=/D,+#*H'%)5%#.#0%++%#1%'#0*22/&,'-%':#=/,#
0*&','-%#P#-*/-#E/'-,C,%)#%&#$*+,-,=/%#"/#&*2#1D/&%#$<,+*'*$<,%#1%#+Dj,'-*,)%:#%-#0%++%#1D/&#
0%)-",*)"+,'2%#=/,#0*&',1T)%#=/%#+"#$*+,-,=/%#0*&'-,-/%#/&%#"0-,5,-(#C*&0,T)%2%&-#
0K&,=/%#%-#2($),'"H+%:#%-#=/D,+#0*&5,%&-#1%#'D%(-*/)&%)G#_*22%#9*/&,%):#?,0@/)#
,&5,-%#,0,#P#'%#2*&-)%)#'%&',H+%#P#+D(5(&%2%&-:#$+/-U-#=/DP#'%#)%-)"&0<%)#1%)),T)%#1%'#
0%)-,-/1%'#-*/-%'#C",-%'G#
#
_D%'-#$*/)=/*,#?,0@/)#,&5,-%#P#$%&'%)#+"#$*+,-,=/%#0*22%#/,B-%#=/,#")-,0/+%#+"#5,'(%#
1%#+"#_,-(#<%/)%/'%#b"5%0#Y),'-*-%:#?*/''%"/:#j%I%+c#%-#+"#&(0%'',-(#1/#$*/5*,)#0*22%#
C*)0%#%-#0*22%#0*&-)",&-%#b9"0<,"5%+:#9")B:#!(&,&%cG#4+#)%5,%&-#"/B#0,-*K%&'#1%#'%#
2*&-)%)#5,I,+"&-'#%&5%)'#+%#$*/5*,):#$*/)#=/%#'%#2",&-,%&&%#+"#-%&',*&#%&-)%#0%'#1%/B#
$U+%':#%-#=/D%&#$")-,0/+,%)#+%'#I*/5%)&"&-'#&%#'%#0*/$%&-#$"'#1%#+"#5,'(%#1/#H,%&#
0*22/&G#
#
YCC,)2"&-#=/%#+"#+,H%)-(#0*&'-,-/%#+D%&E%/#0%&-)"+#1%#+"#=/%'-,*/#$*/5*,)#%-#=/%#\#+"#
1(2*0)"-,%:#0D%'-#+"#1,'0/'',*&#]:#?,0@/)#'%#$)*&*&0%#%&#C"5%/)#1%'#,&'-,-/-,*&'#1%#+"#
1(2*0)"-,%#+,H()"+%#%-#1D/&#F-"-#2(1,"-%/):#")H,-)%#%B%2$+",)%:#=/,#5%,++%#$")#'"#
&%/-)"+,-(#2R2%#'/)#+%'#0*&1,-,*&'#1%#+"#1,'0/'',*&#%&#(5,-"&-#+%'#%2$,T-%2%&-'#%&-)%#
'$<T)%'#1D"0-,5,-(G#!D(0*&*2,%#&D%'-#$"'#+"#$*+,-,=/%:#=/,#&D%'-#$"'#&*&#$+/'#+"#0/+-/)%G#F&#
*/-)%:#(-<,=/%#%-#$*+,-,=/%#'*&-#P#")-,0/+%):#2",'#'"&'#+%'#0*&C*&1)%#.#-*/-#&D%'-#$"'#
=/D(-<,=/%#%-#-*/-#&D%'-#$"'#$*+,-,=/%G#_%+"#,2$*'%#%&#$")-,0/+,%)#"/#$*+,-,=/%#1%#
$)('%)5%)#1%'#2")I%'#1"&'#+%'=/%++%'#,+#&%#'D,22,'0%#$"':#%&#'*)-%#=/%#+D(-<,=/%#$/,''%#
+,H)%2%&-#'D%B$),2%)G#_D%'-#+D"CC,)2"-,*D/&#+,H()"+,'2%#$*+,-,=/%G#
#
_%#2,B-%#)%5R-#0<%A#?,0@/)#+"#C*)2%#1D/&#\#$")"1*B%#]#b+D")-,0+%#$")/#%&#VWNi:#)%$),'#
%&'/,-%#1"&'#j,'-*,)%#%-#5(),-(:#'D,&-,-/+%#.#\#!%#$")"1*B%#$*+,-,=/%#]cG#4+#'D"I,-#1D/&%#
',-/"-,*"&'#+"=/%++%#1%/B#$)*$*',-,*&'#0*&-)",)%'#0*%B,'-%&-#1"&'#+"#$%&'(%#'"&'#=/%#
+%#)",'*&&%2%&-#$/,''%#%&#%B0+/)%#+D/&%#'"&'#%B0+/)%#+D"/-)%#*/#%&#)%-%&,)#/&%#'"&'#
)%-%&,)#"/'',#+D"/-)%G#_%--%#C,I/)%#"#$*/)#C*&0-,*%#2%--)%#%&#+/2,T)%#+%#C",-#=/%#+D,''/%#
1D/&%#-%++%#0*&-)"1,0-,*&#&%#$%/-#R-)%#C*/)&,%#$")#+"#)(C+%B,*&#"#$),*),#2",'#/&,=/%2%&-#
$")#+"#$)"-,=/%G#k&%#-%++%#$)(*00/$"-,*&#'%#$)*+*&I%:#0<%A#?,0@/):#1"&'#1D"/-)%'#-%B-%'#
1"&'#+%'=/%+'#,+#'D*$$*'%#"5%0#5,I/%/)#P#+D,1(%#=/%#$/,''%#%B,'-%)#/&%#'0,%&0%#1%#+"#

$)"-,=/%G#!D,&-%&-,*&#'*/'7E"0%&-%#%'-#=/%#$%)'*&&%#&%#$/,''%#'%#$)(-%&1)%#"/71%''/'#1%#
+"#2R+(%:#1"&'#+%#'/)$+*2H#1D/&#'"5*,)#=/,#'D,2$*'%)",-#'"&'#1,'0/'',*&G#6*/)#?,0@/):#+%#
\#2"+#$*+,-,=/%#]#)(',1%#$)(0,'(2%&-#1"&'#+"#$)(-%&-,*%#)(0"$,-/+%)#+D"I,)#</2",&#
1"&'#/&#'"5*,)G#k&%#-%++%#)(0"$,-/+"-,*&#&%#$%/-#R-)%#=/D/&%#\#C)"/1%#1"&'#+D@/5)%#1%#
-*-"+,'"-,*&#]G#F++%#0*&1/,-#"/#-*-"+,-"),'2%G#
#
9R2%#',#+%#0*&-%B-%#0*&-%2$*)",&#&D%'-#$"'#0%+/,#1%'#"&&(%'#VWNM:#+%#$)*$*'#0*&'%)5%#
-*/-%#'*&#"0-/"+,-(#"/E*/)1D</,G#Q"&'#%&#")),5%)#P#+D%B-)(2,-(#-*-"+,-",)%:#+D/%'#%&E%/B#
1%#+"#',-/"-,*&#"0-/%++%#&D%'-#%&#%CC%-#$"'#(-)"&I%)#P#+D*2&,$)('%&0%:#1"&'#+%#1,'0*/)'#
$*+,-,=/%:#1D/&#'"5*,)#1D%B$%)-,'%#=/,#"#$*/)#%CC%-#1%#1,''/"1%)#+"#1,'0/'',*&G#_"):#'%+*&#
+/,:#0%#=/D,+#0*&5,%&-#1%#C",)%#%'-#)($/-(#0*&&/#1D"5"&0%:#P#+"#+/2,T)%#1D/&%#'*)-%#1%#
'0,%&0%#7#(0*&*2,=/%#%&#$")-,0/+,%)G#;"&'#+%'#-%)2%'#/-,+,'('#$")#?,0@/)#%&#VWNi:#+%#
2%,++%/)#$)*E%-#$*/)#+"#_,-(#7#0%#=/D,+#"$$%++%#+"#$+/'#I)"&1%#\#)"-,*&"+,-(#]#$*+,-,=/%#7#
'D,&5%)'%#"+*)'#%&#+"#$+/'#I)"&1%#\#,))"-,*&"+,-(#]#=/,:#"/#&*2#2R2%#1%#+"#I)"&1%/)#1%#+"#
0"/'%#1*&-#%++%#'%#)(0+"2%:#%&-%&1#+D,2$*'%)#P#-*/-#$),B:#1%#2R2%#=/%#+D*&#C",-#%&-)%)#1%#
C*)0%:#"/#0<"/''%7$,%1:#/&%#)("+,-(#0*&0)T-%#1"&'#/&%#0"-(I*),%#$)(0*&O/%G#Y#+"#
1,CC()%&0%#1%#+"#1,'0/'',*&:#$")#+"=/%++%#*&#-%&1#$"-,%22%&-#P#'D"00*)1%):#+D,))"-,*&"+,-(#
'%#-)"1/,-#%,*+%&0%:#=/D%++%#'*,-#$*+,0,T)%#%-#2,+,-",)%#0*22%#P#a/1"$%'-#%&#VWN^:#*/#
=/D%++%#'*,-#+%#C",-#1D/&#)",'*&&%2%&-#)(1/0-%/)#$)('%&-(#0*22%#+D,&0*&-%'-"H+%#5(),-(G#
#
J!8!(3FK<9?=CF<9>:!LA!C3FMA!BAK<9?FC!L=!G>=B>9K!A<!L=!B9BKA1A:;A@NCA!O>K9P>:<FC!E>=!
CA!G>C9<9H=AI!
#
40,:#+%#$*,&-#1%#5/%#'D(+")I,-G#Y$)T'#+"#5*+*&-(#1%'#<*22%'#$*+,-,=/%'#"&,2('#$")#+"#
0*&=/R-%#%-#+D%B%)0,0%#1/#$*/5*,)#b%&E%/B#0")"0-(),'-,=/%'#1%#+"#$*+,-,=/%c:#*�*&',1T)%#
P#$)('%&-#+D%'$"0%#$/H+,0#=/,#0*&'-,-/%#+D<*),A*/#$*+,-,=/%:#1%#+"#_,-(G#d/%#0*&'-"-%7-7
*&#"+*)'#3#Q,#+%#$*/5*,)#5%)-,0"+#'D%B%)0%#'%/+#l#+%#$*/5*,)#=/D%B%)0%&-#<,()")0<,=/%2%&-#
+%'#I*/5%)&"&-'#'/)#+%'#I*/5%)&('#%-#=/%#'"&0-,*&&%#+DF-"-:#"/#2*K%/#\#2*&*$*+%#1%#
+"#5,*+%&0%#+(I,-,2%#]#b9"B#m%H%)c#l#+"#_,-(#5,)%#P#+"#-K)"&&,%G#!%#$*/5*,)#'%#)(1/,-#P#/&%#
C*)0%#&/%#=/,#"I,-#'"&'#+(I,-,2,-(G#9",'#',:#P#+D,&5%)'%:#+%#5,5)%7%&'%2H+%#'%#1($+*,%#'%/+:#
'"&'#/&#$*/5*,)#=/,#C",-#$"''%)#1%#+"#1,5%)',-(#</2",&%#P#+D/&,-(#1D/&%#1(0,',*&#=/,#
'D"$$+,=/%:#"+*)'#0D%'-#+D"&")0<,%G#6/,'=/D,+#C"/-#+D/&#%-#+D"/-)%:#+"#1%/B,T2%#C*)2/+"-,*/#
\#$")"1*B%#]:#=/%#?,0@/)#C*)2/+%#"/#-*/)&"&-#1%'#"&&(%'#VWWM:#&*-"22%&-#1"&'#Q*,7
2R2%#0*22%#/&#"/-)%:#'D"--"0<%#1*&0#P#0*2H,&%)#0%'#1%/B#"B%'#$*/)#%&5,'"I%)#+"#
$%)'$%0-,5%#=/,#1*,-#*),%&-%)#+%#5,5)%7%&'%2H+%#1"&'#+"#_,-(G#
#
J*/'#)%-)*/5*&'#,0,#+%#$)*E%-#0*&','-"&-#P#")-,0/+%)#(-<,=/%#%-#$*+,-,=/%G#Q%+*&#?,0@/):#
Y),'-*-%#"#+*&I-%2$'#(-(#+"#1%)&,T)%#C,I/)%#$<,+*'*$<,=/%#P#$%&'%)#%&'%2H+%#0%'#1%/B#
)%I,'-)%'#1%#+D"I,)#</2",&G#!"#_,-(#I)%0=/%#/&%#C*,'#%&I+*/-,%#1"&'#+D%2$,)%#9"0(1*&,%&:#
'D%'-#1(5%+*$$(%#/&%#1(),5%#0*&','-"&-#P#$%&'%)#+%#$*+,-,=/%#%&#+D"''*0,"&-#1%#2*,&'#%&#
2*,&'#P#+D(-<,=/%:#E/'=/DP#"H*/-,)#P#/&%#0*&0%$-,*�K&,=/%#1/#$*/5*,)#-%++%#=/D/&#
9"0<,"5%+#$%/-#+D,++/'-)%)G#S"&1,'#=/%#+D(-<,=/%:#0*/$(%#1/#$*+,-,=/%:#'D%'-#1(5%+*$$(%#'/)#
/*1%#1%#$+/'#%&#$+/'#$'K0<*+*I,'"&-:#0*&C,&(#1"&'#+"#'$<T)%#$),5(%:#'"&'#5,'(%#'/)#+%#
H,%�*22/&#%-:#1T'#+*)':#"$*+,-,=/%:#5*,)%#,&0,5,=/%#*/#"&-,$*+,-,=/%G#
#
F&#'D"--"0<"&-#P#)(")-,0/+%)#(-<,=/%#%-#$*+,-,=/%:#?,0@/)#%&-%&1#C",)%#%&#'*)-%#=/%#+%#
'*/<",-"H+%#b(-<,=/%c#$/,''%#*),%&-%)#+%#$*'',H+%#b$*+,-,=/%cG#_%+"#)%5,%&-#P#1(C,&,)#+%'#
0*&1,-,*&'#1"&'#+%'=/%++%'#+%#0*&'%&-%2%&-#1(2*0)"-,=/%#%'-#$*'',H+%#b$+/-U-#=/%#+"#
'*/2,'',*&cG#F&#%CC%-:#',#+D(-<,=/%#)%-)*/5%#/&%#5,'(%#1/#H,%�*22/&:#%++%#'%#$)*+*&I%#

1"&'#+"#'*0,(-(:#%&#'*)-%#=/D,+#(2"&%#1/#5,5)%7%&'%2H+%#/&%#\#(-<,=/%#1(2*0)"-,=/%#]:#
/&#'%&'#$")-"I(#1%#0%#P#=/*,#+"#_,-(#"'$,)%G#!%#$*/5*,)#5%)-,0"+:#'D,+#'%#2*&-)%#0"$"H+%#1%#
+D%&-%&1)%#%-#1%#+D,&-%)$)(-%):#'",-#"+*)'#1"&'#=/%+#'%&'#'%'#1(0,',*&'#1*,5%&-#R-)%#$),'%'#
$*/)#R-)%#"00%$-(%'#+,H)%2%&-#$")#+%'#I*/5%)&('G#
#
8&#-)*/5%#0<%A#?,0@/)#1%/B#2*1"+,-('#1D/&#$"''"I%#$%)2%--"&-#1%#C",)%#0*22/&,=/%)#
+%'#1%/B#"B%'#%&-)%#%/BG#!D/&#%'-#C*/)&,#&*-"22%&-#$")#/&#-%B-%#1%#VW^i#,&-,-/+(#
\#8H(,''"&0%#%-#"/-*&*2,%#]G#4+#,&1,=/%#/*/5%2%&-#$")#+%=/%+#+%#$"''"I%#'D%CC%0-/%#
%&#=/%+=/%#'*)-%#1%#<"/-#%&#H"'G#k&%#H*&&%#$")-,%#1%#+"#0/+-/)%#2*1%)&%#'D%'-#
1(5%+*$$(%:#'*/+,I&%#?,0@/):#"/-*/)#1D/&%#*$$*',-,*&#%&-)%#0%'#1%/B#-%)2%'#.#
+D"/-*&*2,%#%'-#0%#=/,#'%#'*/'-)",-#P#+D*H(,''"&0%:#%-#*H(,):#0D%'-#1(EP#&%#$+/'#R-)%#
"/-*&*2%#b0*22%#',#+D*&#&%#$*/5",-#*H(,):#',#+D*&#$%/-#1,)%:#=/%#HR-%2%&-cG#!"#
1(2*&'-)"-,*�*&','-%#P#(-"H+,)#=/D,+#&D%&#%'-#),%&G#Y,&',:#+*)'=/%#&*/'#&*/'#+",''*&'#
0"$-,5%)#$")#/&#)(0,-#%-#=/%#&*/'#'/,5*&'#"5%0#$"'',*�<"=/%#1(5%+*$$%2%&-#1%#
+D,&-),I/%#)"0*&-(%#$"'#P#$"'#$")#+D"/-%/)G#;%#2R2%#',#&*/'#1(0*/5)*&':#P#+"#C"5%/)#1D/&%#
1,'0/'',*&:#/&#")I/2%&-#,&(1,-#$")#+%=/%+#&*-)%#,&-%)+*0/-%/)#&*/'#C",-#5*,)#+%'#0<*'%'#
"/-)%2%&-G#4+#%&#%'-#",&',:#)('/2%#?,0@/):#0<"=/%#C*,'#=/%#&*/'#0*2$)%&*&'#=/%+=/%#
0<*'%#1%#&%/C#.#&*/'#*H(,''*&'#%&#-*/-%#"/-*&*2,%G#_D%'-#=/D%&#%CC%-#&*/'#1,'0%)&*&'#
"+*)'#/&%#H)T0<%:#5%)'#+"=/%++%#&*/'#&*/'#%&I*/CC)*&'#$")0%#=/D%++%#*/5)%#1%'#
$%)'$%0-,5%'#=/,#&*/'#C*&-#I)"&1,)#%-#0)*f-)%:#$)(0,'(2%&-:#%&#"/-*&*2,%G#
#
!"#',-/"-,*&#$")-,0/+,T)%#1*&-#,+#'D"I,-#,0,#%'-#0%++%#1/#)"$$*)-#P#+D"/-*),-(:#-%+#=/D,+#'%#
1($+*,%#&*-"22%&-#1"&'#+%#)%I,'-)%#1%#+"#'$,),-/"+,-(:#1%#+D(-<,=/%#*/#1%#+"#$(1"I*I,%G#
9",'#,+#$%/-#"5*,)#0*/)'#"/'',#%&#$*+,-,=/%G#_%+"#'/$$*'%#=/%#+"#$")*+%#=/,#(2"&%#1%'#
I*/5%)&"&-'#'D"1)%''%#"/B#I*/5%)&('#1"&'#1%'#-%)2%'#=/,#+%'#"$$%++%#P#I)"&1,):#%&#
'/II()"&-#1%'#$%)'$%0-,5%'#=/,#(+")I,''%&-#+%/)#5,'(%:#+%/)#<*),A*&G#_%--%#*$-,*&#)%=/,%)-#
1*&0#1%#$),5,+(I,%)#+"#0*&C,"&0%#%&#+"#)%0<%)0<%#1/#0*&'%&-%2%&-#$")#+"#1(+,H()"-,*&:#"/#
+,%/#1%#+"#0*/)-70,)0/,-%)#$")#+%#)%0*/)'#P#+D(2*-,*&#%-#"/-)%'#C"0,+,-('#1%#+"#
0*22/&,0"-,*&#$*+,-,=/%G#
#
QK2(-),=/%2%&-:#,+#%B,'-%#/&#$"''"I%#$*'',H+%#1%#H"'#%&#<"/-G#Q,#+D(-<,=/%#1(2*0)"-,=/%#
%'-#5,5"&-%:#%++%#'%#-)"1/,-#%&#%CC%-#%&#/*/+*,)75,5)%7%&'%2H+%G#;%#+"#0*&E*&0-,*/#
5%)H%#5*/+*,)#%-#1%#+D"15%)H%#%&'%2H+%:#,+#)('/+-%#=/%#+"#$+/)"+,-(#</2",&%#=/,#0*&'-,-/%#
+"#_,-(#$*,&-%#"+*)'#%,)%0-,*%#'*&#/&,-(:#P#+"=/%++%#'$*&-"&(2%&-#%++%#"'$,)%G#8)#
0%--%#/&,-(#%'-#$)(0,'(2%&-#'K&*&K2%#1%#+"#0*<(',*&#=/%#)%0<%)0<%&-#$")#",++%/)'#+%'#
I*/5%)&"&-'#P#-)"5%)'#+%/)#'*/0,#0*&'-"&-#1%#)"''%2H+%2%&-G#
#
!"#1%/B,T2%#C*)2/+"-,*/#\#$")"1*B%#$*+,-,=/%#]#$")#?,0@/)#,&5,-%#1*&0#P#0*&0%5*,)#
+%#$)*H+T2%#1/#$*+,-,=/%#%&#-%)2%'#1%#2(1,"-,*&'G#4+#'D"I,-#1D,1%&-,C,%)#1%'#+,%/B#
1D")-,0/+"-,*%'#$)"-,=/%'#%&-)%#+D"B%#<*),A*&-"+#1/#$*/5*,)#%-#+"#1,2%&',*&#
<*),A*&-"+%#1/#5,5)%7%&'%2H+%G#J*/'#&*/'#-)*/5*&'#1T'#+*)'#%&#$)('%&0%#1D/&%#'*)-%#1%#
2,++%7C%/,++%'#1%#=/%'-,*&'#=/,#"$$%++%&-#)(%B"2%&#"/E*/)1D</,G#;%#<"/-#%&#H"':#%++%'#
'D(-"I%&-#%�*22%&O"&-#$")#+%'#)U+%'#)%'$%0-,C'#1/#6")+%2%&-#%-#1%#+DFB(0/-,C:#$*/)#'%#
$)*+*&I%)#$")#+%#'-"-/-#1%#+D(+/#1"&'#'"#1*/H+%#)%+"-,*&#"5%0#+%'#(+%0-%/)'#%-#"5%0#+%'#
,&'-,-/-,*&'G#Q"&'#5,'%)#+D%B<"/'-,5,-(:#2%&-,*&&*&'#%&'/,-%#+"#C*&0-,*%'#$")-,'#
$*+,-,=/%':#1%'#'K&1,0"-':#1%'#"''*0,"-,*&'#1"&'#&*'#1(2*0)"-,%':#+%#)U+%#1%'#2(1,"'#1"&'#
+D(+"H*)"-,*%#+D*$,&,*&:#+D%CC%0-,5,-(#1%#+"#)%$)('%&-"-,*&#$*+,-,=/%#1%#+"#'*0,(-(#0,5,+%#
*/#%&0*)%#+"#0*&1,-,*&#"/#-)"5",+#0*22%#$(1"I*I,%#1%#+D%&I"I%2%&-#%-#(0*+%#1%#0,5,'2%G#
!D<K$*-<T'%#=/D*&#&%#$%/-#=/%#',I&"+%)#,0,#%'-#=/%#0%#5"'-%#$)*I)"22%#1%#-)"5",+#'%)",-#P#

"H*)1%)#1%#H"'#%&#<"/-:#+"#)('*+/-,*%'#$)*H+T2%'#=/*-,1,%&'#0*&-),H/"&-#P#)"5,5%)#+%#
'%&'#1/#5,5)%7%&'%2H+%#%-:#1%#$)*0<%#%&#$)*0<%:#P#+%#)(-"H+,)#",&',#%,'7P75,'#1/#
$*/5*,)#5%)-,0"+#E/'=/D"/#'*22%-#1%'#,&'-,-/-,*&'#%-#1%#+DF-"-G#
#
Q!8!(A;!?>:L9<9>:;!GKF<9H=A;!L3DCFN>KF<9>:!LA;!G>C9<9H=A;!
#
;"&'#+%#0*/)"&-#1%'#"&&(%'#VWWM:#?,0@/)#)%C*)2/+%#%&0*)%#'*&#\#$")"1*B%#$*+,-,=/%#]#
$*/)#$)%&1)%#%�*2$-%#/&%#1*&&(%#&*/5%++%G#4+#'D%&#%B$+,=/%#1"&'#!"#0),-,=/%#%-#+"#
0*&5,0-,*&G#F&-)%-,%&#"5%0#>)"&O*,'#YA*/5,#%-#9")0#1%#!"/&"K:#*/5)"I%#$")/#%&#VWWNG#
6+/'#I(&()"+%#%&0*)%#=/%#+%'#"$$)*0<%'#$)(0(1%&-%':#+"#$)(*00/$"-,*&#$*)-%#'/)#+%'#
0*&1,-,*&'#1"&'#+%'=/%++%'#&*/'#"I,''*&'#%&#'*0,(-(:#=/%#0%+"#'*,-#%&#-"&-#=/D(+/#$*+,-,=/%#
*/#0*22%#',2$+%#0,-*K%&G#_%+"#0*&0%)&%#-*/-#/�<"0/&#%-#%&I+*H%#+%#5,5)%7%&'%2H+%#
1"&'#+D%B,'-%&0%#=/*-,1,%&&%:#&*'#"$$")-%&"&0%'#%-#&*'#%&I"I%2%&-':#%-#E/'=/D"/B#
0*&1,-,*&'#1D(+"H*)"-,*%'#$*+,-,=/%'#$/H+,=/%'G#J*/'#5%))*&'#-*/-#P#+D<%/)%#=/%#0%-#
(+")I,''%2%&-#1%#+D"&I+%#1%#5/%#'%#1*/H+%#1D/&%#%B-%&',*&:#&*&#$+/'#1"&'#+D%'$"0%:#2",'#
0%--%#C*,'#1"&'#+%#-%2$'G#
#
;%#=/*,#'D"I,-7,+#3#!%#$)*H+T2%#$),&0,$"+#%'-#"/E*/)1D</,#/&#%&E%/#1%#1,'0%)&%2%&-G#J*/'#
&%#&*/'#$%)0%5*&'#$+/'#0*22%#0,-*K%&'#=/%#$")#,&-%)2,--%&0%:#=/"&1#&*/'#5*-*&'#*/#
=/"&1#&*/'#2"&,C%'-*&':#$")#%B%2$+%G#!%#)%'-%#1/#-%2$':#+"#$*+,-,=/%#&*/'#"$$")"f-#
0*22%#/&%#"0-,5,-(#E/B-"$*'(%#"/B#"/-)%'#.#-)"5",+:#0*&'*22"-,*&:#+*,',)':#%-0G#_D%'-#1,)%#
=/%#+"#$*+,-,=/%#$%)1#1%#5/%#+%#$*+,-,=/%:#+"#1,2%&',*&#$%)2"&%&-%#%-#%&I+*H"&-%#1/#
5,5)%7%&'%2H+%G#6*/)#?,0@/):#0%+"#-,%&-#%&#$")-,0/+,%)#P#+D%2$),'%#0)*,''"&-%#1/#2")0<(#
1"&'#+%'#(0<"&I%'G#F&#%CC%-:#+D(0<"&I%#2")0<"&1#0%&-)%#+D"--%&-,*%'#$)*-"I*&,'-%'#'/)#
+%'#H,%&'#(0<"&I(':#"/#1(-),2%&-#1%'#$%)'*&&%'#%&#$)('%&0%G#!"#+*I,=/%#1/#1*&&"&-7
1*&&"&-#2%&"0%#"+*)'#1%#5,)%)#"/#0K&,'2%#=/,#&%#1*&&%#$+/'#=/%#$*/)#)%0%5*,)G#!%#
-),*2$<%#1%#+D<*22%#1/#0"+0/+:#1%#+D<*2*#*%0*&*2,0/':#-%&1#",&',#P#&*/'#)%&1)%#$+/'#
1,CC,0,+%#"/E*/)1D</,#1%#0*&0%5*,)#+"#$*'',H,+,-(#2R2%#1%#+D(0<"&I%#I(&()%/B#%-#
1(',&-()%''(G#
#
4+#,2$*)-%#1*&0#1D%2$R0<%)#=/%#+"#+*I,=/%#2")0<"&1%#%-#+"#'$<T)%#(0*&*2,=/%#'%#
'/H*)1*&&%&-#$%/#P#$%/#-*/-%'#+%'#"/-)%'#'$<T)%'#1D"0-,5,-(G#6*/)#?,0@/):#0D%'-#+%#)U+%#1%#
+DF-"-#=/%#1D*)I"&,'%)#+"#1,'0/'',*&#P#$)*$*'#1%#0%#=/,#1*,-#)%+%5%)#1/#2")0<(#*/:#"/#
0*&-)",)%:#1D"/-)%'#2*1%'#1%#1,'-),H/-,*%'#H,%&'G#!D")I%&-#&%#'"/)",-#R-)%#+%#'%/+#
0),-T)%#1D"00T'#P#0%'#H,%&'#%-#,+#&*/'#)%5,%&-#1%#1(+,H()%)#'/)#+%'#2*1"+,-('#=/,#'%2H+%&-#
"$$)*$),(%'#P#+D(-"-#1*&&(#1%#&*-)%#'*0,(-(G#!"#)($+,=/%#"$$*)-(%#$")#?,0@/)#0*&','-%#P#
)"5,5%)#$*/)#0%+"#+%#'%&-,2%&-#1%#C)"-%)&,-(:#"C,%#)%0%&-)%)#+D"--%&-,*&#'/)#+%'#
$%)'*&&%'#1"&'#+D(0<"&I%#%-#1%#)(5(+%)#+"#$*'',H+%#1,2%&',*%#I)"-/,-(#=/,#K#
'*22%,++%#%-#=/,#%�*&'-,-/%#+"#\#5(),-(#0"0<(%#]G#_D%'-#",&',#=/D,+#"$$%++%#P#)"5,5%):#1%#
$)*0<%#%&#$)*0<%:#+%#'%&'#1/#5,5)%7%&'%2H+%#0*22%#\#$)"-,=/%#1%#+"#C)"-%)&,-(#]G#
#
6*)-%)#%&#,2"I,&"-,*&#'/)#2*&#'%2H+"H+%#/&#)%I")1#=/,#2%#+%#C",-#5*,)#0*22%#/&#C)T)%#
0*&','-%#"+*)'#P#%&5,'"I%)#+"#)%+"-,*&#$)('%&-%#1"&'#'"#',&I/+"),-(#.#0%++%#1D/&%#',-/"-,*&:#
0%++%#1%#+D"/-)%#0*22%#+"#2,%&&%G#_%+"#'/$$*'%:#P#+D,&5%)'%:#1%#)%+"-,5,'%)#+D,2$*)-"&0%#1%#
+"#)TI+%#I(&()"+%#%-#"&*&K2%#1%#+D(0<"&I%G#!D,&1,CC()%&0%#'D%CC"0%#"+*)'#%R2%#-%2$'#
=/%#+D,&1,CC()%&0,"-,*%'#,&-%)+*0/-%/)':#"/#$)*C,-#1D/&#'%&-,2%&-#1%#0*7"$$")-%&"&0%#
"/#5,5)%7%&'%2H+%#=/,#)"$$)*0<%#%-#=/,#'/'0,-%#+"#I(&()*',-(G#_%++%70,#'%#$)*$"I%#"+*)'#
"/71%+P:#'"&'#,2$*'%):#$")#+"#'%/+%#5%)-/#1%#+D%B%2$+"),-(#7#1%#2R2%#=/%:#$")#%B%2$+%:#+%#
H*/0<%7P7*)%,++%#0*+$*)-%#/&#$+",',)#1%#+%0-/)%#%-#+%#-)"&'C*)2%#%&#H%'-7'%++%)G#
 6
6
1
/
6
100%