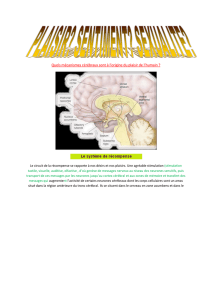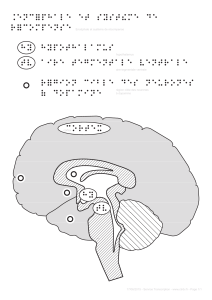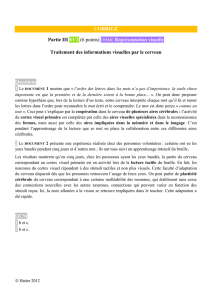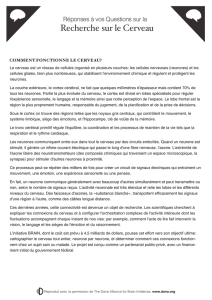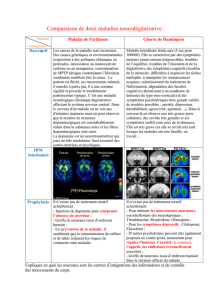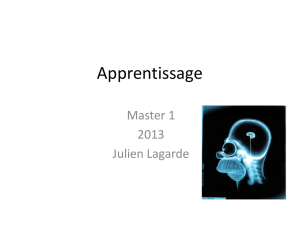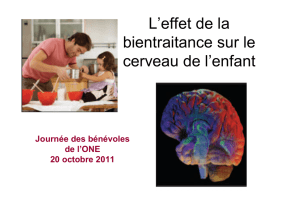Télécharger le fichier

40
4.3 La structure du cerveau humain

41
4.4 Anatomie cérébrale fonctionnelle
Le cortex cérébral comporte six couches de neurones richement interconnectés. Les deux tiers de sa
surface sont enfoncés dans des replis. Dès le XIX
e
siècle, il est apparu que les diverses fonctions du
cerveau sont liées à des aires particulières. En 1861, le neurologue français Paul BROCA remarqua
qu’un de ses patients était incapable de parler, tout en étant parfaitement capable de comprendre le
langage. Lorsque BROCA pratiqua l’autopsie de cet homme, il trouva une lésion dans le lobe frontal
gauche. Il en conclut que la région atteinte était responsable de la production de la parole. Des
examens similaires, par exemple chez des soldats ayant subi des lésions cérébrales, permirent de
produire une première carte fonctionnelle du cortex cérébral. Aujourd’hui, l’imagerie médicale
permet d’analyser les structures et les fonctions du cerveau, et de visualiser des lésions avec précision.
Du point de vue anatomique (figure 35), on divise chaque hémisphère en quatre lobes : frontal,
pariétal, temporal et occipital.
Figure 35 : Structure du cerveau humain
Du point de vue fonctionnel (figure 36), on reconnaît trois types d’aires : les aires primaires,
secondaires et associatives. Les aires primaires réceptionnent les informations sensorielles et réalisent
une sorte de projection du corps ou du champ sensoriel. Les aires secondaires sont situées au voisinage
immédiat des aires primaires. Elles effectuent un traitement de l’information sensorielle ou motrice.
Les aires associatives occupent la majeure partie des lobes frontaux et pariétaux ; elles sont
responsables de la pensée sous toutes ses formes et de la mémoire, sans que ces fonctions soient
localisables avec précision.
Figure 36 : Cartes fonctionnelles du cortex cérébral. A Hémisphère gauche B Aire motrice primaire
C Aire somesthésique primaire

42
L’aire auditive primaire se situe dans le lobe temporal. Elle reçoit les influx en provenance de la
cochlée par le nerf auditif. L’aire auditive secondaire est située autour de l’aire primaire ; elle est
responsable de l’identification des sons. Si une lésion de l’aire auditive primaire rend partiellement
sourd à certains sons, une lésion de l’aire secondaire entraîne une surdité verbale : le patient entend
les sons, mais est incapable de les identifier.
L’aire visuelle primaire est située dans le
lobe occipital. Du fait du croisement partiel
des voies visuelles, les influx en provenance
de la partie gauche de la rétine de chaque œil
aboutissent dans l’aire visuelle gauche.
L’hémisphère gauche « voit » donc le champ
visuel droit, et vice versa.
Une lésion de l’aire visuelle produit une cécité
neurologique : une partie du champ de vision
n’est plus perceptible. L’aire visuelle
secondaire, où l’information visuelle est
traitée, est située juste devant. C’est là que
s’effectue la reconnaissance des objets ou de
l’écriture. Une lésion de l’aire secondaire
produit une agnosie visuelle : le patient voit
les objets autour de lui, mais ne les reconnaît
pas. Il voit une page imprimée sans pouvoir la
lire, car les lettres n’ont plus de sens pour lui
(cécité verbale).
L’aire motrice primaire qui pilote les
motoneurones, est située à l’arrière du lobe frontal. Parallèle à celle-ci, l’aire motrice secondaire
permet l’organisation et la coordination des mouvements. Une lésion dans l’aire motrice primaire
entraîne une paralysie, alors qu’une lésion dans l’aire secondaire entraîne une apraxie : le patient est
incapable d’effectuer un mouvement complexe.
Les axones des neurones sensoriels provenant des diverses régions corporelles aboutissent à l’aire
somesthésique primaire, adjacente à l’aire motrice, à l’avant du lobe pariétal. Le corps entier se
projette sur ces deux aires primaires, mais proportionnellement à l’importance neurologique de chaque
partie du corps, et non pas en fonction de sa surface. Les formes de la projection du corps sur les aires
du cortex s’appellent l’homunculus moteur et l’homunculus sensoriel, respectivement. La face et la
main y occupent une place prépondérante. L’aire somesthésique secondaire, parallèle à l’aire
primaire, joue un rôle essentiel pour la perception du schéma corporel et des relations spatiales entre
les objets touchés. Des lésions dans cette aire peuvent entraîner l’incapacité de reconnaître un objet
pris dans la main, alors qu’on le reconnaît lorsqu’on le voit.
De grandes parties du cortex cérébral n’ont pas de fonction motrice ou sensorielle immédiate. Ce sont
les aires associatives, qui combinent les informations sensorielles avec celles provenant d’autres
parties du cerveau et les comparent avec les informations mémorisées. Cette intégration permet la
prise de décision. La pensée logique ou analytique, la conceptualisation, la capacité de conférer un
sens aux choses ou aux actions, les capacités artistiques, toutes les fonctions supérieures du cerveau
humain seraient inopérantes sans la référence incessante aux informations mémorisées.
Plusieurs fonctions sont latéralisées. Le centre de la parole se trouve dans le cortex frontal gauche,
tandis que la perception de l’intonation est effectuée dans l’hémisphère droit. En règle générale,
l’hémisphère gauche est responsable de la pensée logique et analytique, et l’hémisphère droit de la
musicalité, de la créativité et de la représentation spatiale. Les deux hémisphères sont
complémentaires, car ils communiquent par le corps calleux. Pour soulager des individus atteints
d’épilepsie sévère, on a dû procéder à la section du corps calleux. Dans la vie courant, ces patients au
cerveau divisé (angl. split brain) ne présentent étonnamment pas de symptômes. Mais l’absence de
connexion entre les hémisphères a pu être mise en évidence par des tests : lorsqu’on projette
Figure 37 : Le système visuel humain

43
rapidement un mot sur la gauche d’un écran auquel ils font face, ils ne peuvent pas écrire ce mot de
leur main droite, mais uniquement de la gauche, et ils sont incapables de dire ce qu’ils ont vu ou écrit.
Le système limbique est situé sur le bord intérieur du télencéphale. Il contrôle l’affectivité, les
émotions, ainsi que les phénomènes d’apprentissage et de mémorisation. Les deux hippocampes sont
essentiels pour le transfert des informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme.
C’est là que se forment les souvenirs, stockés ensuite dans d’autres régions du cortex. Les amygdales
servent de « système d’alerte » ; elles sont impliquées dans l’appréciation de la valeur émotionnelle
des stimuli sensoriels et associées à la génération des sentiments de peur. Elles sont aussi sollicitées
pour les processus de mémorisation, mais là où interviennent les émotions, par exemple dans le
système d’apprentissage par punition/récompense.
4.5 Les méthodes d’imagerie médicale

44
4.6 Du stimulus à la perception
L’illusion d’optique de la figure 38 permet de percevoir à
la fois une jeune et une vieille femme. On entend par
perception l’identification des objets observés et
l’attribution d’une signification. Les perceptions sont
toujours subjectives et dépendent des expériences
individuelles.
Par exemple, lorsqu’on regarde des nuages dans un ciel
d’été (figure 39), le champ visuel est projeté par le
système dioptrique de l’œil sur la rétine. Ce stimulus
provoque l’activation de certaines cellules
photoréceptrices. Ces stimuli sont partiellement traités
dans la rétine et sont ensuite transférés au cerveau par les
axones des cellules ganglionnaires qui transitent par le
nerf optique. Ils rejoignent le thalamus et ensuite le cortex
visuel primaire dans le lobe occipital. A cet endroit, le
traitement de l’information visuelle engendre la sensation
« une surface bleue avec des régions blanches de formes
et de tailles irrégulières ».
Figure 39 : Stimulus – sensation – perception
L’information visuelle est ensuite traitée dans les aires visuelles secondaires et les aires associatives, et
les structures reconnues sont comparées avec les images stockées. Cela conduit à une interprétation de
l’image observée, fortement influencée par l’expérience. La perception consciente « je vois un ciel
d’été avec des nuages » naît de la sensation et du traitement subséquent de l’information.
Figure 38 : Illusion d’optique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%