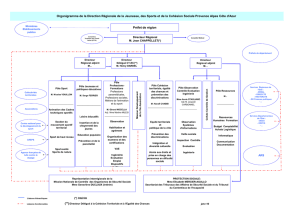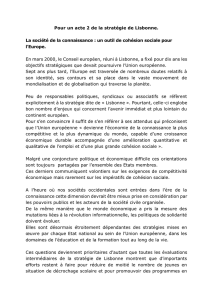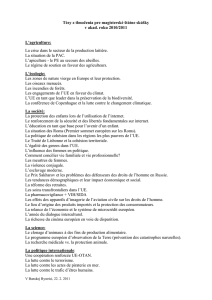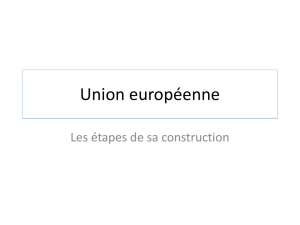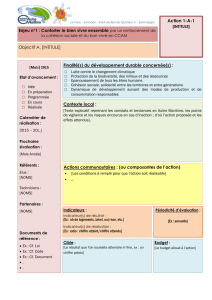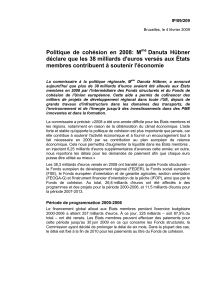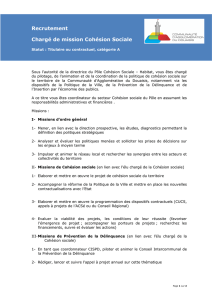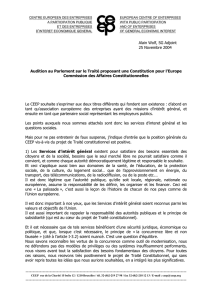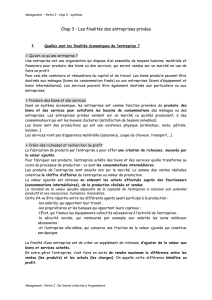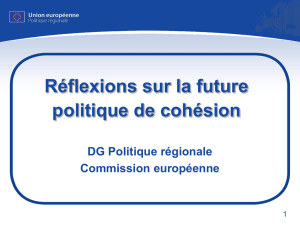Quelle place pour la cohésion sociale dans la politique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEEP rue de la Charité 15 boîte 12 / 1210 Bruxelles / tél. 32-(0)2-219 27 98 / fax 32-(0)2-218 12 13 / E-mail :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRE EUROPEEN DES ENTREPRISES
A PARTICIPATION PUBLIQUE
ET DES ENTREPRISES
D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL
EUROPEAN CENTRE OF ENTERPRISES
WITH PUBLIC PARTICIPATION
AND OF ENTERPRISES
OF GENERAL ECONOMIC INTEREST
CEEP.01/AVIS.10
Orig. Fr. – Juin 2001
Quelle place pour la cohésion sociale dans la
politique communautaire de l’après Lisbonne ?
Résumé
Dans cette contribution faisant suite au sommet de Stockholm du 22 mars 2001, le
CEEP s’interroge sur la place véritable et le sens partagé ou non de la « cohésion
sociale » dans la stratégie de Lisbonne à travers les principaux textes
communautaires et contributions qui vont en nourrir les débats.
La lecture des textes principaux de l’actualité communautaire montrent que la
cohésion sociale est définie de façon relative par les critères ou considérations plus
ou moins convergents par lesquels chacun lui donne un contenu (protection sociale,
différences de revenu et de niveau de vie, inégalités régionales, …). Le Traité lui-
même ne la distingue pas de la cohésion économique.
La question est alors soit de construire une définition en soi de la cohésion sociale,
ce qui est affaire de chercheurs ou de philosophie, soit de choisir l’ensemble
pertinent de critères externes, ce qui est affaire de débat démocratique qui reste à
engager.
La lecture de la communication1 conduit le CEEP à regretter que ce texte garantisse
insuffisamment la prise en compte sérieuse de l’objectif de cohésion sociale présent
dans les conclusions de Lisbonne dans un contexte de transformation profonde des
équilibres entre l’économique et le social.
La contribution des Etats membres renforce la marginalisation de la cohésion sociale
dans l’objectif de Lisbonne. A l’inverse, le CEEP soutient les points énoncés dans la
résolution du Parlement en direction du sommet de Stockholm : (1) modernisation du
modèle social européen en faveur de la cohésion sociale ; (2) lutte contre l’exclusion
et la pauvreté ciblée sur les jeunes, les plus défavorisés, les personnes âgées, les
handicapés, et les immigrants en situation légale ; (3) l’usage des fonds structurels
1 Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union européenne : consolidation et extension de la stratégie
de Lisbonne – COM(2001)79 final

2
pour une politique de cohésion sociale dans l’Union élargie ; (4) le soutien aux
régions ultra périphériques.
Le 2ème rapport de cohésion établit que l’élargissement amplifie grandement les
disparités. Avec une convergence entre régions dans une Union élargie se
poursuivant au même rythme, demanderait au moins deux générations.
Ce constat clair et alarmant ne doit pas conduire à différer l’élargissement, mais ne
peut être passé sous silence dans le suivi du sommet de Lisbonne. Une plus grande
cohérence dans la synthèse des travaux communautaires améliorerait l’utilisation de
chacun dont la qualité est indéniable.
Le CEEP exprime dans cette contribution une vision de la cohésion sociale définie
en termes de territoires et de réseaux.
Le CEEP pense que l’équilibre entre l’économique et le social n’est en aucun cas
une résultante automatique du dynamisme de l’économie assorti de quelques
précautions sur la protection sociale.
Il est favorable à une prise en compte permanente de la dimension de cohésion
sociale (à définir dans un débat européen démocratique) dans la conception et la
mise en œuvre de chaque politique économique, avec une application intégrée au
niveau du territoire.
Le CEEP pense que l’économie globalisée d’une part et la cohésion sociale
territorialisée de l’autre, garantissent l’occurrence des crises de mutation industrielle
où les territoires seront isolés et sans défense face aux acteurs économiques
globaux tenus à la compétitivité internationale.
Il est temps de penser les politiques positives alternatives qui contribueront à pallier
ces effets, notamment la coopération interrégionale des secteurs à même
composante industrielle dominante ; le CEEP à travers son réseau EUREXCTER
prépare des propositions expérimentales dans ce sens.
En énonçant le concept de cohésion sociale et territoriale, la proposition de la
Commission pour un débat sur la nouvelle gouvernance introduit une dimension
majeure de la cohésion sociale :
Politique européenne de la proximité, réseau des villes d’Europe, réseaux de
services d’intérêt économique général sont les exemples qui confirment une vision
de la gouvernance « autour de l’idée-clef d’une unification continentale européenne,
d’une solidarité à reconstruire en mobilisant le patrimoine historique, géographique et
interculturel qui a fondé l’essor des relations économiques et commerciales sur le
continent européen. »2
Voici un cadre plus général et stimulant pour une conception opératoire de la
cohésion sociale à décliner dans chaque Etat, région et territoire et auquel le CEEP
est prêt à apporter son soutien et son expérience de terrain à travers le réseau
EUREXCTER.
2 SEC(2000) 1547/7 final p. 14

3
Table des matières
1. LE LANGAGE DE L’EUROPE 4
2. LA COHÉSION SOCIALE DANS LE TRAITÉ 4
3. A LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION DE LA COHÉSION SOCIALE COMME
FINALITÉ DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE 5
4. LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES POUR LE SOMMET DE
STOCKHOLM. 6
5. 2ÈME RAPPORT SUR LA COHÉSION 7
5.1. SITUATION ET TENDANCES 7
5.2. UN SAUT QUANTITATIF ET QUALITATIF MAJEUR AVEC L’ÉLARGISSEMENT 7
5.3. LA DIMENSION TERRITORIALE : DES DÉSÉQUILIBRES PERSISTANTS 8
5.4. CONCENTRATION OU DISPERSION : QUELLES TENDANCES ?8
6. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX ET PROJETS DE NOUVELLE
GOUVERNANCE EUROPÉENNE 9
6.1. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX 9
6.2. LE DÉBAT SUR LA NOUVELLE GOUVERNANCE 10

4
1. Le langage de l’Europe
L’édifice communautaire concret se construit progressivement dans le temps des
rencontres, des sommets et des traités sur le langage et les concepts qui le
structurent. A chaque étape importante une nouvelle forme langagière est associée,
dont le contenu se précise dans une représentation partagée au fil des négociations
et des textes qui l’intègrent.
La « subsidiarité » a acquis par exemple un contenu substantiel, aujourd’hui
pratiquement stabilisé à l’issue de longs débats contradictoires. Il en est de même du
« processus » dont la cohorte semble volontairement limitée (Lisbonne a veillé à ne
pas être interprété comme un nouveau processus) en même temps que son sens est
désormais consensuel dans le vocabulaire communautaire. Enfin, la « nouvelle
gouvernance » explicite un changement dont l’exploration est l’objet d’un grand
chantier communautaire ; le sens nouveau et partagé devrait en sortir.
Il n’en va pas de même pour la « méthode ouverte de coordination » née de
Lisbonne avec une définition ouverte et minimale, encore en débat contradictoire où
s’opposent des représentations de la « panacée » ou du « diabolique », ou encore
pour la « qualité », véritable mot-valise transféré sans précaution du paradigme
managérial vers celui bien différent de l’action publique, autour duquel le tourbillon
des discours se nourrit du flou avant de progresser et de se réduire dans la
rationalité négociée du discours politique pour enfin se traduire dans l’action
communautaire et la convergence.
Il en va ainsi généralement de la construction de la pensée commune et
communautaire.
D’autre mot aussi essentiels n’ont pas le même sort ; ils sont utilisés à tout bout de
champ comme si leur sens était élucidé, comme si leur seule évocation permettait
d’en partager l’importance et le sens.
Dans cette contribution complémentaire au sommet de Stockholm, le CEEP
s’interroge sur la place véritable et le sens - partagé ou non - de la « cohésion
sociale » dans la stratégie de Lisbonne et à travers les principaux textes
communautaires et contributions qui vont en nourrir les débats.
2. La cohésion sociale dans le Traité
L’article 158 introduit le Titre XVII sur la cohésion économique et sociale :
Article 158 (ex-article 130 A)
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté,
celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion
économique et sociale.
En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins
favorisées, y compris les zones rurales.

5
Deux remarques s’imposent : la cohésion se définit d’abord en termes de disparités
territoriales et ne différencie pas les contenus de la dimension de cohésion
économique par rapport à celle de cohésion sociale.
La politique de cohésion s’identifie largement à l’usage des Fonds structurels et
notamment du fonds de cohésion.
3. A la recherche d’une définition de la cohésion sociale comme
finalité de la politique européenne
C’est dans les conclusions du sommet de Lisbonne qu’on doit prendre la référence
de base à la cohésion sociale comme finalité de la convergence européenne :
« devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative
et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. »
L’énoncé de l’objectif majeur, s’il ne définit pas la cohésion sociale a le mérite de
poser clairement l’équilibre nécessaire et la complémentarité de l’économique et du
social ; la communication de la Commission sur le suivi de Lisbonne le confirme :
« Au cœur de la stratégie de Lisbonne se trouve l'objectif de renforcer la compétitivité,
de tendre vers le plein emploi et de promouvoir la cohésion sociale, en ajoutant une
culture de dynamisme économique et de renouveau social à la stabilité économique
qui est désormais une réalité. »
On y trouve un texte plus précis3 qui énonce des éléments compatibles ou
antinomiques de la cohésion sociale : pauvreté, exclusion, disparités régionales de
l’emploi ou du niveau de vie, protection sociale (en fait retraites pour l’essentiel).
Il est remarquable d’observer que la définition est construite à partir de critères
supposés être explicatifs et non constitutifs : la pauvreté est supposée contraire à la
cohésion sociale ; intuitivement acceptable ce critère n’en reste pas moins externe ;
de plus il est des sociétés – peu recommandables certes - où la pauvreté associée à
l’exploitation est facteur de cohésion sociale et où l’information et la conscientisation
deviennent facteur d’instabilité et de rupture dans la cohésion ; on peut en dire autant
des autres critères de cette définition externe de la cohésion sociale.
La cohésion sociale est définie de façon relative où plutôt par rapport à une vision
positive de la société supposée cohésive dès lors que ces critères sont vérifiés : pas
de pauvreté ni d’exclusion, pas de disparités régionales de l’emploi et du niveau de
vie, une bonne protection sociale, … A tout système de critères peut être associée
une définition différente mais toute aussi légitime de la cohésion sociale
3 Cohésion sociale. La pauvreté et l'exclusion persistent au sein de l'Union européenne. Le
phénomène est aggravé par d'importantes disparités régionales au niveau de l'emploi et du niveau de
vie. Les systèmes de protection sociale doivent être modernisés et améliorés. Vu le vieillissement de
la population, il convient de s'attacher dès maintenant à faire en sorte que les pensions soient
garanties et viables à l'avenir et que les systèmes de santé soient en mesure de répondre à des
besoins nouveaux en matière de soins. (p. 3)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%