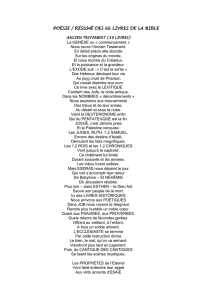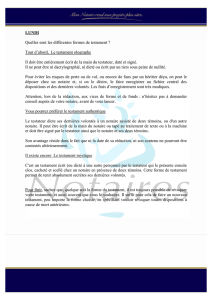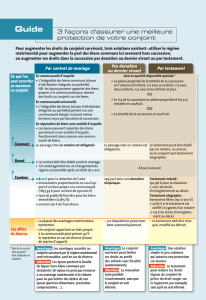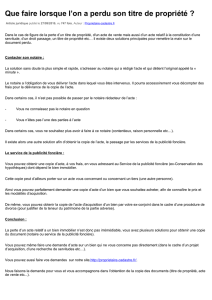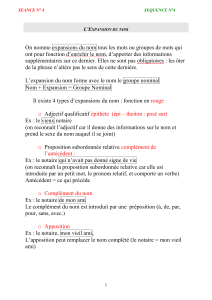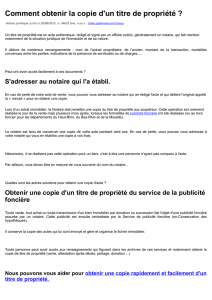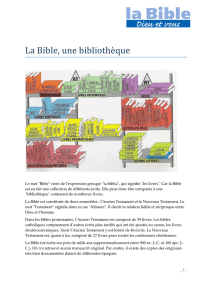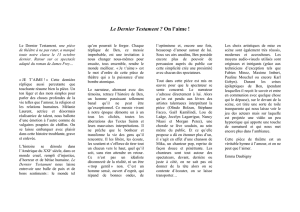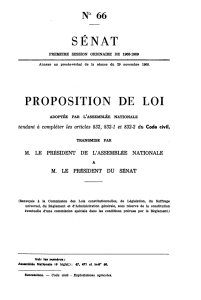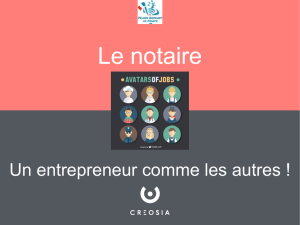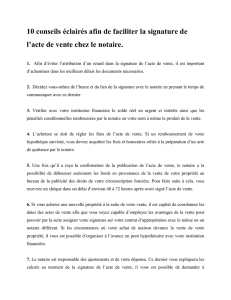La réforme de l`envoi en possession du légataire

ÉTUDE FAMILLE
1138
Page 31
LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
P
Étude et formules rédigées par
François Letellier
SUCCESSION-PARTAGE
La loi n° 2016-1 547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
21e siècle a fait de la procédure d’envoi en possession du légataire universel
une procédure d’exception. Ainsi, pour les successions ouvertes à compter du
1er novembre 2017, le légataire universel institué par testament olographe ou
mystique ne sera, en principe, pas soumis à envoi en possession. Suite au décret
d’application du 28 décembre 2016 (D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016), une circu-
laire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise certaines modalités de
cette réforme. Toutes les questions ne sont pas pour autant élucidées.
1 - Propos introductifs1 - On sait que le législateur, dans
un but non dissimulé de faire des économies publiques,
a déjudiciarisé un certain nombre de procédures. Nous
ne reviendrons pas sur le divorce par consentement mu-
tuel qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, pour nous
intéresser à l’envoi en possession du légataire universel
qui a été profondément réformé.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de moder-
nisation de la justice du 21e siècle a fait de la procédure
d’envoi en possession du légataire universel une pro-
cédure d’exception, alors que jusqu’à présent seul le
légataire universel institué par testament authentique
était dispensé de cette procédure2. Pour les successions
1 Nous tenons à remercier Me Brigitte Rivoire et Mme Élisabeth
Saillant pour leur aide si précieuse.
2 Fr. Letellier, La réforme de l’envoi en possession du légataire uni-
versel et de l’exécuteur testamentaire : JCP N 2016, n° 49, 1337. –
N. Pierre et S. Pierre-Maurice, La déjudiciarisation de l’envoi en
possession du légataire : Defrénois 2016, p. 1327.
1138
François Letellier est docteur en droit et
notaire à Clermont-Ferrand
La réforme de l’envoi
en possession du
légataire universel
Aspects pratiques

1138 ÉTUDE FAMILLE
Page 32 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le légataire universel
institué par testament olographe ou mystique ne sera, en prin-
cipe, pas soumis à envoi en possession.
L’envoi en possession est la procédure qui permet de vérifier
que les conditions d’ensaisinement du légataire universel sont
bien remplies : validité apparente de l’écrit testamentaire, vo-
cation universelle de la personne désignée (le titre) et absence
d’héritier réservataire. En faisant de cette procédure une excep-
tion, la réforme n’a pas pour autant supprimé ces vérifications
essentielles, c’est tout simplement leur auteur qui change.
Le décret d’application a été pris le 28 décembre 2016 et une
circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise
certaines modalités de cette réforme3. Toutes les questions ne
sont pas pour autant élucidées.
1. Le principe : « l’envoi en
possession notarial »
A. - Établissement du procès-verbal de
dépôt et description
2 - Dépôt et conservation du testament - Ce procès-verbal aura
deux fonctions. L’une est ancienne, l’autre nouvelle. La première
est celle de conférer une authenticité à l’écrit testamentaire qui
devient, par le décès, le titre du légataire et par là même, un
moyen d’en assurer la conservation. La seconde fonction de cet
acte est de constater la vérification des conditions d’ensaisine-
ment du légataire universel.
En effet, le nouvel article 1007 du Code civil prévoit que, le dé-
cès survenu, le testament doit faire l’objet d’un dépôt au rang
des minutes soit du notaire qui le détenait, soit d’un notaire
auquel on l’aura remis. Le notaire, comme il le faisait avant
cette réforme, dressera un procès-verbal de dépôt et de descrip-
tion de l’écrit testamentaire. Il devra, dans cet acte, préciser les
circonstances de ce dépôt. Jusque-là rien de nouveau, mais le
notaire devra, pour permettre l’ensaisinement du légataire uni-
versel, procéder à deux types de vérifications ; certaines sont de
fond, d’autres de forme.
3 - Les vérifications de forme - Il semble qu’il incombe au no-
taire d’effectuer un contrôle formel et apparent du testament
qui lui est remis ou qu’il doit déposer. C’est d’ailleurs ce qu’en
pratique les notaires faisaient en mentionnant dans le procès-
verbal de dépôt que le testament était écrit en entier à la main,
daté et signé. Le notaire précisait également s’il présentait des
ratures ou autres mots rayés et ajoutait, en général, que le testa-
ment ne semblait présenter aucune défectuosité. Aujourd’hui,
cette vérification semble s’imposer au notaire car, sauf opposi-
tion, il n’y aura aucun contrôle judiciaire.
3 Circ. CIV/02/17, 26 janv. 2017 : JCP N 2017, n° 6-7, 1103, spéc. fiche 11 ;
Defrénois Flash 13 févr. 2017, p. 13.
4 - Première vérification de fond : le caractère universel du
legs - Le notaire s’assurera de la vocation universelle du léga-
taire. On peut dire que sous l’empire des anciens textes, le no-
taire n’avait qu’un rôle passif. Un testament lui était remis, il en
transcrivait le texte et relatait les conditions de sa remise et sa
mission s’arrêtait là.
Désormais, il devra se livrer à un travail d’interprétation si
les termes du testament ne sont pas clairs et analyser le texte
de la libéralité pour en confirmer la nature universelle. Dans
bien des cas, le testament comporte littéralement les termes de
« légataire ou legs universel ». Mais il arrive que la formulation
employée par le testateur ne soit pas aussi limpide et qu’il faille
se livrer à une interprétation et exposer les motifs de son inter-
prétation. Raisons objectives, subjectives et éventuellement en
faisant appel à des éléments intrinsèques ou extrinsèques au
testament (intervention de l’exécuteur testamentaire, annexe
d’un courrier qui accompagnait le testament et permettait son
interprétation, etc.).
5 - Seconde vérification de fond : l’absence de réservataire -
C’est sans doute la nouveauté la plus remarquable. Le notaire,
dans cet acte, attestera qu’il aura vérifié l’absence d’héritier ré-
servataire. Il est confié au notaire qui dépose le testament le soin
de contrôler l’absence de descendant ou de conjoint survivant.
S’agissant de ce dernier, dans la plupart des cas ce sera simple,
l’acte de naissance et l’acte de décès de l’éventuel époux peuvent
suffire et le notaire les annexera. S’agissant des descendants, ce
sera plus complexe et l’on en revient à la difficile preuve des
qualités héréditaires aujourd’hui assurée par l’acte de notoriété.
Le notaire a ici une vraie responsabilité de généalogiste et doit
faire preuve de vigilance.
Dès lors qu’il est impossible d’avoir la certitude qu’une per-
sonne ne laisse pas de descendant, plusieurs possibilités s’offrent
au notaire pour limiter sa responsabilité. Soit il diligente une
vérification par un expert qualifié tel un généalogiste qui fera
des recherches, soit il s’inspire de l’acte de notoriété, en faisant
intervenir à ce procès-verbal des témoins. Il prendra soin d’an-
nexer à cet acte : la copie du livret de famille du défunt, son
acte de naissance éventuellement son acte de mariage et l’acte
de décès de son conjoint. Bien évidemment, le notaire devra
également annexer le compte rendu d’interrogation du Fichier
Central des Dispositions de dernières volontés4 car n’oublions
pas que les reconnaissances d’enfant naturel peuvent prendre
la forme d’un testament… En outre, cela permettra de vérifier
l’absence de testament ultérieur contenant une révocation des
dispositions antérieures ou de mettre au jour d’autres dispo-
sitions testamentaires que devra exécuter le légataire universel.
Ces vérifications de fond, par leur nature, ne peuvent être ins-
tantanées et devront être préalables à la signature du procès-
verbal du dépôt de testament qui ne pourra donc pas être dressé
4 Contra N. Pierre et S Pierre-Maurice, préc. note (2).

ÉTUDE FAMILLE 1138
Page 33
LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
« sur le champ » comme le prévoit pourtant l’article 1007 du
Code civil. Ces vérifications s’accompagnent à l’évidence d’un
alourdissement de la responsabilité du notaire qui doit dresser
l’acte de dépôt. Il ne faut pas oublier que le notaire amené à
dresser le procès-verbal de dépôt n’a pas forcément connu per-
sonnellement le testateur, soit parce que le testament avait été
confié à son prédécesseur, soit parce que le testament lui a été
remis mais sans pour autant avoir été son « notaire de famille ».
REMARQUE
➜ En pratique, la question qui se pose est de savoir si
ce procès-verbal, qui par sa nouvelle nature empiète sur la
fonction de l’acte de notoriété, dispense le notaire de dres-
ser un tel acte. Sans doute qu’une fois les délais d’opposition
écoulés ou l’envoi en possession rendu, un acte de notoriété
relatant tous ces faits et actes, et concentrant tous les élé-
ments dévolutifs de la succession, serait relativement utile.
Mention de l’accomplissement de toutes ces vérifications devra
figurer dans l’acte de dépôt du testament et une fois cet acte
signé, le notaire accomplira plusieurs formalités.
B. - Les formalités de publicité
6 - Ces nouvelles mesures de publicité du testament sont à la
base du nouveau système, puisqu’elles vont permettre à tout
intéressé de s’opposer à l’exercice par le légataire universel de sa
saisine. Voyons-les dans leur ordre chronologique.
7 - Publicité dans un JAL et au Bodacc - L’article 1378-1 du Code
de procédure civile dispose que dans les quinze jours suivant
l’acte de dépôt du testament, le notaire fait procéder à l’inser-
tion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans
le ressort du tribunal compétent, c’est-à-dire celui du domicile
du défunt. Le notaire fait publier la même insertion au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Ces me-
sures de publicité sont effectuées aux frais du légataire universel
(CPC, art. 1378-1). Cet avis devra nécessairement comprendre
les nom et prénoms du défunt, son domicile, ses date et lieu
de naissance, les date et lieu de son décès, la date du testament,
l’existence d’un ou plusieurs legs universels ainsi que la date du
procès-verbal de dépôt et description. Devront également figu-
rer les noms et lieu d’exercice du notaire (adresse)5 car c’est à
5 La circulaire du 26 janvier 2017 énonce que l’avis doit mentionner les
coordonnées du notaire.
© GOOD LIFE STUDIO - GETTY

1138 ÉTUDE FAMILLE
Page 34 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
lui que devront parvenir les éventuelles oppositions. Le décret
a pris soin de préciser que cette publicité au Bodacc et dans un
journal d’annonces légales peut être effectuée par voie électro-
nique. Il est regrettable qu’un tel procédé n’ait pas été envisagé
pour la transmission au greffe du tribunal de grande instance.
Les textes ne semblent pas imposer la publication des noms des
légataires universels.
REMARQUE
➜ Cette publicité « grand public » est nouvelle, pour-
tant le droit d’opposition existait avant cette réforme. Les
successions testamentaires seront donc moins secrètes,
moins confidentielles, sauf à user de la forme authentique
pour le testament…
8 - Transmission au greffe du tribunal - Le notaire doit adres-
ser, dans le mois qui suit l’établissement de l’acte de dépôt du
testament, une copie authentique de l’acte et une copie figurée
au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture
de la succession. Le greffier en accusera réception auprès du
notaire et conservera ces copies au rang de ses minutes. Cette
mesure existait déjà avant la réforme et n’a fait l’objet d’aucune
« modernisation ».
Le notaire devra bien veiller à être provisionné par le légataire
universel, tant des frais de ce procès-verbal, que du coût de la
publicité.
2. L’exception : l’envoi en possession
judiciaire
A. - L’opposition
9 - L’auteur de l’opposition - L’opposition à l’exercice par le lé-
gataire universel de sa saisine de plein droit peut être formée par
tout intéressé, nous dit le texte. Reste à définir ces personnes !
Ce seront bien évidemment les héritiers réservataires, les héri-
tiers ab intestat non réservataires, d’autres légataires universels
institués par d’autres testaments, ou bien d’autres légataires qui
revendiquent eux aussi une vocation universelle.
Ces oppositions devront être motivées par l’existence d’obs-
tacles à cet ensaisinement du légataire universel : non-respect
grossier des règles de validité du testament, présence d’une
réserve héréditaire ou vocation universelle litigieuse.
Comme auparavant, l’envoi en possession ne fera pas obstacle
à une procédure sur le fond quant à la validité ou à l’interpréta-
tion du testament.
10 - Le destinataire de l’opposition - L’opposition doit être faite
« entre les mains » du notaire chargé du règlement de la succes-
sion. Si le notaire dépositaire du testament n’est pas celui chargé
du règlement de la succession, alors les avis publiés devront être
précis pour que ce ne soit pas le notaire dépositaire du testa-
ment qui reçoive les oppositions.
11 - Les formes de l’opposition - Tant les textes que la circulaire
sont muets sur les formes de cette opposition. À l’évidence elle
peut être formée par acte d’huissier, il s’agit là d’une bonne
précaution. Mais elle pourrait valablement être faite par une
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adres-
sée au notaire. On pourrait même envisager qu’une personne
se déplace chez le notaire et le requière de dresser acte de son
opposition.
Il incombe au notaire d’informer le légataire universel de
l’existence des oppositions et de se ménager la preuve de cette
information.
12 - Le délai de l’opposition - Le texte (C. civ., art. 1007, dern.
al.) précise que l’opposition devra être formée dans le délai d’un
mois. Mais quel est le point de départ de ce délai ? En principe,
un délai d’opposition court à compter d’une publication, or en
l’espèce le texte paraît clair, c’est la date de réception par le greffe
du tribunal de grande instance des copies du PV de dépôt du
testament et du testament qui compte. Comme cette réception
par le greffe fait courir le délai d’opposition, l’annonce légale
devrait donc préciser cette date, mais cette annonce légale doit
être faite dans les 15 jours du dépôt du testament. Si la récep-
tion par le greffe du tribunal est postérieure à ces 15 jours, alors
il sera impossible que l’annonce légale, forcément antérieure,
mentionne ce point de départ…
CONSEIL PRATIQUE
➜ Il est donc vivement conseillé d’envoyer au greffe
la copie authentique de l’acte de dépôt et la copie figurée
du testament sans délai par lettre recommandée avec avis
de réception, et de faire procéder dès retour de l’accusé de
réception aux insertions obligatoires.
Plus logiquement la circulaire précise que « L’ensemble de ces
dispositions créent (sic) un droit de saisine de plein droit du
légataire universel à l’expiration du délai d’opposition6, soit
au plus tard un mois après la publication de l’avis au Bodacc
et à un journal d’annonces légales. ». Ce n’est pourtant pas ce
qu’indique le texte…
B. - Les conséquences de l’opposition
13 - La procédure d’envoi en possession - L’opposition à l’exer-
cice de sa saisine par le légataire universel va l’obliger à diligen-
ter, par le ministère d’un avocat, une requête d’envoi en pos-
6 Nous ne reviendrons pas sur cette terminologie approximative, le nou-
veau dispositif ne remet pas en cause la saisine de plein droit et dès le dé-
cès du légataire universel en l’absence de réservataire (C. civ., art. 1006)
tout comme l’ancienne procédure d’envoi en possession !

ÉTUDE FAMILLE 1138
Page 35
LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
session auprès du président du
tribunal de grande instance du
lieu d’ouverture de la succession.
À cette requête devront être
jointes les copies authentiques
du procès-verbal de dépôt du
testament et de l’acte attestant
l’existence d’une opposition.
Le président rendra une ordonnance d’envoi en possession ou
refusera au légataire universel cet envoi en possession. Cette
décision sera susceptible d’un appel formé dans les quinze jours
conformément à l’article 496 du CPC.
Par ailleurs, une telle procédure ne fait pas obstacle à des actions
judiciaires engagées sur le fond (validité ou interprétation du
testament).
Une fois l’ordonnance d’envoi en possession rendue, sa copie
authentique (grosse) fera l’objet d’un acte de dépôt dressé par
le notaire chargé de la succession et le légataire universel pourra
exercer pleinement ses pouvoirs et ses droits sur les biens suc-
cessoraux. Il sera habilité à délivrer les autres legs.
En guise de conclusion, nous retiendrons donc trois points :
- l’accroissement de la mission du notaire et un alourdissement
de sa responsabilité ;
- l’allongement des délais, ce qui n’est pas sans causer des pré-
occupations concrètes ;
- l’exclusion totale de l’exécuteur testamentaire de ce dispositif.
14 - Transfert de responsabilité - Par ces nouvelles dispositions,
s’opère un transfert évident de responsabilité qui était celle de
l’État sur le notaire, qui désormais joue un rôle important dans
les modalités d’ensaisinement du légataire universel. Cette res-
ponsabilité peut être lourde de conséquences car une fois en
possession des biens successoraux, le légataire universel peut
accomplir des actes y compris de disposition et éventuellement
mettre en péril les droits d’autrui. Le notaire devra être parti-
culièrement vigilant dans la vérification de l’absence de réser-
vataire et dans le respect des délais. Notons qu’aucune revalo-
risation de l’émolument d’acte du procès-verbal de dépôt de
testament du tarif des notaires n’a été effectuée. Pourtant l’acte
n’a plus la même fonction… Cet émolument fixe est actuelle-
ment de 26,92 € hors taxe7.
15 - Allongement des délais - Entre le temps nécessaire pour
vérifier l’absence de réservataire (ce qui ne peut être fait sur le
champ), les délais pour envoyer les copies au tribunal (1 mois)
le délai pour procéder aux annonces légales (15 jours) et le délai
pour faire opposition et l’éventuelle procédure d’envoi en pos-
session, ce sont plusieurs mois qui peuvent s’écouler…
7 A. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016 ; JCP N 2016, n° 10, 1095. - C. com., art.
A. 444-60.
Sachant qu’a priori dans ces
dossiers, des droits de succes-
sion importants seront dus dans
les 6 mois, il est évident que
ces délais peuvent provoquer
des situations bien ennuyeuses,
non seulement pour le légataire
universel, mais aussi pour les
légataires particuliers ou à titre universel, auxquels les legs ne
peuvent être délivrés par le légataire universel tant que toutes ces
formalités et procédure ne sont pas accomplies.
16 - Et l’exécuteur testamentaire ? Nous déplorons une nouvelle
fois la situation de l’exécuteur testamentaire soumis à l’envoi
en possession depuis 2006. En effet, le législateur de 2005 avait
calqué la situation de l’exécuteur sur celle du légataire univer-
sel en opérant un renvoi à l’article 1008 aujourd’hui abrogé. Ce
renvoi a été supprimé, mais la loi a maintenu cette obligation
pour l’exécuteur testamentaire de solliciter l’envoi en posses-
sion pour exercer ses pouvoirs de gestion de l’hérédité. Quelle
est donc cette procédure prévue par l’article 1030-2 ? Les situa-
tions pourront être incongrues si le testateur a à la fois institué
un légataire universel et désigné un exécuteur testamentaire.
Le premier bénéficiera du nouveau régime et le second devra
requérir son envoi en possession…
17 - Vive le testament authentique ! On sait que le légataire uni-
versel institué par testament authentique n’était pas assujetti
à l’envoi en possession. Il n’est pas plus soumis à ce nouveau
dispositif fastidieux et risqué. En effet, cette vérification n’est
tout simplement pas opérée par le notaire quand le testament
est authentique… Celle-ci n’est faite que lors de l’établissement
de l’acte de notoriété, mais la responsabilité du notaire est alors
moindre car il n’a pas à procéder aux vérifications que nous
avons vues. Rien ne justifie cette discrimination entre les deux
légataires universels (celui institué par testament olographe
ou mystique et celui institué par testament notarié). Lors de la
réception du testament authentique, il n’est pas contrôlé l’ab-
sence de réservataires qui peuvent d’ailleurs naître, être adoptés,
reconnus ou bien épousés après le testament. Un testament au-
thentique a également le mérite d’écarter toutes les incertitudes
pour l’exécuteur testamentaire8.
Un nouvel élan devrait donc se dégager en faveur de la forme
notariée du testament malgré les quelques contraintes formelles
qu’elle implique !
8 F. Letellier L’envoi en possession de l’exécuteur testamentaire, mise au point
nécessaire sur la réforme du 26 juin 2006 : JCP N 2008, 1331.
Ces vérifications s’ac-
compagnent à l’évi-
dence d’un alour-
dissement de la
responsabilité du
notaire qui doit dresser
l’acte de dépôt
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%