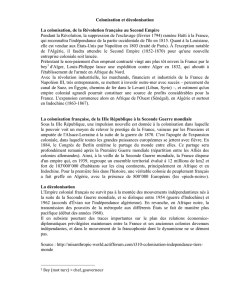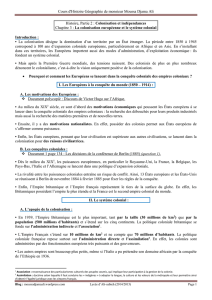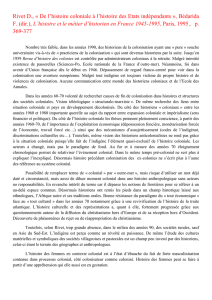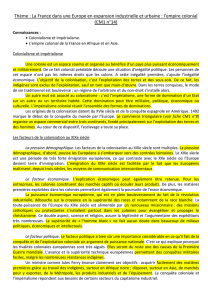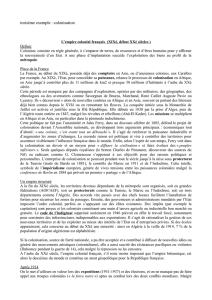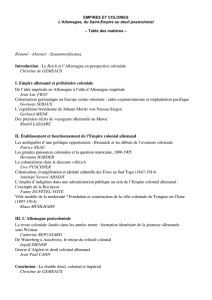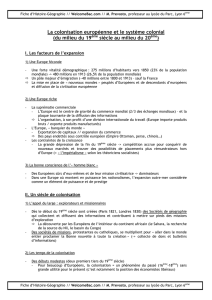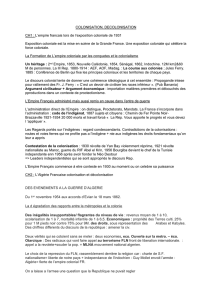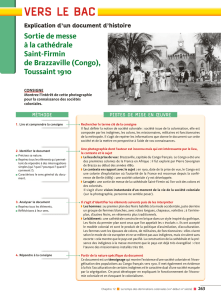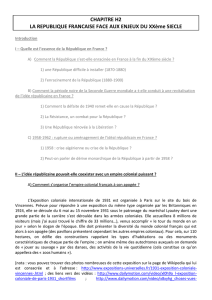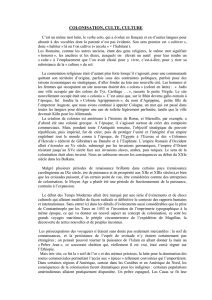Présentation de la question de tronc commun

1
Anne-Laure ANIZAN Lycée Balzac CPGE Lettres 2e année 27/06/2016
Histoire, BEL, concours 2017
Présentation des questions
Tronc commun
« L’Afrique, la France et les Français (1871-1962) »
Analyse des termes du sujet
Le sujet entend une mise en relation permanente des termes.
L’Afrique
= un continent
Tout le continent est-il au programme ? Non en toute logique avec l’intitulé de la question et
la lettre de cadrage : la partie de l’Afrique colonisée par la France
Autrement dit :
- En Afrique du nord, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc
- Une vaste partie de l’Afrique sub-saharienne, au sud du Sahara, Afrique en partie tropicale et
située à l’Ouest du continent, prenant le nom d’Afrique occidentale française (AOF)
- Des territoires de l’Afrique équatoriale regroupés sous le nom d’Afrique Équatoriale française
(AEF)
- Au large de l’Afrique, Madagascar et la Réunion également colonies françaises
Empire colonial français en Afrique = la partie la plus étendue de l’Empire colonial français
qui est alors le 2e au monde après l’Empire colonial britannique. Si la question porte
précisément sur l’Empire colonial français en Afrique, nécessité d’avoir bien sûr à l’esprit ce
qu’est le reste de l’Empire colonial français pour être capable de mettre en perspective
(Cochinchine, Annam, Tonkin, Laos, Cambodge, notamment). De même, là aussi pour mise en
perspective de la question, avoir quelques connaissances sur les grandes caractériques de
l’Empire colonial britannique.
La France
= sous-entendu l’État français
signifie qu’il faut étudier la politique coloniale menée officiellement par l’État français, par le
gouvernement de la Troisième, la Quatrième et la Cinquième Républiques.
D’ailleurs, la première des bornes chronologiques a surtout du sens par rapport à l’histoire
politique de la France, pas par rapport à l’histoire coloniale (ou alors seulement pour l’Algérie) :
1871 terminus a quo de la question, fin de la guerre franco-prussienne et début de la Troisième
République. Manière de dire : l’histoire faite ici est une histoire de la France coloniale
républicaine. Position de Napoléon III ne fait pas partie du sujet.
1962 terminus ad quem en lien avec la décision de l’État français de signer les Accords d’Évian
mettant fin à la guerre en Algérie et permettant l’indépendance.
Histoire profondément politique, tributaire, dans des régimes parlementaires, et même
parlementaristes, des débats des chambres, Chambre des députés et Sénat, puis Assemblée
nationale et Conseil de la République. Sous la Cinquième République passage à un régime
semi-présidentiel où l’exécutif est dominant, sans bien sûr que l’Assemblée nationale et le Sénat
n’aient de poids. À prendre en compte donc pour l’étude de la question, la faiblesse de l’exécutif
jusqu’en 1958, puis sa force jusqu’en 1962.
Cette politique coloniale française est décidée par les parlementaires et les gouvernants. Mais
leurs décisions sont influencées par l’action de lobbies, notamment du lobby colonial = le « parti

2
colonial », très important dans toutes les phases de la question. Il faudra donc aussi envisager
l’action de ceux qui ont influencé la politique menée par l’État français en Afrique.
Par ailleurs, le sujet s’inscrit dans le cadre des relations qu’entretient la France avec d’autres
États au sujet de la question des territoires à coloniser ou colonisés. Il peut s’agir d’États déjà
constitués en Afrique ou avec d’États européens. Il y a donc aussi une dimension relations
internationales, présente tout au long du programme, autant dans la phase de conquête, que dans
celle d’administration des territoires colonisés, ou encore dans la phase de décolonisation.
Les ruptures de la paix et les temps de guerre seront aussi étudiés. Rôle de l’Afrique très
important dans les périodes de guerre. L’État français a prévu, et mis en œuvre, la mobilisation
des colonies et cette mobilisation s’est avérée fondamentale pour l’effort de guerre pendant la
Première Guerre mondiale, puis dans l’émergence d’une France libre pendant la Seconde
Guerre mondiale et dans la libération de la France à partir de 1944.
Enfin, une partie du sujet porte sur l’attitude de l’État face aux contestations coloniales,
solutions proposées, imposées pour faire évoluer le statut colonial, parfois une évolution vers
l’autonomie comme préalable à l’indépendance, dans le cas de l’Algérie refus de l’évolution
qui conduit à la guerre coloniale appelée à l’époque par l’État français « opération de maintien
de l’ordre ».
Les Français
Ceux qui sont citoyens français
Le sujet => nécessité de réfléchir aux Français qui ont physiquement et par leur activité
professionnelle permis la colonisation, conquête puis quotidien de la colonisation. Intérêt pour
les 5M qui sont à la base de la colonisation
- le militaire = conquête et maintien de l’ordre,
- le mécanicien, autrement dit l’ingénieur, chargé de faire les plans des routes, des ports, des
voies ferrées, de diriger les grands chantiers
- le marchand,
- le médecin,
- le missionnaire = le chrétien, prêtre catholique ou pasteur protestant ayant mené des missions
en Afrique, d’évangélisation, puis pour soigner les populations et les instruire.
Parmi ceux-là, certains, des familles entières parfois, s’installent définitivement dans les
colonies. Étude bien entendu du monde des colons, tout particulièrement dans le cas de la seule
colonie de peuplement française, l’Algérie.
Plus généralement, les Français renvoient à ceux qui restent en France et qui n’ont pas de liens
directs avec les colonies. Intérêt pour le rapport de l’opinion publique à la colonisation de
l’Afrique. Toutes les gammes évidemment de ressentis, hostilité, indifférence, adhésion,
militantisme en faveur ou contre la colonisation. L’évolution de l’opinion n’est pas spontanée
le lobby colonial joue un rôle majeur, les médias, la presse puis aussi le cinéma, les partis
politiques, les associations types syndicats ou Ligue des droits de l’homme.
Apogée de la domination coloniale française, l’exposition coloniale de 1931 permet de voir
quelle image de la colonisation l’État entend diffuser, comment les défenseurs de la
colonisation interviennent, comment la population française réagit à la colonisation, la distance
aussi entre le mythe et la réalité.
Quid du ressenti des Africains ? Comme le sujet et la lettre de cadrage insistent bien sur la
France et les Français, on évoquera le ressenti des Africains indirectement en tant que réaction
à la politique menée par la France, mais ce ne sera pas un sujet à proprement parler du cours.

3
Problématiques auxquelles on répondra tout au long du cours :
Quelles ont été les causes de la colonisation de l’Afrique par la France ?
Comment la France a-t-elle conquis puis administré une partie de l’Afrique ?
Comment l’opinion publique française a-t-elle réagi face à la colonisation de l’Afrique ?
Comme les Africains ont-ils réagi face à la colonisation de l’Afrique par la France ?
Quel a été le coût, humain, financier, plus largement économique, de la colonisation pour la
France et pour l’Afrique ?
Comment la colonisation de l’Afrique a-t-elle contribué à faire de la France une grande
puissance de la fin du XIXe siècle aux années 1960 ?
Dans quelle mesure la colonisation de l’Afrique a-t-elle nui à l’image de la France dans le
monde ?
En quoi la colonisation de l’Afrique a-t-elle été un élément décisif pour la victoire de la France
lors des deux guerres mondiales ?
Quelles ont été les voix et les voies françaises et africaines de la contestation du colonialisme
français en Afrique ?
Comme l’État français et l’opinion publique française ont-ils réagi face aux contestations
coloniales ?
Pourquoi la réponse à la contestation coloniale n’a-t-elle pas été identique pour chaque territoire
colonisé par la France ?
En quoi les relations entre la France et l’Afrique sont-elles demeurées profondément marquées
par les décennies voire, pour l’Algérie, par 130 ans, de colonisation ?
En quoi la société française et les sociétés africaines sont-elles demeurées profondément
marquées par les décennies voire, pour l’Algérie, par 130 ans de colonisation ?
Spécialité
Question « La Guerre de Cent ans (1328-1453) »
Traité au premier semestre.
Sujet portant sur deux pays, la France et l’Angleterre et à la fin du Moyen-Âge, pendant donc
le bas Moyen-Âge
Analyse des termes du sujet
La Guerre
Étude des aspects militaires de la guerre, essentiel.
Connaître les phases du conflit, les batailles, les sièges importants, les principales trêves, les
grandes figures militaires.
Connaître les mutations de l’armement et des formes de la guerre (batailles, sièges,
chevauchées),
aussi les problèmes de recrutement et d’encadrement des combattants et la progressive
professionnalisation du métier des armes.
De Cent ans
Mais pas seulement les aspects purement militaires, d’où notamment les bornes chronologiques
plus larges
La guerre débute en 1337, mais le programme commence en 1328, pourquoi ? Lettre de cadrage
précise nécessité de connaître les conditions d’accès au trône de Philippe de Valois et donc
d’étudier aussi les origines de la guerre qui expliquent sa durée tout à fait inhabituelle.

4
Par ailleurs, la lettre de cadrage insiste sur les conséquences majeures de la guerre parce qu’elle
a duré si longtemps, conséquences démographiques (mortalité, déplacements de populations),
perturbations dans le monde rural et urbain, réaction et adaptation de ces mondes.
Compte tenu de la durée de la Guerre de Cent ans, le problème de son financement s’avère très
important (paiement des soldes, développement d’une fiscalité royale).
Conséquence aussi de l’enlisement dans la guerre => développement de l’État
Nouvelles formes de solidarité dans le contexte de la guerre (ordres de chevalerie, renforcement
d’une conscience nationale).
Donc un événement guerrier à mettre en perspective historique pour montrer son rôle et sa place
dans l’évolution des deux pays et de leurs relations.
Question
« Rome et Carthage,
du premier traité romano-punique
à la fondation de la Colonia Iulia Concordia Karthago (Ve-Ier siècle avant J.-C.) »
Analyse des termes du sujet
Rome et Carthage
Étude des deux États, de deux cités-États dirigeant chacune un Empire colonial, mais étude des
liens entre elles, pas question de faire une étude de Rome indépendamment de ses liens avec
Carthage et vice-versa
du premier traité romano-punique à la fondation de la Colonia Iulia Concordia Karthago
(Ve-Ier siècle avant J.-C.)
Bien sûr, les guerres puniques (puniques synonymes de carthaginois), 3 guerres puniques
opposant Rome et Carthage, rivales à propos de la Sicile que Carthage initialement dominait en
partie. Guerres s’étalant sur près d’un siècle en 3 épisodes, première guerre punique 264-241
avant J.-C., deuxième guerre punique 218-201 avant J.-C. (Hannibal), troisième guerre punique
149-146 avant J.-C. 146 = siège de Carthage, chute et destruction de Carthage.
mais = une petite partie du sujet seulement
Bornes chronologiques du sujet beaucoup plus vastes que cette période de cent ans parce que
traitement des relations entre les deux cités-États n’est pas envisagé que selon l’angle de
l’histoire militaire.
Au centre de la question, leurs relations avant les guerres puniques et après les guerres puniques,
quand Carthage n’existe plus en tant qu’État et que sur la ville punique rasée construction d’une
cité romaine Colonia Iulia Concordia Karthago capitale de la nouvelle province d’Afrique.
Quels types de relations ? Économiques = essentiel. Culturelles aussi. Question de l’hybridation
culturelle ou du simple transfert culturel au cœur du sujet, notamment dans la construction de
la nouvelle ville de Carthage qui permet d’implanter dans le nord de l’Afrique une cité
typiquement romaine.
1
/
4
100%