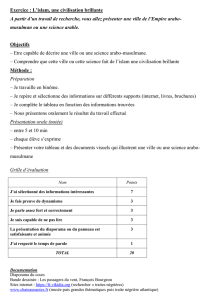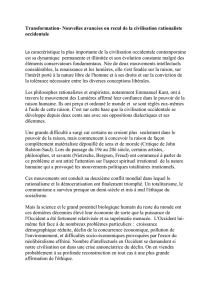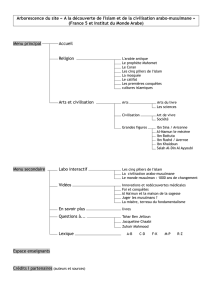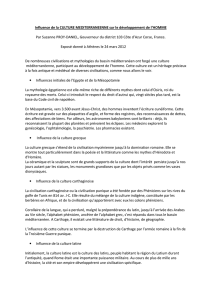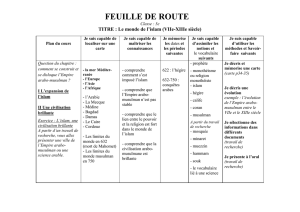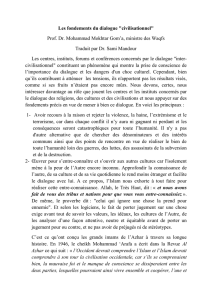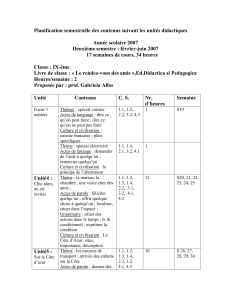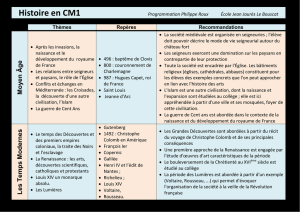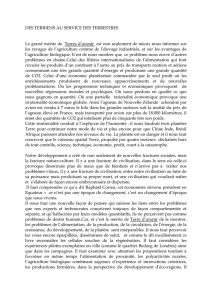petite histoire des grandes civilisations

Vahé Zartarian
les grandes civilisations d’aujourd’hui
Occident, Islam, Chine, Inde

préface à la seconde édition
En abordant le vaste sujet des civilisations, mon ambition était d’entrevoir l’évolution
de la conscience humaine à travers cette variété de croyances et d’expériences.
Travail que je n’ai pas mené à son terme, je l’avoue. Cela tient en partie à l’attitude
de l’éditeur. Pour tout dire, l’ouvrage est épuisé depuis plusieurs mois, depuis au
moins le dernier trimestre 2009. J’ai bien sûr voulu savoir ce qu’il envisageait de
faire. Quelques échanges de courriers ont permis au moins d’éclaircir ce point :
l’éditeur n’est pas du tout décidé à refaire un tirage. Alors pour aller au plus simple et
afin d’honorer mon contrat moral envers mes lecteurs, j’ai décidé de mettre le livre
sous forme numérique en libre accès sur le web.
Il va sans dire que ces péripéties n’enlèvent rien à la qualité de cet ouvrage. Preuve
en est que s’il est épuisé, c’est qu’il a rencontré son public !
Et puis même si j’ai en tête un autre livre qui irait plus loin dans l’exploration de
l’aventure terrestre de l’homme à travers ses systèmes de croyances, celui-ci n’est
pas pour autant un brouillon. C’est plutôt un socle sur lequel il viendrait s’appuyer. Il
garde toute sa valeur et son actualité, indépendamment du fait que j’achève ce
travail complémentaire si un éditeur se montre intéressé… Ceci dit juste pour
expliquer un certain côté inachevé du présent ouvrage, de mon point de vue du
moins.
Pour remercier mes lecteurs d’avoir attendu plusieurs mois cette réédition, j’ai réalisé
quelques cartes qui aident à visualiser certaines histoires.
Un dernier mot avant de vous laisser à votre lecture : si vous voulez contribuer à
l’existence d’une recherche indépendante, rendez-vous sur mon site à la page
CONTACT
www.co-creation.net
Chaudon, juin 2010
Vahé

sommaire
prologue.......................................................................................................................1
la civilisation................................................................................................................4
la Vision, fondement de la civilisation........................................................................4
la trajectoire d’une civilisation....................................................................................5
entrée en matière.....................................................................................................16
l’Occident, la civilisation chrétienne, Ve-XIVe siècles..........................................17
point de départ.........................................................................................................17
l’abîme, Ve-VIIe siècles...........................................................................................18
la montée du christianisme......................................................................................19
la renaissance..........................................................................................................22
consolidation des bases, Xe siècle..........................................................................23
croissance, XIe - XIIe siècles...................................................................................27
l’apogée, XIIIe siècle................................................................................................30
la chute, XIVe siècle................................................................................................35
l’Occident, transition entre deux civilisations, XVe-XVIIIe siècles......................38
la Renaissance........................................................................................................38
l’Europe classique....................................................................................................48
l’Europe des Lumières.............................................................................................53
la Vision mécaniste...................................................................................................59
naissance d’une vision.............................................................................................59
les fondateurs..........................................................................................................60
la société mécaniste................................................................................................65
de la Vision à la civilisation......................................................................................70
l’Occident, la civilisation mécaniste, XIXe-XXIe siècles........................................71
genèse et croissance, 1780-1914...........................................................................71
le temps des difficultés, 1914-1945.........................................................................80
la grande envolée des Trente Glorieuses................................................................86
le déclin....................................................................................................................88

entracte.......................................................................................................................92
la civilisation islamique............................................................................................93
la Vision islamique...................................................................................................93
l’histoire de la civilisation islamique.........................................................................99
conclusion..............................................................................................................110
la civilisation chinoise ...........................................................................................111
les Visions chinoises..............................................................................................111
l’histoire de la civilisation chinoise.........................................................................118
le confucianisme, et après ?..................................................................................133
la civilisation indienne............................................................................................135
la Vision : les religions...........................................................................................135
la Vision : varnas et jatis, une société de classes et de castes.............................143
l’histoire de la civilisation indienne.........................................................................148
épilogue....................................................................................................................161
quelques lectures....................................................................................................163
du même auteur.......................................................................................................164

prologue
De 1980 à 1982 j’étais étudiant à l’Institut Supérieur des Affaires. J’ai eu la chance
d’intégrer une promotion qui comprenait de nombreux élèves étrangers, et de faire
ma spécialisation en affaires internationales avec Joseph le Bihan. Il avait le talent
de mettre en contact des gens du monde entier, il était abonné à des revues de tous
les continents, et disposait d’une bibliothèque très fournie en livres de géostratégie,
histoire, aussi bien que psychologie ou épistémologie. Là, puis ailleurs, j’ai côtoyé et
travaillé avec des libanais, des égyptiens, des iraniens, algériens, sénégalais,
camerounais, colombiens, mexicains, américains, canadiens, japonais, coréens,
chinois, thaïlandais, vietnamiens, … j’en oublie certainement. Après les années
précédentes passées à ne faire pratiquement que des maths et de la physique en
classes préparatoires puis à l’école polytechnique, le monde prenait soudain une
dimension nouvelle. Il n’était plus fait d’atomes de matière mus par des forces
physiques mais d’êtres humains animés par des croyances. J’étais avide
d’apprendre et de comprendre. Mais je me suis vite rendu compte que ce n’était pas
si simple, même si ma double culture arménienne et française m’avait doté d’une
relative ouverture et souplesse d’esprit. Derrière le rôle que chacun semblait jouer de
son mieux, de l’étudiant étranger parlant français et venu apprendre le "business" à
l’occidentale, je sentais des divergences de vue profondes touchant l’homme et le
monde. Une anecdote m’est restée :
Il y avait dans ma promotion deux étudiants sénégalais, dont l’un m’étais assez
proche. À force d’observer leurs regards qui se fuyaient et leurs manœuvres
d’évitement, je ne pus me retenir de lui demander ce qui n’allait pas entre eux. La
réponse tomba, simple et sans détour : ils n’appartenaient pas à la même tribu ! Lui
était membre d’une tribu musulmane de l’intérieur du pays, et l’autre d’une tribu
animiste de je ne sais plus quelle partie du Sénégal. Pour lui ça expliquait tout ; pour
moi ça compliquait tout.
J’ai découvert aussi l’inimitié profonde des coréens à l’encontre des japonais, j’ai
rencontré l’esprit du sabre japonais et la belle simplicité du zen, j’ai découvert la
patience, la profondeur et la subtilité des chinois, j’ai rencontré des africains qui
parlaient français mieux que moi et connaissaient mieux aussi l’histoire de France…,
bref, je me suis aussi découvert dans ce que tous me renvoyaient en miroir de ma
propre culture.
Dans l’ensemble, j’ai rencontré peu de personnes connaissant l’histoire des autres
peuples ; et quand ils connaissaient la leur, c’était presque toujours de manière
superficielle. J’étais moi-même dans ce cas. Des leçons d’histoire et de géographie
apprises à l’école, il ne restait pas grand chose. Il faut dire que ces matières étaient
enseignées en dépit du bon sens. Aucune signification n’émergeait de l’accumulation
de dates, de personnages, de villes, de frontières fluctuantes, etc. J’étais donc sans
trop d’idées préconçues, mu par le désir de saisir quelques unes des grandes forces
qui inspirent les pensées et les actions des hommes, individuellement et
collectivement.
Il m’a fallu vite déchanter : je me suis retrouvé devant un immense océan de
données impossible à organiser. De fait, on observe en histoire la même tendance à
la fragmentation que dans les autres sciences. Certes, il n’est pas inintéressant de
1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
1
/
168
100%