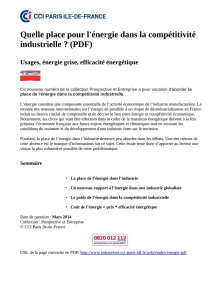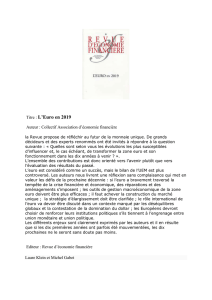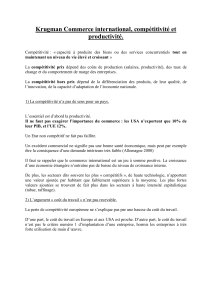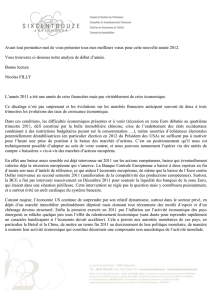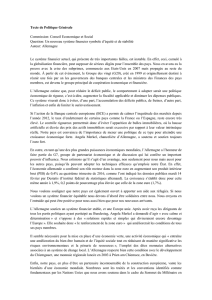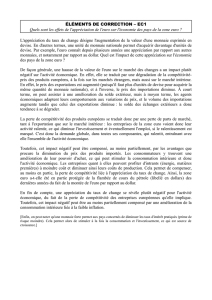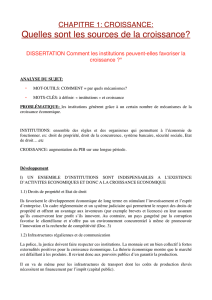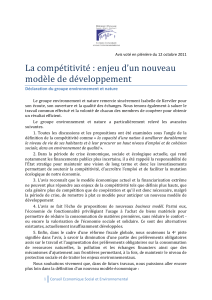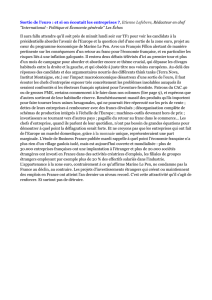Économie

Économie
Une composition de sciences économiques.
SUJET : La compétitivité des économies nationales au sein de la
zone euro.

Copie notée : 14,5/20
Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi (PCCE) présenté par
l’ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault, ainsi que le rapport Gallois sur l’industrie,
officialisent un constat d’urgence : le décrochage industriel de la France et sa perte de
compétitivité. Le pays se trouve, aujourd’hui, dans une position délicate par exemple
dans le classement international 2012-2013 sur la compétitivité du World Economic
Forum (WEF), la France a reculé de la 18è à la 21è place (sur un total de 144 pays
étudiés). Le risque s’accroît, en effet, d’une prise en tenaille entre une Europe du Nord
toujours compétitive et une Europe du Sud qui le devient. Dans une note sur la
compétitivité des pays au sein de la zone euro, Patrick Artus, Economiste chez Natixis
montre qu’en matière de compétitivité on peut distinguer deux groupes de pays au sein
de la zone euro : d’un côté les pays où l’industrie continue de progresser (Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique...) et qui restent compétitifs, d’un autre côté, les pays dans
lesquels l’industrie regresse (notamment, la France, l’Italie, l’Espagne) et dont l’économie
n’est plus compétitive.
Notion économique controversée, dénoncée par le Prix Nobel d’économie Paul Krugman
dans les années 1990 comme une « dangereuse obsession », la compétitivité est
omniprésente dans le débat public français : Il fût l’un des thèmes centraux de la
campagne électorale de 2012, puis du nouveau gouvernement. La compétitivité d’un
pays, d’une entreprise ou d’un secteur, est la capacité à faire face à la concurrence
effective ou potentielle sur les marchés tant externes qu’internes. Elle comporte deux
dimensions : la compétitivité-prix et la compétitivité hors-prix.
Quels facteurs permettent d’expliquer le décrochage compétitif de certaines économies
nationales au sein de la zone euro ? Et, comment peuvent-elles regagner des parts de
marché mondial ? Tous les indicateurs le montrent : au sein de la zone euro, l’industrie
régresse dans certains pays, et le mouvement semble s’accélérer (I). Pour redevenir
compétitif, certains pays de la zone euro doivent faire des efforts et manifester une
grande persévérance dans l’action (II).
I. Le décrochage industriel dans certains pays de la zone euro est le signe d’une
perte globale de leur compétitivité économique
Comparée à l’Allemagne, l’économie Française, Italienne, Espagnole etc, montrent des
signes de faiblesses. Des facteurs structurelles, conjoncturelles, voire culturelles
permettent d’expliquer le décrochage compétitif de la France par rapport à l’Allemagne
(A) d’une part. D’autre part, cette perte de compétitivité s’explique aussi par une position
exportatrice qui s’effrite en France et dans les autres pays de la zone euro (B).
A. Des causes structurelles, conjoncturelles, voire culturelles expliquent le
décrochage compétitif de certains pays de la zone euro par rapport à
l’Allemagne
Plusieurs études montrent que certains pays de la zone euro décrochent par rapport à
l’Allemagne. Ainsi, l’économie française décroche depuis plus de dix ans par rapport à
son voisin d’Outre Rhin. Selon une étude réalisée par Coe-Rexecode en 2011 auprès des
importateurs européens, la France a perdu son avantage prix par rapport à la qualité
« made in Germany ». Cela est du à des choix de politiques économiques opposées entre
ses deux pays.
Ainsi grâce à une politique de modération salariale, de baisse de charges de cotisations
sociales, de réforme du marché du travail, introduit par l’ancien chancelier Gerhard

Chroëder, puis poursuivie par Angela Merckel, l’Allemagne a, en effet, pu regagner des
parts de marchés pendant que ses principaux concurrents européens en ont perdu.
C’est ainsi qu’en 2007, la chancelière avait décidé une hausse de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 3 % en échange d’une baisse de cotisations sociales patronales. Ce
dernier est souvent cité dans le débat public français en faveur d’un « pacte de
compétitivité » en contrepartie d’une hausse de la TVA dite « sociale » ou en faveur
d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).
En France, l’industrie a reculé par rapport au secteur des services marchands. Ainsi de
1980 à 2007, elle a perdue près de 36% de ses effectifs, soit environ 2 millions d’emplois
et ne contribue plus qu’à hauteur de 12,5% au produit intérieur brut (PIB) en 2007
contre 24% du PIB en 1980. Cette désindustrialisation repose sur plusieurs facteurs : les
délocalisations, le renforcement de la concurrence étrangère, le transfert de certaines
activités de l’industrie vers les services (exemple l’informatique, la comptabilité…), mais
aussi elle est due à des politiques fiscales, sociales et d’éducation qui y contribuent
également.
B. Le décrochage compétitif de certains pays résulte aussi de leur position
exportatrice qui s’effrite et d’un effet euro handicapant
Le déficit important des échanges extérieurs de la France et de certains pays de la zone
euro (Italie, Espagne…), est présenté comme le principal symptôme de la perte de
compétitivité en France et dans ces autres pays. Ainsi en 2011, pendant que l’Allemagne
a enregistré un solde excédentaire de près de 200 milliards d’euros, la France présente
un déficit de plus de 74 milliards d’euros, soit près de 3,7 % du produit intérieur brut
(PIB) contre un excédent de + 4 milliards en 2002, soit 0,2% un record.
La hausse du coût des matières énergétiques, celle de l’euro, et le renforcement de la
compétitivité allemande avec une économie tournée vers l’extérieur sont les causes
conjoncturelles. Mais elle a aussi des causes structurelles. Ainsi depuis plusieurs années
les performances de l’économie française par rapport aux autres pays de la zone euro en
matière d’exportation sont faibles.
Seules 5% des entreprises françaises exportent, pénalisés par des effets de taille, la
majorité des entreprises françaises n’exportent pas. Ceux qui exportent vers l’étranger
représentent 4 à 5% du total (95000 en 2010 contre 113500 en 2011). Or les
entreprises exportatrices sont celles qui emploient plus de salariés, versent de hauts
salaires sont plus rentables et plus productives.
L’évolution de l’euro a eu des effets contrastés pour les économies de la zone euro. Après
une phase de baisse en 1999, la monnaie unique prend de la valeur depuis 2002.
Pénalisant ainsi les exportateurs européens. En effet, les fluctuations du cours de l’euro
ont un impact direct sur les prix des biens et services échangés.
II. Pour reconquérir leur compétitivité, les pays de la zone euro doivent faire
des efforts et manifester une grande persévérance dans l’action
Pour regagner des parts de marchés mondiaux, les pays de la zone euro doivent
mobiliser le moteur de la productivité (A) et faire des réformes (B).
A. Pour regagner des parts de marché, les pays doivent mobiliser le moteur de la
productivité
La compétitivité est influencée par la productivité (rapport entre la production et les
facteurs utilisés pour produire, travail, capital), mais aussi le coût ou la durée du travail.
La France est l’un des pays où la productivité du travail (quantité produite rapportée à la
quantité de travail qu’elle nécessite) est parmi les plus élevée du monde. Mais le gain de

productivité globale est faible, guère + 1% par an contre + 2% par an en Allemagne par
exemple.
Les entreprises allemandes exportent 2,5 fois plus que les françaises, ce qui permet à
l’Allemagne de maintenir ses parts de marché à des niveaux élevés au niveau mondial.
Cette réussite allemande par rapport aux autres pays de la zone euro repose d’abord sur
le fait que la mondialisation est liée au fait que les industries allemandes se sont
fortement spécialisées dans des secteurs de haute technologies, de la chimie, de
machines-outils, de biens d’équipements, en gros les secteurs dans lesquels la
mondialisation s’est faite. Ensuite, le cercle vertueux des investissements allemands à
l’étranger notamment dans les pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), avec de
faibles coûts de main d’œuvre, soutiennent la force exportatrice allemande. Mais elle a
aussi des causes structurelles. Enfin, l’organisation décentralisée de l’économie et de la
structure de management contribuent également à cette réussite de l’économie
allemande par rapport à ses voisines européennes.
Les pays de la zone euro pourraient augmenter leur productivité et rattraper leur retard
par rapport à l’Allemagne, en mettant en place de véritables politiques publiques visant à
fluidifier les marchés de biens et du travail. Ainsi de nombreuses petites entreprises
seront ainsi incitées à devenir les entreprises à tailles intermédiaires (E.T.I.) réputés plus
dynamiques sur le marché à l’export.
B. Les pays doivent faire des réformes
Pour certains le regain de dynamisme nécessite des réformes en matière de fiscalité, du
marché du travail, du financement des entreprises, mais aussi en matière éducative afin
d’élever le niveau de formation de la population en âge de travailler. Des voix se lèvent
au sein de la zone euro pour exiger plus de coordination des politiques économiques
mises en œuvre au sein de la zone euro. Certains veulent une harmonisation fiscale, un
salaire minimum européen.
Depuis plusieurs mois, les différents gouvernements au sein de la zone euro ont engagé
des actions dans le but de redonner à leur économie de la compétitivité. C’est ainsi qu’en
France des réformes ont été entreprises pour permettre aux entreprises de redevenir
compétitives. L’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013 vise à permettre
un meilleur fonctionnement du marché du travail. Le « Pacte de compétitivité » avec sa
pièce maîtresse le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) doit permettre
aux entreprises de réduire leurs charges et redevenir compétitives. La Banque publique
d’investissement créée dans le cadre du « pacte de compétitivité » doit aider les
entreprises en difficultés de financement, elle permet de financer d’ores et déjà CICE. Le
Président de la république a annoncé la mise en place d’un « pacte de responsabilité et
de solidarité » qui doit permettre de baisser les charges des entreprises en complément
du CICE et d’un montant de 10 milliards d’euros supplémentaires aux 20 milliards
d’euros prévus par le CICE.
Ses mesures seront-elles suffisantes ? La reconquête de la compétitivité nécessite sans
doute d’autres réformes d’envergure : développer l’économie de l’offre, par l’ouverture à
la concurrence de certains secteurs non ouvert à la concurrence. Réformer le
financement de la protection sociale, mettre en œuvre une véritable transition
énergétique.
En France, comme dans la plupart des pays de la zone euro, les débats se sont
cristallisés autour de la capacité des entreprises localisées au sein de la zone euro à
exporter. Cette focalisation est légitime. Parmi les éléments de diagnostic de la
compétitivité, c’est bien le dynamisme des exportations qui s’est le plus dégradé dans la
plupart des pays au sein de la zone euro. Ainsi des études comparatives montrent que au

sein de la zone euro, deux groupes de pays peuvent être distingués : d’un côté des pays
dont les industries continuent de progresser et sont donc compétitifs plus que les autres,
de l’autre, des pays dans lesquels les industries reculent et dont la compétitivité de
l’économie régresse.
Pour reconquérir leur compétitivité, certains pays de la zone euro doivent faire des
efforts et manifester une grande persévérance de l’action. Des voix se lèvent pour
réclamer une harmonisation des politiques publiques au sein de la zone euro.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%