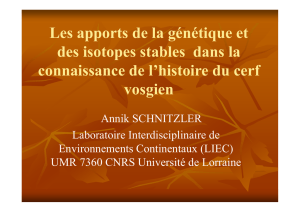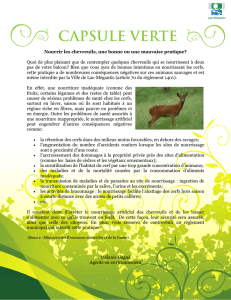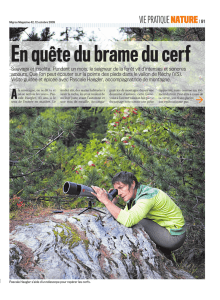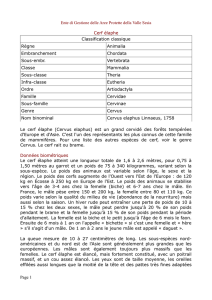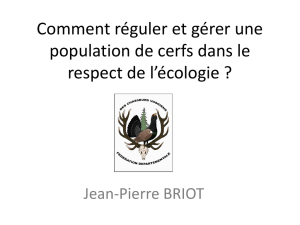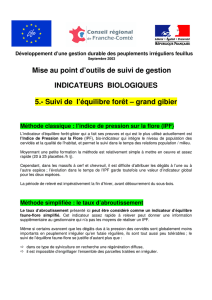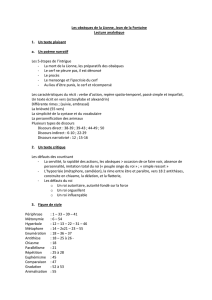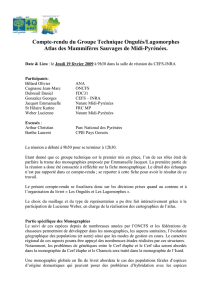La gestion des espèces introduites sur l`archipel de Saint

Cervidés - sanglier
Exemple d’études et de recherche
ONCFS IIII RAPPORT SCIENTIFIQUE 2010 31
La gestion des espèces introduites sur l’archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Un troisième indicateur concerne l’impact des animaux sur leur
environnement et repose sur le recueil d’indices de consommation
et d’abroutissement (figure 2). Les mesures sont réalisées sur
environ 400 placettes réparties sur les îles de Miquelon, Langlade
et le Cap Miquelon, selon un solide dispositif d’échantillonnage.
Depuis plusieurs années, les milieux naturels de l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont en état d’équilibre précaire en partie
à cause de l’impact de deux espèces introduites : le cerf de Virginie
(Odocoileus virgianus) et le lièvre d’Amérique (Lepus americanus).
Devant cette situation le Conseil territorial et les administrations
locales ont missionné en 2008 un groupe d’experts franco-québécois
qui a proposé pour ces deux espèces de solides outils de gestion
intégrée forêt-gibier. Une des principales propositions retenue porte
sur la connaissance de l’évolution temporelle de la relation entre la
population de cerfs et les peuplements forestiers de l’archipel, dans
le cadre d’une gestion adaptative basée sur des indicateurs de
changement écologique. En 2009, une batterie d’indicateurs a été
mise en place par l’ONCFS en collaboration étroite avec les agents
de la Fédération des chasseurs.
Le suivi annuel de l’abondance de la population de cerfs à partir
d’Indices ponctuels d’abondance (IPA) montre, d’une part, que
les cerfs sont plus nombreux sur l’île de Langlade qu’à Miquelon
(figure 1) et, d’autre part, que deux périodes historiques peuvent
être définies. La période 1996-2005 se caractérise par une méthode
de comptage limitée à une seule répétition et des mesures de
prélèvements restreintes (0,5 cerf par chasseur). Celle comprise
entre 2006 et 2010 par un protocole de comptage plus robuste
(jusqu’à 4 répétitions) et des mesures de prélèvements plus impor-
tantes (0,75 cerf par chasseur de 2006 à 2007, puis 1 cerf par
chasseur en 2008, 2009 et 2010). Les données recueillies par les
chasseurs locaux portent essentiellement sur la masse corporelle
des jeunes animaux. L’analyse des données ne montre aucune varia-
tion entre les 3 années pour les deux sexes confondus (p = 0,57).
Figure 1.
Nombre moyen de cerfs observés lors des comptages organisés
entre 1996 et 2010 sur Langlade et Miquelon.
70
60
50
40
30
20
10
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nombre moyen de cerfs vus
Langlade Miquelon
Figure 2.
Indices d’abroutissement (IA) moyens relevés sur les semis des
3 îles réunies.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
- 0,2
IA sapin
2009
IA sapin
2010
IA bouleau
2009
IA bouleau
2010
IA épinette
noire 2009
IA épinette
noire 2010
IA épinette
blanche 2009
IA sorbier
2009
IA sorbier
2010
IA épinette
blanche 2010
Indice d’abroutissement
Figure 3.
Comparaison entre la probabilité de consommation des cerfs et
des lièvres sur les sapins baumier, sorbier et bouleau à papier des 3 îles.
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
cerfs cap
miquelon 2009
lièvre cap
miquelon 2009
cerfs Langlade 2009
lièvres Langlade 2009
cerfs Miquelon 2009
lièvres Miquelon 2009
cerfs cap
Miquelon 2010
lièvres cap
Miquelon 2010
cerfs cap
Miquelon 2010
cerfs Langlade 2010
lièvres Langlade 2010
cerfs Miquelon 2010
lièvres Miquelon 2010
Probabilité de consommation
Les relevés opérés entre 2009 et 2010 montrent que l’impact du
cerf sur la régénération forestière et les essences ligneuses et
semi-ligneuses est plus important que celui du lièvre (figure 3). Par
ailleurs c’est sur l’île de Langlade que la pression des deux
herbivores est la plus forte. Enfin, les résultats indiquent une réduction
de la consommation par les deux espèces entre 2009 et 2010.
La connaissance du fonctionnement de l’ensemble de ces indica-
teurs permettra, dans la mesure où un suivi sur plusieurs années
est réalisé, de déterminer l’évolution de la relation entre les herbivores
et leur habitat. À partir de ces informations, des directives de
gestion pourront être affichées selon les objectifs fixés, en particulier
celui concernant la restauration des « boisés » de l’archipel.
Toutefois, les données issues des « comptages » et des relevés
d’abroutissement indiquent déjà que les prochains prélèvements
de cerfs et de lièvres devraient être largement supérieurs à ceux
pratiqués ces dernières années. En effet, si les trois familles
d’indicateurs traduisent une certaine stabilité de l’impact de la
population de cerfs sur la forêt, son niveau reste très élevé et la
chasse demeure le seul levier disponible pour réduire ces dégâts.
© J. Michalet/ONCFS
1
/
1
100%