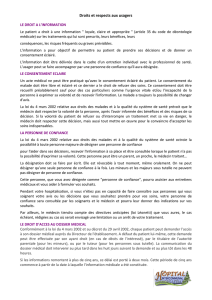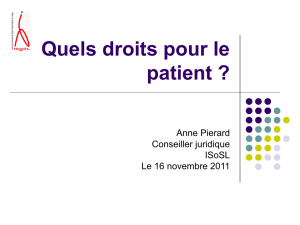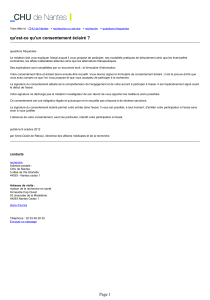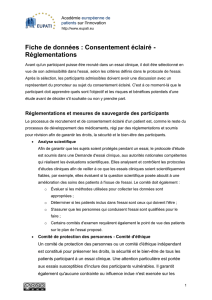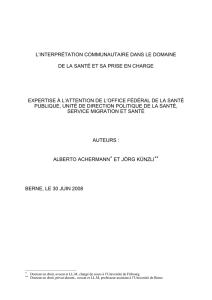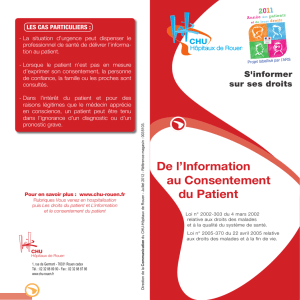Le consentement éclairé

© 2003 Groupe ENCON inc.
HC-LCB-1-F Juillet 2003
Le consentement éclairé
par Mes Sophie Barabé et Carolena Gordon,
Nicholl Paskell-Mede
Jusqu’à la fin des années 1970, la relation entre le
patient et le professionnel de la santé était teintée de
paternalisme. En 1980, la Cour suprême du Canada
a rendu deux décisions qui ont transformé la
dynamique du rapport entre le patient et les divers
professionnels de la santé. L’approche « moderne »
est principalement axée sur l’autonomie du patient et
fondée sur le concept du « consentement éclairé ».
Le corollaire de cette nouvelle approche est que le
professionnel de la santé a l’obligation d’informer
adéquatement son patient et de lui fournir des
renseignements suffisants et compréhensibles afin de
lui permettre de prendre une décision éclairée quant
à son traitement. Le consentement éclairé ne se limite
pas au respect d’exigences administratives. Il s’agit
plutôt d’un processus allant au-delà d’une question
purement médicale ou technique, qui fait appel au
droit du patient d’accepter ou de refuser un
traitement. Lorsque ce processus a été bien suivi et
documenté, l’autonomie et l’intégrité physique du
patient sont mieux protégées et le professionnel est
mieux placé, d’un point de vue juridique, si le
traitement proposé tourne mal.
Parce que le consentement éclairé est devenu un
aspect incontournable du rapport entre le patient et le
professionnel de la santé et qu’il a été soulevé dans un
grand nombre de poursuites contre des professionnels
de la santé, il est important de passer en revue
certaines des conditions entourant l’obligation
d’obtenir le consentement éclairé du patient ainsi que
les circonstances dans lesquelles cette exigence
pourrait être contournée.
Processus relatif au consentement éclairé
Capacité juridique de donner son consentement
Ce concept soulève la question à savoir si une personne
est capable ou non, d’un point de vue juridique, de
consentir valablement à un traitement ou de le
refuser. En règle générale, on présume que toutes les
personnes ont la capacité juridique de donner leur
consentement.
Dans certaines circonstances spécifiques, toutefois, la
capacité de donner ou de refuser son consentement
peut être retirée ou limitée par la loi. C’est le cas des
mineurs dans une certaine mesure, et c’est la
législation provinciale qui détermine la mesure dans
laquelle un mineur a la capacité juridique de
consentir à un traitement ou de le refuser, ainsi que
les modalités du consentement substitué dans chaque
cas. Un autre exemple est le cas des maladies
transmissibles, sujet que nous aborderons plus en
détail plus loin dans le texte.
La capacité juridique d’une personne de donner un
consentement valable peut également être retirée
ou limitée au moyen d’une ordonnance judiciaire
expresse. Néanmoins, ce n’est pas parce qu’une
personne est sous un régime de protection qu’elle ne
possède nécessairement plus la capacité juridique
de consentir à un traitement. Les dispositions précises
de la loi applicable et les documents attestant la
tutelle ou la curatelle sont les meilleures sources de
renseignements permettant de déterminer si le
patient a toujours le pouvoir de consentir au
traitement proposé ou si un consentement substitué
devra être obtenu de la personne désignée à cet effet.
➢
Bulletin no1
Juillet 2003
Groupe ENCON inc.
700 - 350, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1R 1A4
Téléphone 613-786-2000
Télécopieur 613-786-2001
Sans frais 800-267-6684
www.encon.ca Bulletin
Information Prévention
Note : L’usage exclusif
du masculin dans le
texte ne vise qu’à alléger
celui-ci. Les mots de
genre masculin
appliqués aux personnes
désignent les hommes
et les femmes.
Sophie Barabé et Carolena
Gordon sont respectivement
avocate et associée au
sein du cabinet juridique
Nicholl Paskell-Mede
(NPM), œuvrant dans le
domaine de l’assurance et
de la responsabilité
professionnelle. Depuis la
création du cabinet en 1992,
les services de NPM sont
fréquemment retenus par
ENCON pour la défense
de professionnels. NPM a
acquis une expérience
considérable dans la défense
d’actions en responsabilité
professionnelle intentées
contre des professionnels
de la santé et a présenté
des conférences traitant de
la question du consentement
éclairé devant des
professionnels de la santé
et autres personnes
œuvrant dans ce domaine.

Le consentement éclairé
À tout événement, il semble y avoir un certain
consensus entre les deux traditions juridiques à l’effet
que les renseignements faisant partie d’une divulgation
adéquate pour l’obtention d’un consentement éclairé
pourraient comprendre :
1. Le diagnostic
2. La nature et les objectifs du traitement proposé
3. L’identité de la ou des personnes qui dispenseront
le traitement
4. Les risques et bienfaits probables associés au
traitement proposé, ce qui comprend la possibilité
d’un préjudice grave ou d’un décès, et les risques
rares ou généralement connus, s’ils sont
particuliers au patient. La gravité et la fréquence
associées au risque peuvent être utilisées comme
critères pour guider le professionnel de la santé
dans sa décision de divulguer ou non le risque
5. Des procédures médicales ou chirurgicales
alternatives raisonnables (le cas échéant) et les
risques qui y sont associés
6. Le risque associé au refus de toute procédure
diagnostique ou de tout traitement
7. L’incidence possible sur le style de vie du patient,
de même que certaines considérations
économiques potentielles3.
Il n’existe toutefois pas d’obligation de divulguer tous
les risques possibles car cela serait contraire à la
réalité médicale. De plus, l’étendue de l’obligation de
divulguer varie selon la nature de l’intervention
proposée (traitement thérapeutique par rapport à
expérimental ou facultatif) et selon la compréhension
et les connaissances du patient. La divulgation
notamment des antécédents médicaux, de la
condition, des allergies et des maladies du patient
permet de centrer les explications et l’évaluation des
risques sur sa situation particulière. En outre, un
langage simple et compréhensible facilite la
communication. Enfin, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, que les patients aient le temps de
digérer l’information fournie et aient l’opportunité
de poser des questions.
Capacité mentale de donner son consentement
Ce concept renvoie à la capacité de fait, pour une
personne normalement considérée capable sur le
plan juridique, de consentir valablement à un
traitement. La détermination de l’état mental d’une
personne ainsi que de sa capacité mentale de donner
son consentement est fondée sur une évaluation de
la condition mentale du patient à un moment
spécifique. Par exemple, le patient dont on considère
qu’il a habituellement la capacité juridique de donner
son consentement peut ne pas avoir la lucidité
requise à un moment précis en raison d’un
traumatisme. Cependant, la présomption joue ici
aussi en faveur de la capacité mentale de l’individu.
Renseignements suffisants et adéquats
En 1980, la Cour suprême du Canada a rendu deux
décisions1qui ont établi la norme applicable pour
déterminer si un médecin s’est acquitté de son
obligation d’informer adéquatement le patient. La
Cour a statué que les renseignements que tout patient
raisonnable, dans les mêmes circonstances, aimerait
connaître constituaient la norme à suivre pour évaluer
la nature et l’étendue des renseignements à fournir.
En outre, il a été souligné que pour s’acquitter de son
obligation d’information, le professionnel de la santé
devait répondre aux questions précises du patient
et fournir des renseignements sur la nature de
l’intervention envisagée, sa gravité, tous risques
importants et tous risques particuliers ou inhabituels
associés au traitement, même sans qu’on le
questionne. Le tribunal a toutefois reconnu que
l’étendue du devoir de divulguer ainsi que la question
de savoir s’il y a eu manquement dépendent des
circonstances particulières à chaque cas.2
Au Québec, la tradition civiliste repose sur le Code
civil et les tribunaux n’ont pas suivi les décisions de la
Cour suprême de façon uniforme. En effet, dans
certains cas, le critère du patient raisonnable dans les
mêmes circonstances, établi par la Cour suprême, a
été employé tandis qu’un critère différent a été
appliqué dans d’autres cas.
1Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192 et Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880
2Hopp c. Lepp, supra, p. 210
3Rozovsky, L.E. The Canadian Law of Consent to Treatment, 2nd ed., Toronto et Vancouver, Butterworths, 1997, pp. 9 et ss, et Pauline Lesage-Jarjoura et
Suzanne Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le quotidien de la médecine, 2e ed., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc.,
2001, pp. 137 et ss.

Consentement volontaire
Un climat non coercitif et sans abus d’influence est
aussi un prérequis pour l’obtention d’un consentement
éclairé.
Obtention du consentement par la personne en charge
du traitement
Bien que certains tribunaux aient parfois reconnu la
validité d’un consentement obtenu par une autre
personne désignée dans certaines situations, il serait
plus prudent, dans la mesure du possible, de s’assurer
que ce soit la personne en charge de l’intervention ou
du traitement qui l’obtienne. En effet, la personne qui
administre le traitement est habituellement la mieux
placée à cet égard puisqu’elle connaît la condition et
les antécédents médicaux du patient.
Consentement spécifique
Selon ce critère, le consentement doit être spécifique
et viser un traitement particulier ayant fait l’objet
d’explications et de discussions avec le patient. Sauf si
la vie ou la santé d’un patient pourrait être mise en
danger par tout délai supplémentaire avant la mise en
place d’un traitement, le professionnel de la santé
devrait limiter son traitement à l’intérieur des limites
du consentement fourni par le patient.
Limites et exceptions à la règle
Bien que la règle générale soit à l’effet qu’un
consentement éclairé doit être obtenu dans tous les
cas, certaines exceptions ont été reconnues lorsqu’il
est impossible ou impraticable d’obtenir le
consentement avant le traitement. Il faut toutefois
se rappeler que ce sont des cas exceptionnels et que
la prudence dicte alors de consigner clairement et
complètement les raisons de l’absence de
consentement éclairé.
Refus du patient d’être informé
Les patients qui indiquent ne pas vouloir être
informés et qui consentent à l’avance à tout
traitement jugé approprié par le professionnel de la
santé peuvent placer celui-ci dans une position
délicate.
En effet, le professionnel de la santé confronté à une
telle situation devrait être prudent et s’assurer, dans
tous les cas, que le dossier du patient fasse état des
mesures qu’il a prises et du consentement donné
par le patient.
Privilège thérapeutique
Cette théorie renvoie aux situations où le professionnel
juge qu’il existe des contre-indications à la
communication de renseignements médicaux au
patient. Elle est fondée sur l’opinion du médecin
selon laquelle la divulgation de l’information pourrait
mettre en péril la santé ou le bien-être du patient,
faire empirer son état ou lui causer beaucoup
d’anxiété.
Nombreux sont ceux qui ont cru que la doctrine du
privilège thérapeutique était une exception valide
à l’obligation générale d’obtenir un consentement
éclairé avant de dispenser un traitement. Cela
pourrait ne plus être le cas, du moins dans les
provinces de common law. En effet, dans l’affaire
Meyer c. Rogers4,le tribunal a statué que le privilège
thérapeutique n’est pas un moyen de défense
admissible au Canada. Au Québec, certaines sources
semblent plus disposées à reconnaître cette
exception. Toutefois, à la lumière de la récente
tendance en faveur d’une communication plus
complète des renseignements médicaux pour
permettre au patient de prendre une décision éclairée
à l’égard d’un traitement, une grande prudence est
de mise pour qui veut invoquer cette doctrine.
Traitement obligatoire
Dans certains cas, l’intérêt public prime sur le droit
d’une personne à l’autonomie et certaines
dispositions législatives autoriseront le recours à un
traitement sans tenir compte du consentement, voire
en l’absence de celui-ci. C’est le cas notamment de
l’immunisation obligatoire et du traitement des
maladies contagieuses. La situation des personnes
dont l’état mental présente un danger pour elles-
mêmes ou pour autrui fournit un autre exemple.
En effet, la législation provinciale permet souvent que
de telles personnes soient internées temporairement.
4(1991) 2 O.R. (3d) 356 (Cour de l’Ontario (Division générale))

Situations d’urgence
Les situations d’urgence susceptibles de donner
lieu à une exception à l’obligation d’obtenir le
consentement se divisent en deux catégories.
Premièrement, les situations d’urgence où le patient
est incapable de consentir et que sa vie ou sa santé est
en danger, et que le consentement substitué d’une
autre personne ne peut être obtenu. Ici, le facteur
temps est critique. Les soins pourront être prodigués
au nom de l’intérêt fondamental du patient et du fait
qu’une personne raisonnable y aurait consenti.
Deuxièmement, les cas d’urgence permettant à un
professionnel de la santé de prodiguer des soins
malgré que le consentement éclairé n’ait pas encore
été obtenu sont ceux où le patient est en mesure de le
donner mais où l’urgence de la situation ne permet
pas de passer par toutes les étapes sans mettre la vie
ou l’intégrité physique du patient en danger ou sans
prolonger sa souffrance. Dans de tels cas, le fait que le
patient se soit rendu à l’urgence ou ait appelé une
ambulance pour obtenir des soins et un traitement
laisse entendre qu’il consent. L’autorisation implicite
est valide à l’égard du traitement nécessaire pour
sauver la vie ou stabiliser un état mettant la santé
d’une personne en danger, mais ne s’étend pas
aux autres traitements qui peuvent attendre le
consentement approprié du patient ou le
consentement substitué.
Types de soins continus et répétitifs
Le cas des traitements continus et répétitifs soulève la
question de savoir si un consentement nouveau et
distinct doit être obtenu chaque fois que le traitement
est prodigué. Lorsque les soins ou le traitement sont
toujours les mêmes, il ne sera souvent pas nécessaire
de passer chaque fois par toutes les étapes menant au
consentement. Toutefois, la réaction du patient au
traitement, l’évolution de sa condition, des bienfaits
prévus, des risques importants ou des effets
secondaires importants sont des éléments qui
peuvent avoir une incidence sur la décision d’obtenir
ou non un nouveau consentement.
Conclusion
En résumé, le processus relatif au consentement
devrait être vu comme un dialogue entre le
professionnel de la santé et son patient dont le but
ultime est de prendre une décision à l’égard d’un
traitement qui convienne aux deux parties. En règle
générale, sauf à quelques rares exceptions, le patient
doit donner un consentement valable et éclairé avant
que des soins ou un traitement lui soient prodigués.
Le meilleur moyen de défense face à des allégations
concernant un défaut de s’être acquitté de son
obligation d’obtenir un consentement éclairé est un
dossier médical bien documenté qui décrit
l’information fournie, les discussions avec le patient
et toutes les autres mesures prises pour obtenir un
consentement éclairé.
Mise en garde : Ce document est un outil d’information
qui trace un aperçu général des sujets qui y sont traités.
Il ne saurait être considéré comme un avis ou une
opinion juridique ou comme suggérant des standards
de conduite professionnelle.
Groupe ENCON inc.
700 - 350, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1R 1A4
Téléphone 613-786-2000
Télécopieur 613-786-2001
Sans frais 800-267-6684
www.encon.ca
1
/
4
100%