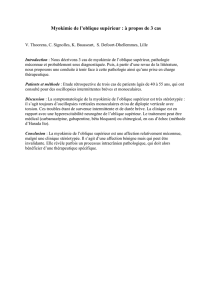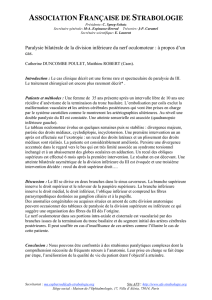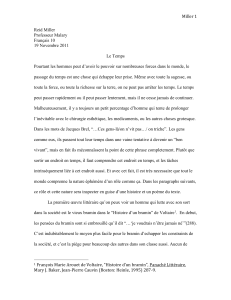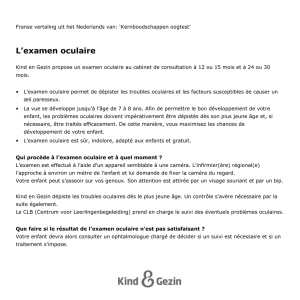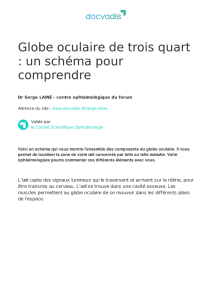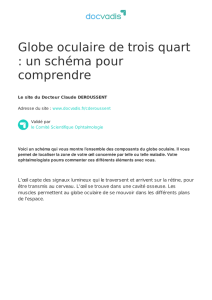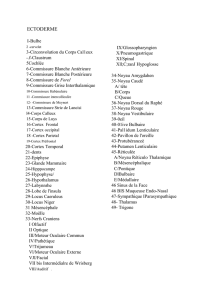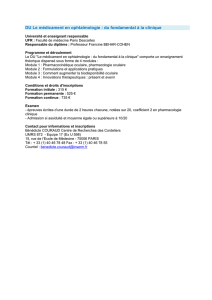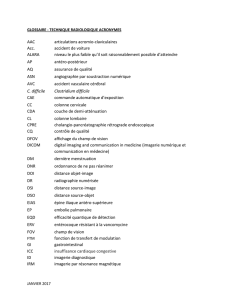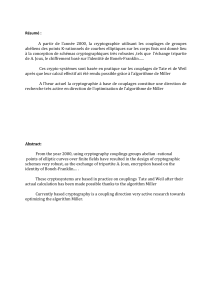Les syndromes oculomoteurs par hyperactivité

Neurochirurgie 55 (2009) 272–278
Rapport 2009 : Neurochirurgie fonctionnelle
dans les syndromes d’hyperactivité des nerfs crâniens
IV – Traitements chirurgicaux
Les syndromes oculomoteurs par hyperactivité neurogène
et leur traitement
Motorocular syndromes due to neurogenic hyperactivity and their treatment
A. Vighettoa,b,∗,c, C. Tiliketea,b,c
aUniversité de Lyon-I, Lyon, France
bUnité de neuro-opthalmologie, service de neurologie D, hôpital neurologique Pierre-Wertheimer, hospices civils de Lyon,
59, boulevard Pinel, 69677 Bron cedex, France
cInserm UMR-S 864, IFR19, institut fédératif des neurosciences de Lyon, 69003 Lyon, France
Rec¸u le 7 janvier 2009 ; accepté le 8 janvier 2009
Disponible sur Internet le 12 mars 2009
Abstract
In this chapter we describe a variety of rare but clinically identifiable ocular motor syndromes, including ocular neuromyotonia, superior
oblique myokymia, ocular motor synkinesis, third nerve palsy with cyclic spasms, and paroxysmal manifestations of multiple sclerosis. These
syndromes share many characteristics. They result from neurogenic hyperactivity, causing episodic spasms of one or several extraocular muscles.
The pathophysiology is not fully understood, but it usually includes both a focal and partial lesion of one of the ocular motor nerves and a central
rearrangement of neuronal activity in the ocular motor nuclei. Treatment with membrane-stabilizing agents, such as carbamazepine, is usually
effective to reduce the symptoms. The above-mentioned syndromes result from a number of different diseases. A proportion of apparently idiopathic
cases may be related to a neurovascular compression syndrome.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Motor ocular nerves; Hyperactive syndromes; Ocular neuromyotonia; Superior oblique myokymia; Oculomotor synkinesis; Oculomotor nerve paresis
with cyclic spasms; Paroxysmal spasms of oculomotor muscles
Résumé
Ce chapitre décrit des syndromes oculomoteurs rares, mais bien identifiables par l’examen clinique, représentés par la neuromyotonie oculaire,
le syndrome de myokymie de l’oblique supérieur, le syndrome de syncinésies oculomotrices, la paralysie du III avec spasmes cycliques et les
manifestations oculomotrices paroxystiques de la sclérose en plaques (SEP). Ils ont en commun une hyperactivité neurogène, qui entraîne des
spasmes intermittents des muscles oculomoteurs. La physiopathologie n’est pas parfaitement identifiée, mais elle fait généralement intervenir
une lésion focale et parcellaire de l’un des nerfs oculomoteurs et un réaménagement de l’activité neuronale au niveau du noyau. Sur le plan
thérapeutique, ils peuvent être améliorés par les médicaments stabilisants de membrane. Les étiologies sont multiples et répondent pour un certain
nombre de cas d’allure idiopathique à un mécanisme de conflit vasculonerveux.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Nerfs moteurs oculaires ; Syndromes d’hyperactivité ; Neuromyotonie oculaire ; Myokymie de l’oblique supérieur ; Syncinésies oculomotrices ; Paralysie
du nerf oculomoteur avec spasmes cycliques ; Spasmes paroxystiques des muscles oculomoteurs
Ce cadre regroupe des syndromes oculomoteurs rares, mais
bien identifiables par l’examen clinique, qui se présentent
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (A. Vighetto).
généralement de manière isolée. Nous analyserons successive-
ment la neuromyotonie oculaire, le syndrome de myokymie de
l’oblique supérieur, le syndrome de syncinésies oculomotrices,
la paralysie du III avec spasmes cycliques et les manifesta-
tions oculomotrices paroxystiques de la sclérose en plaques
(SEP).
0028-3770/$ – see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.neuchi.2009.01.013
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/04/2010 par LYON 1 - (261120)

A. Vighetto, C. Tilikete / Neurochirurgie 55 (2009) 272–278 273
Ces syndromes ont en commun de comporter une hyper-
activité neurogène, génératrice de spasmes intermittents des
muscles oculomoteurs, à l’origine de diplopie paroxystique.
Au-delà de la diversité des étiologies, parmi lesquelles figurent
les conflits vasculonerveux, ils ont également en commun
certains mécanismes physiopathologiques. Ils associent
l’existence de lésions focales et partielles, à la fois myéliniques
et axonales, sur le trajet fasciculaire ou tronculaire, de l’un
des nerfs oculomoteurs, avec un réaménagement nucléaire de
l’activité neuronale, ces lésions étant à l’origine d’anomalies
spatiales ou temporelles de la transmission de l’influx nerveux.
Enfin, ils répondent généralement aux médicaments stabilisants
de membrane, tels la carbamazépine ou le gabapentin.
Ils se distinguent par leur séméiologie, par le caractère spon-
tané ou provoqué du trouble moteur oculaire, par le nerf moteur
oculaire concerné et par l’étiologie.
1. Le syndrome de neuromyotonie oculaire
1.1. Présentation clinique
La neuromyotonie oculaire se manifeste par une diplopie ou
par un strabisme monoculaire épisodique, de survenue sponta-
née ou induite par le maintien d’une position du regard. Elle
se caractérise par des spasmes toniques, brefs, durant quelques
secondes, d’un ou de plusieurs muscles oculomoteurs dépen-
dant d’un même nerf oculomoteur. Typiquement, ces spasmes
sont déclenchés par le maintien du regard en position excentrée
et la diplopie survient lorsque l’œil tente de revenir en position
primaire.
Le motif de consultation est ainsi une diplopie paroxystique,
qui peut être verticale ou horizontale. Le diagnostic est assuré
par la démonstration du trouble oculomoteur intermittent. En cas
de neuromyotonie du III, il peut s’agir du déclenchement d’une
ésotropie avec limitation de l’abduction de l’œil homolatéral,
après un mouvement de version (latéralité) soutenue, sollicitant
le muscle droit médial (Miller et Newman, 2005). Il peut aussi
s’agir d’une infraduction persistante avec limitation de la supra-
duction, après le maintien prolongé d’une infraversion (Versino
et al., 2005). Les manifestations précédentes peuvent s’expliquer
par le maintien anormal d’une activité tonique dans un muscle
oculomoteur, respectivement le droit médial et le droit inférieur.
Il a également été décrit un défaut paroxystique de mouvements
verticaux d’un œil, associé à une rétraction palpébrale, alors que
l’examen oculomoteur est normal entre les épisodes (Salmon
et al., 1988). Dans ce dernier cas, le phénomène spasmodique
intéresse simultanément les muscles droit inférieur, droit supé-
rieur et releveur de la paupière supérieure. Nous avons décrit
un cas comportant une rétraction palpébrale supérieure, avec
ésotropie et limitation de l’infraduction, de la supraduction et
de l’abduction, après le maintien pendant 20 à 30 secondes du
regard vers le haut (Tilikete et al., 2000). La contraction tonique
intéresse alors les mêmes muscles que dans le cas précédent,
ainsi que le muscle droit médial. En cas de neuromyotonie du
VI, le syndrome se manifeste sous la forme d’une exotropie épi-
sodique avec diplopie horizontale et limitation de l’adduction
(Barroso et Hoyt, 1993).
Dans environ deux cas sur trois, la neuromyotonie sur-
vient après le maintien d’une position oculaire excentrée durant
plusieurs secondes. La diplopie et/ou le strabisme résulte du
maintien de la contraction tonique, d’un défaut de relaxation,
du muscle sollicité, celui-ci étant innervé par le nerf oculomo-
teur atteint. L’une des circonstances déclenchantes naturelles
peut être la rotation de la tête et des yeux lors de la conduite
automobile au moment du stationnement. Dans ces cas, la repro-
duction du symptôme au décours du maintien de la posture
oculomotrice assure le diagnostic. Dans les autres cas, la sur-
venue est spontanée, répétitive au cours de la journée, sans
être spécifiquement liée à un contexte oculomoteur. Il n’existe
aucun symptôme associé, notamment de douleur. L’examen ocu-
lomoteur intercritique s’avère normal dans 60 % des cas et
relève une « parésie » d’un nerf oculomoteur dans les autres
cas (Miller et Lee, 2004). Dans certains de ces derniers cas,
le déficit oculomoteur de base pourrait en fait relever, non pas
d’un déficit oculomoteur, mais d’une contraction tonique per-
manente de l’un ou de plusieurs des muscles dépendant du nerf
oculomoteur affecté par la neuromyotonie. Dans de tels cas,
la coexistence d’une composante tonique avec la composante
phasique de la neuromyotonie oculaire peut être démontrée
par la disparition concomitante de ces deux composantes avec
le traitement médical par la carbamazépine (Versino et al.,
2005).
1.2. Électrophysiologie
Le spasme musculaire résulte d’une hyperactivité neurogène
dans le territoire considéré. De rares cas ont pu être étu-
diés avec un enregistrement électromyographique des muscles
oculomoteurs. Alors que l’examen au niveau des muscles
squelettiques était normal, il a été montré une activité spon-
tanée continue des unités motrices du muscle releveur de
la paupière supérieure, avec des bouffées brèves de poten-
tiels d’action de haute fréquence, associée à des tracés de
contraction volontaire normaux et à une absence de postdé-
charges (Tilikete et al., 2000). Le profil électromyographique
est ainsi, au moins dans ce cas, celui d’un syndrome d’activité
continue des unités motrices, terme caractérisant la neuro-
myotonie, mais limité au territoire oculomoteur, justifiant
ainsi parfaitement l’appellation syndromique de neuromyoto-
nie oculaire (Tilikete et al., 2000). Si la neuromyotonie est
permanente, la phase spasmodique « clinique » est contem-
poraine d’un défaut de relaxation musculaire, du fait de
décharges inappropriées des neurones ou axones du III, IV ou
VI.
La neuromyotonie oculaire est consécutive à une lésion
focale et incomplète du tronc nerveux, au niveau périphé-
rique. Elle résulte probablement à la fois des conséquences
locales, comportant des lésions myéliniques et axonales ainsi
que d’un réaménagement central de l’activité neuronale dans les
noyaux oculomoteurs. Les premières peuvent rendre compte de
la cocontraction musculaire par le fait de courts-circuits éphap-
tiques, avec transmission interaxonale de l’activité électrique,
le second peut rendre compte de l’hyperactivité neurogène avec
une instabilité des membranes.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/04/2010 par LYON 1 - (261120)

274 A. Vighetto, C. Tilikete / Neurochirurgie 55 (2009) 272–278
Fig. 1. Neuromyotonie du III probablement secondaire à un conflit entre le III et le tronc basilaire (Tilikete et al., 2000). La flèche sur chaque image montre le III
dans sa partie cisternale et le tronc basilaire.
Oculomotor neuromyotonia resulting from a probable conflict between the third nerve and the basilar artery (Tilikete et al., 2000). The white arrow on each picture
shows the cisternal part of the third nerve and the basilar artery.
1.3. Étiologie
Ce syndrome est rare, puisque seulement 41 cas étaient
recensés dans la littérature en 2004 (Miller et Lee, 2004).
Tous les nerfs oculomoteurs peuvent être concernés, avec une
prédominance pour le III (III : 23/41 ; VI : 11/41 ; IV : 4/41 ;
plusieurs nerfs : 3/41). Le syndrome est généralement unilatéral,
mais il peut concerner les deux III (Morrow et al., 1996).
Sur le plan étiologique, dans la plupart des cas publiés, la
neuromyotonie oculaire survient dans le contexte d’une radio-
thérapie ayant porté sur une tumeur sellaire ou parasellaire.
Le trouble oculomoteur survient alors quelques mois à 17 ans
après la radiothérapie. Il doit être différencié de la conséquence
d’une récidive tumorale. D’autres étiologies sont possibles,
ayant généralement en commun une compression d’un nerf ocu-
lomoteur (Tableau 1). Dans environ 15 % des cas, aucune cause
n’est identifiée.
Notre expérience personnelle porte sur deux cas.
Le premier a consisté en une neuromyotonie du III, isolée,
pour laquelle nous avons pu montrer sur l’IRM un contact
anatomique étroit entre le III droit et un tronc basilaire doli-
choectasique (Fig. 1)(Tilikete et al., 2000). Ce cas suggère
Tableau 1
Causes de la neuromyotonie oculaire (Miller et Lee, 2004 ;Jacob et al., 2006).
Causes of ocular neuromyotonia (Miller et Lee, 2004 ; Jacob et al., 2006).
Radiothérapie de la région de la selle turcique (60 %)
Causes compressives ou irritatives (25 %)
Chordome du clivus
Anévrisme thrombosé
Maladie de Paget
Mucomycose du sinus caverneux
Arachnoïdite après injection intrathécale de produit de contraste
Méningiome
Orbitopathie parabasedowienne
Conflit vasculonerveux
Idiopathique (15 %)
qu’une compression vasculonerveuse puisse être à l’origine
de certaines neuromyotonies oculaires et incite à rechercher
cette cause dans les cas a priori idiopathiques, en utilisant des
séquences radiologiques appropriées. De rares observations de
la littérature vont dans le même sens. Un cas de neuromyotonie
du III, responsable d’épisodes de diplopie verticale isolée, en
lien avec une séméiologie phasique et tonique a été rapporté par
l’IRM à un probable conflit entre la partie proximale du tronc
Fig. 2. Neuromyotonie du III révélant un probable méningiome du sinus caver-
neux gauche (Jacob et al., 2006).
Oculomotor neuromyotonia revealing a left probable cavernous sinus menin-
gioma (Jacob et al., 2006).
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/04/2010 par LYON 1 - (261120)

A. Vighetto, C. Tilikete / Neurochirurgie 55 (2009) 272–278 275
du III et le segment P1 de l’artère cérébrale postérieure (Versino
et al., 2005). Dans ce cas, l’ensemble de la séméiologie a été
résolutif sous carbamazépine, après échec du gabapentin. Il a
également été rapporté un cas de diplopie verticale intermit-
tente, se reproduisant toutes les deux semaines, avec un examen
oculomoteur intercritique normal, associé à l’existence sur
l’IRM d’une compression (ou du moins d’un contact) vasculaire
non anévrysmale du III, avec une résolution des symptômes
sous gabapentin (Thomke et Gawehn, 2006).
Notre second cas a été celui d’un méningiome probable
du sinus caverneux, qui s’est manifesté exclusivement par une
diplopie paroxystique, secondaire à une neuromyotonie du III,
avec un examen ne montrant qu’une parésie minime du III, sous
la forme d’un ptosis discret (Fig. 2)(Jacob et al., 2006).
1.4. Traitements
La neuromyotonie oculaire peut répondre à un traitement
médical de type carbamazépine ou gabapentin (Salmon, 1988 ;
Tilikete et al., 2000 ;Versino et al., 2005 ;Miller et Newman,
2005), ou clonazepam (Jacob et al., 2006). L’action théra-
peutique résulte vraisemblablement d’un effet de stabilisation
membranaire par action sur les canaux ioniques. Le traitement
atténue ou même fait disparaître les manifestations paroxys-
tiques. Il peut également réduire la composante déficitaire de
l’examen oculomoteur, indiquant qu’une partie de celle-ci relève
d’une décharge neuronale tonique (Versino et al., 2005).
2. Le syndrome de myokymie de l’oblique supérieur
2.1. Présentation clinique
Ce syndrome, dont la description moderne revient à Hoyt et
Keane en 1970 (cité dans Miller et Newman, 2005), se manifeste
par des épisodes de flou ou de sensation de tremblement mono-
culaire, de survenue paroxystique. Il peut également se révéler
par une diplopie intermittente, verticale ou oblique. Certains
patients décrivent, de manière caractéristique une oscillopsie
monoculaire verticale ou torsionnelle. Les épisodes, qui durent
une dizaine de secondes, peuvent se répéter plusieurs fois par
jour. Ils sont de survenue spontanée, ou plus habituellement
déclenchés par le fait de regarder vers le bas, de converger, de
maintenir la fixation, de cligner des yeux, ou d’incliner la tête du
côté du nerf symptomatique (Miller et Newman, 2005). Si une
gêne visuelle est rapportée, son caractère monoculaire constitue
un paramètre diagnostique important. Alors que l’interrogatoire
est très évocateur du diagnostic, sa confirmation est difficile à
apporter par l’examen. L’examen oculomoteur et orthoptique est
généralement normal en dehors des crises, hormis pour les cas
dans lesquels le syndrome s’associe à une parésie du muscle
oblique supérieur par lésion du IV. L’examen lors d’une crise
semble normal, mais un examen attentif à l’œil nu peut montrer
un microtremblement monoculaire en torsion. C’est l’examen
avec un ophtalmoscope ou avec une lampe à fente qui est déci-
sif, montrant sur le seul œil symptomatique des spasmes de
faible amplitude se manifestant par des mouvements de torsion
et d’abaissement de l’œil.
2.2. Investigations de laboratoire
L’examen oculographique est généralement moins démons-
tratif que la simple inspection des vaisseaux du pôle postérieur et
de la papille avec un ophtalmoscope. Cependant, si un enregis-
trement tridimensionnel des mouvements oculaires est effectué,
avec une technique de coil scléral ou d’analyse vidéonystagmo-
graphique, il montre initialement une intorsion et une dépression
de l’œil, suivies d’oscillations irrégulières de faible amplitude et
de fréquence variable, qui n’ont pas la régularité d’un nystagmus
à ressort (Miller et Newman, 2005). L’électromyogramme du
muscle oblique supérieur symptomatique montre une activité de
décharge spontanée ou faisant suite à une contraction du muscle.
Il s’agit de potentiels de grande amplitude et de durée prolongée,
d’aspect polyphasique, survenant à une fréquence de décharge
de l’ordre de 45 hertz. Cette activité spontanée anormale ne dis-
paraît que lors des saccades effectuées dans la direction vers le
haut. L’hyperactivité du muscle oblique supérieur relève d’une
atteinte neurogène, comportant la mise en jeu d’une régénéra-
tion. Il existe d’ailleurs des données expérimentales montrant
qu’après une lésion du IV, il survient une régénération compor-
tant une augmentation du nombre des axones à partir des
motoneurones survivants (Miller et Newman, 2005).
2.3. Étiologies
Sur le plan physiopathologique, seule une faible proportion
des cas de syndrome de myokymie de l’oblique supérieur sur-
vient comme modalité de récupération après une paralysie du
IV, mais il peut être supposé dans les autres cas que le syn-
drome relève d’une lésion partielle du IV, ayant résulté en des
phénomènes de régénération permettant le maintien du nombre
d’axones dans le nerf.
Le syndrome de myokymie de l’oblique supérieur peut résul-
ter d’un traumatisme crânien, ayant entraîné une paralysie
régressive du IV, ou d’une lésion focale de la fosse cérébrale
postérieure, telle une SEP, une malformation vasculaire, un acci-
dent vasculaire du tronc (Miller et Newman, 2005). Il est le plus
souvent isolé et d’allure idiopathique.
Il est vraisemblable qu’une proportion de ces derniers cas
relève d’un conflit vasculonerveux, intéressant une branche arté-
rielle, notamment l’artère cérébelleuse supérieure et le tronc du
IV, spécifiquement au niveau de sa partie cisternale proximale.
Cette partie du nerf, dès son émergence de la partie dorsale du
mésencéphale, correspond à la « root exit zone » (REZ). Cette
zone répond histologiquement à la transition entre la myéline
centrale et la myéline périphérique (Fraher et al., 1988). Le
mécanisme supposé du syndrome est alors une démyélinisa-
tion focale du IV, secondaire à la pression pulsatile de l’artère
au niveau de cette zone transitionnelle vulnérable. Cette lésion
focale chronique peut conduire à un court-circuit interaxonal
des décharges, correspondant à une transmission éphaptique.
On peut également faire l’hypothèse, par analogie avec les
autres situations d’hyperactivité neurogène des nerfs crâniens
par conflit vasculonerveux, qu’il coexiste une modification du
niveau d’activité des neurones dans le noyau du IV. Le contact
vasculaire peut être objectivé par l’IRM. Dans un travail portant
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/04/2010 par LYON 1 - (261120)

276 A. Vighetto, C. Tilikete / Neurochirurgie 55 (2009) 272–278
sur six patients et utilisant un protocole d’IRM permettant de
visualiser le IV 11 fois sur 12, un contact vasculaire anormal au
niveau de la REZ a été objectivé dans les six cas du côté symp-
tomatique et dans aucun des cas du côté non symptomatique
(Yousry et al., 2002). Un autre cas de myokymie de l’oblique
supérieur, isolé, évoluant depuis huit ans, a pu être rapporté sur
l’IRM à une compression du IV gauche au niveau de la REZ
par une branche de l’artère cérébelleuse supérieure, la visuali-
sation du contact requérant des séquences particulières (SPGR
et FIESTA) (Hashimoto et al., 2004). Le conflit vasculonerveux
peut être retrouvé lors de l’intervention chirurgicale et la levée
du conflit peut faire disparaître le syndrome (Samii et al., 1998 ;
Scharwey et al., 2000 ;Mikami et al., 2005). Cela apporte un
faisceau d’arguments pour considérer le syndrome de myoky-
mie de l’oblique supérieur, dans sa variété idiopathique, comme
relevant d’un syndrome de conflit neurovasculaire. Cependant,
l’importance relative de ce mécanisme n’est pas connue, dès
lors que la visualisation d’un contact vasculaire est difficile et
requiert des séquences spécifiques en IRM. En outre, on est rare-
ment conduit à envisager un geste chirurgical de décompression,
du fait du caractère habituellement peu invalidant et transitoire
de la symptomatologie visuelle, ainsi que du fait de l’efficacité
fréquente du traitement médical.
2.4. Traitements
En effet, le syndrome de myokymies de l’oblique supérieur
répond généralement bien au gabapentin ou à la carbamazé-
pine (Deokule et al., 2004 ;Miller et Newman, 2005). Il est
cependant des cas où la symptomatologie est suffisamment inva-
lidante et rebelle pour qu’un traitement chirurgical soit envisagé.
Les interventions envisagées dans ce cas ont surtout consisté
en des gestes de chirurgie strabologique, à visée musculaire. À
la lumière des connaissances actuelles, il semble plus logique
et plus conservateur de proposer pour ces cas peu nombreux
un geste de décompression microchirurgicale vasculonerveuse,
dès lors que l’on aura pu démontrer un contact vasculaire sur la
partie proximale du IV par une IRM dédiée.
3. Le syndrome de syncinésies oculomotrices
3.1. Présentation clinique
Le syndrome de syncinésies oculomotrices se manifeste par
une contraction musculaire anormale et stéréotypée accompa-
gnant le mouvement volontaire. Il est le plus souvent secondaire
à une paralysie oculomotrice du III, acquise ou congénitale et
correspond alors au syndrome de régénération aberrante. Il est
rarement primitif, survenant sans parésie oculomotrice préexis-
tante.
La manifestation la plus caractéristique est représentée par
une rétraction palpébrale concomitante de l’adduction ou de
l’infraduction de l’œil, que le mouvement soit effectué ou
seulement tenté, selon le degré de la parésie. Le terme de
« pseudo-signe de Graefe » désigne cette rétraction et l’élévation
de la paupière lors du regard vers le bas. Il peut s’agir également
d’une adduction involontaire survenant lors de la supraduction
ou de l’infraduction, ou bien d’une infraduction avec rétrac-
tion du globe oculaire, réalisant une enophtalmie transitoire,
lors de la tentative d’élévation du regard. La symptomatolo-
gie peut enfin concerner la pupille. Celle-ci est souvent de taille
intermédiaire ou de petite taille et ne réagit pas ou très peu à
la lumière. En revanche, la pupille peut réagir sur le mode d’un
myosis syncinétique lors de l’adduction, de la supraduction ou de
l’infraduction de l’œil atteint. La dissociation entre une absence
de réponse de la pupille à la lumière et le myosis concomitant
de l’adduction peut ressembler à une pupille tonique et réalise
un pseudo signe d’Argyll-Robertson. Ce dernier se distingue du
signe d’Argyll-Robertson, d’origine syphilitique ou diabétique,
ou bien de la pupille tonique d’Adie, par le fait que dans ces
derniers cas il ne coexiste pas de parésie du III et la réponse
pupillaire en myosis ne survient que lors de la convergence et
non lors de l’adduction effectuée dans le cadre d’un mouvement
de version. De manière plus exceptionnelle, il a été décrit des
syncinésies impliquant des nerfs crâniens non lésés, comme le
III controlatéral, se manifestant par une rétraction de la pau-
pière supérieure controlatérale au III atteint lors du regard vers
le bas (Guy et al., 1989), ou bien le VI, le V ou le VII (Miller et
Newman, 2005).
L’intensité de la symptomatologie syncinétique est très
variable, souvent évidente, mais parfois subtile. L’évolution peut
en être régressive.
Le diagnostic est assuré par le fait que le mouvement oculaire
anormal ne survient que lors de la réalisation (ou de sa tentative)
d’un déplacement oculaire donné.
3.2. Étiologies
Ce syndrome est observé dans le contexte d’une lésion du
III, quel qu’en soit le niveau, depuis le tronc cérébral jusqu’à
l’orbite et quelle qu’en soit la cause.
Il fait généralement suite à une paralysie du III, incomplète
ou qui a partiellement régressé, pouvant être acquise ou congé-
nitale. Il est alors décrit comme un syndrome de régénération
aberrante. Chez l’adulte, les syncinésies se manifestent environ
neuf semaines après la lésion, alors que chez l’enfant victime
d’un traumatisme de naissance, elles apparaissent une à six
semaines après la naissance (Miller et Newman, 2005). Ces syn-
cinésies ont été décrites lors de paralysies du III relevant d’une
atteinte fasciculaire après accident vasculaire dans le pédon-
cule cérébral (Messé et al., 2001), d’une atteinte tronculaire lors
d’une méningite, d’un traumatisme, d’une compression tumo-
rale ou anévrysmale, d’une thrombose du sinus caverneux, d’un
méningiome du sinus caverneux, d’un syndrome de Guillain-
Barré, ou d’une migraine ophtalmoplégique (Miller et Newman,
2005). La survenue de syncinésies après une paralysie du III
épargnant la pupille, secondaire à une microangiopathie diabé-
tique, est possible mais atypique et doit faire rechercher une
cause compressive.
Il est plus exceptionnellement « primitif », sans notion de
paralysie du III préexistante. Un tel syndrome de syncinésies pri-
mitives du nerf oculomoteur est consécutif à une lésion du III de
développement progressif, de cause généralement compressive,
telle un méningiome dans le sinus caverneux, un anévrisme non
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/04/2010 par LYON 1 - (261120)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%