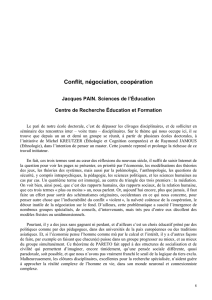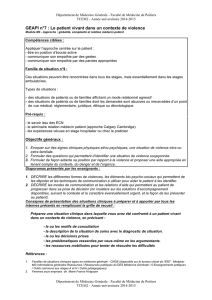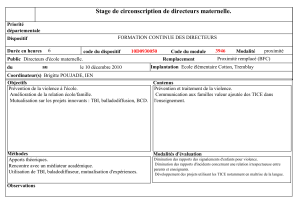VIOLENCE ET INTÉGRATION SOCIALE

N° 1217 - janvier-février 1999 - 43
LA VILLE DÉSINTÉGRÉE ?
Les grèves dans les transports publics à la suite
d’agressions, ainsi que les incidents spectaculaires
consécutifs aux manifestations lycéennes ont relancé
les débats récurrents sur la violence des jeunes de ban-
lieue. Jusqu’à la fin des années 80, les “incivilités”, les
agressions et les émeutes étaient largement restées à l’intérieur des
cités, “pourrissant” la vie de leurs habitants qui en étaient les pre-
mières victimes. Mais depuis quelques années, ces violences ne sont
plus cantonnées à l’espace “clos” des quartiers périphériques. Elles
ont largement débordé. Elles se sont généralisées à certains espaces
centraux des villes, touchant de nouveaux quartiers et de nouvelles
populations jusque-là relativement épargnées. Outre les personnels
des services publics ou sociaux, les enseignants ou les chauffeurs
de bus ou de train, les jeunes des centres villes sont, eux aussi,
confrontés à des violences qui prennent la forme d’insultes, d’agres-
sions physiques ou de “dépouilles” et de racket. Les conduites
violentes ne sont plus strictement circonscrites aux espaces réser-
vés aux catégories populaires. Elles touchent aujourd’hui une partie
des catégories moyennes.
LAVIOLENCE NAÎTRAIT D’UN VIDE SOCIAL
De nombreux observateurs ont souligné la distance entre deux “jeu-
nesses” lors des manifestations lycéennes. Les élèves des lycées
centraux, qui peuvent espérer quelque chose de l’école, s’opposaient
à ceux des lycées des quartiers périphériques qui, eux, n’espèrent
rien. Alors que les premiers manifestaient, les seconds “cassaient”
et “dépouillaient”. Alors que les premiers revendiquaient de
“meilleures conditions d’études”, les seconds justifiaient leurs com-
portements par la “haine” et la “rage” de ne “rien avoir”. Plus les
lycéens incarnaient une jeunesse “méritante”, avide de “bonnes
conditions de travail” et recherchant une intégration réussie dans
VIOLENCE ET INTÉGRATION SOCIALE
Est-ce le manque de social, de travail, d’éducation, de normes, de justice qui engendre la vio-
lence des populations qui sont victimes de ce manque ? La violence ne serait-elle pas plutôt
le résultat d’une hypersocialisation des jeunes appartenant à ces populations, qui ne pour-
raient exister en dehors de leur groupe, ni s’exprimer
autrement que par la violence de ce groupe ? Le remè-
de à la violence impliquerait alors, non l’intégration
sociale de ses acteurs mais leur “désocialisation”.
par Didier
Lapeyronnie
Cadis/Université
Victor Segalen,
Bordeaux.

N° 1217 - janvier-février 1999 - 44
LA VILLE DÉSINTÉGRÉE ?
la société, plus les “casseurs” faisaient figure de barbares que leur
rejet hors de la société et leur absence d’intégration présente et futu-
re conduisaient à une violence par bien des aspects proprement
écœurante.
La plupart du temps, cette violence est ainsi expliquée par le vide.
L’absence du social engendre des situations anomiques et un dérè-
glement généralisé des conduites. À défaut de normes et de règles,
l’individu perd ses repères et se montre incapable de construire une
personnalité stable. Surtout, il ne peut contrôler ses comportements,
ses désirs ou ses pulsions. Deux grands schémas de raisonnement sont
développés pour rendre compte de la violence en ces termes, mais
aussi pour la réduire. Selon le premier, l’anomie s’explique essen-
tiellement par le défaut des valeurs. La “crise” de la famille, celle de
l’école, celle du modèle d’intégration, ou encore le triomphe de l’in-
dividualisme, en effaçant les limites et en sapant les fondements
légitimes de l’autorité, ouvrent la porte à une véritable barbarie. Pour
remédier à cet état de fait, il faut rétablir l’ordre social par la réaf-
firmation des repères, des instances de contrôle et d’autorité, qui
offriront aux individus les ressources normatives nécessaires à la sta-
bilité de leur comportement. Pour le second schéma, les inégalités
sociales et la misère brisent les personnalités. Les groupes ou les indi-
vidus sont désaffiliés. Privés de social, ils sont plongés dans une
souffrance qui altère leur individualité. La violence s’explique alors
par la haine et la rage des jeunes de banlieue, conséquences de leur
exclusion. La solution doit être recherchée dans l’augmentation de
la participation sociale. La réduction des inégalités n’a pas simple-
ment pour objectif de soulager la misère, elle fournit à l’individu les
moyens d’une intégration sociale salutaire.
Une telle conception, dans l’une ou l’autre de ses versions, consis-
te à exiler la violence. Sa signification lui est toujours extérieure, soit
dans l’anomie, soit dans les inégalités, autrement dit, dans un ordre
social dont elle est l’envers. C’est pourquoi la violence est entière-
ment déterminée, alors que les conduites sociales normales sont
autonomes. Elle est portée par des individus incapables d’agir libre-
ment pour des raisons morales ou sociales, c’est-à-dire par des
“barbares”(1). Depuis, la violence est imprévisible, irrationnelle et irré-
gulière, alors que l’ordre rend les conduites sociales prévisibles,
rationnelles et régulières. La violence est la négation de la liberté et
de la rationalité de l’individu qui fondent la vie sociale.
Aussi, la violence se situe-t-elle au-delà des frontières de la socié-
té normale. Elle est portée par des marginaux mal intégrés. Elle fait
irruption avec l’infini des désirs et des pulsions quand l’individu ne
1) - La couverture d’un
numéro récent de
l’hebdomadaire Le Point,
annonçait ainsi un reportage
sur les jeunes de banlieue :
“Les nouveaux barbares”.

N° 1217 - janvier-février 1999 - 45
LA VILLE DÉSINTÉGRÉE ?
se maîtrise pas. Elle est encore engendrée par l’Histoire qui boule-
verse les sociétés. La frontière séparant la violence de l’ordre social
doit donc être en permanence gardée par les dispositifs de contrô-
le social et d’intégration. Il s’agit toujours d’éloigner la barbarie, de
l’expulser de la vie sociale, que ce soit la sauvagerie que chacun porte
en lui, ou encore celle qui est aux portes de la société. Le renforce-
ment des liens sociaux ou l’intégration, par le rappel à l’ordre ou
l’augmentation de la participation sociale, ont pour objectif de
réguler les conduites sociales en faisant intérioriser aux individus
la morale et les valeurs collectives, permettant ainsi d’expulser la
violence de la vie sociale.
La violence n’est pas simplement un mal dont il faut se protéger. Elle
est surtout le signe de ce que la société n’a pas réussi à incorporer. Elle
désigne donc ce qu’il faut intégrer ou socialiser pour la réduire. Elle
révèle les limites du processus “de civilisation” ou les failles du pro-
cessus de “démocratisation”. En un mot, la violence en appelle à une
intervention morale ou sociale visant à étendre et à renforcer la vie
sociale. Elle suscite une double indignation : celle ressentie face aux
victimes des actes de barbarie ; celle éprouvée dans l’injustice socia-
le qui a conduit les individus à commettre de tels actes. Il n’y a pas de
sujet de la violence. Il n’y a que des victimes que la société se doit de
secourir. Au fond, elle manifeste un besoin de société.
Ainsi conçue, la violence est la baguette magique de la simplifica-
tion et de la tautologie pour reprendre l’expression d’Ulrich Beck :
elle “éclaire les zones d’ombre et justifie l’impératif de société”(2).
Dépourvue de signification propre, elle légitime la nécessité de l’uni-
té et de la justice sociales, puisqu’elle est la manifestation de leur
2) - Ulrich Beck,
The Reinvention of politics.
Rethinking Modernity
in the Global Social Order,
Cambridge,
Polity Press, 1997, p. 66.

N° 1217 - janvier-février 1999 - 46
LA VILLE DÉSINTÉGRÉE ?
absence. C’est pourquoi, les jeunes de banlieue doivent être l’objet
d’interventions éducatives et sociales, ou répressives et charitables,
visant à les faire bénéficier des bienfaits de l’intégration sociale. S’il
leur est permis de développer ainsi pleinement leur personnalité, ils
substitueront liberté et rationalité à la violence “aveugle et absur-
de”. Dans ce type de conception, la violence est le miroir de la
normalité : le point de vue moral vaut comme modèle explicatif et
réciproquement, le modèle explicatif vaut comme point de vue moral.
MÊME LA NATURE DE LA VIOLENCE
A HORREUR DU VIDE
Le succès de l’explication de la violence par le vide social est d’abord
d’ordre normatif, la société normale “non-violente” y trouve sa
propre légitimité et y affirme sa propre supériorité, car, sur un plan

N° 1217 - janvier-février 1999 - 47
LA VILLE DÉSINTÉGRÉE ?
strictement empirique, le lien entre violence et vide social n’est en
rien évident. Les individus les plus “désocialisés” sont rarement les
plus violents. Au contraire, le “vide” semble conduire au retrait ou
à la prostration. Au terme des processus de “désaffiliation”, nous ren-
controns plutôt l’apathie que la violence, plutôt la passivité que
l’agressivité. L’étude classique de Lazarsfeld sur les chômeurs de
Marienthal lors de la crise des années trente, comme les observa-
tions contemporaines de chômeurs de longue durée, montrent plutôt
une propension à l’inertie et à l’indifférence.
Mais surtout, les conduites violentes évoquées n’effraient pas seu-
lement par la détresse “sociale” qu’elles expriment ou la barbarie
qu’elles révèlent. C’est aussi leur dimension collective qui suscite
peurs et interrogations. De ce point de vue, la violence apparaît moins
comme le produit d’un vide que comme une dimension de la vie col-
lective et sociale : une véritable “sous-culture” de la violence semble
s’être développée dans les quartiers populaires pour maintenant
envahir les “centres villes”. Sous-culture “adolescente”, elle struc-
ture la vie des groupes. Elle génère des comportements qui vont du
pillage lors des émeutes à l’agression collective. D’une façon ou d’une
autre, il s’agit d’une violence constitutive de comportements qui sont
d’abord sociaux et collectifs et rarement ceux d’individus isolés.
Suivons, par exemple, un groupe d’une dizaine de jeunes garçons
d’une banlieue parisienne ayant directement participé aux pillages
de la place de la Nation lors des manifestations lycéennes. Ils ont
entre quatorze et vingt ans. Ils portent survêtements et chaussures
de sports, casquettes pour certains.
Le 21 juin, lors de la fête de la musique, à Paris, ils “tracent” entre
la Bastille et la République. Ils occupent toute la largeur du trottoir,
se bousculent et se “chopent” plus ou moins méchamment. Dès que
l’un s’arrête devant une vitrine de téléphonie
mobile ou de sport, les autres se rassemblent
autour de lui. Tous font des commentaires. Puis
le groupe éclate et semble se disperser. Des
insultes sont proférées. Ils semblent au bord
d’une bagarre. Mais tout s’apaise. Les filles
aperçues sont systématiquement agressées.
L’un d’eux s’écarte pour leur proposer de le
“sucer” car il possède une virilité peu commune qu’il fait semblant
d’exhiber, les mains dans les poches, en se cabrant outrageusement
ou en se saisissant de ses testicules à travers son pantalon. Devant
les refus ou l’indifférence des filles, il essaye de les toucher, les bous-
cule plus ou moins rudement et rejoint les autres en les traitant de
Les individus
les plus “désocialisés”
sont rarement les plus violents.
Au contraire, le “vide”
semble conduire au retrait
ou à la prostration
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%