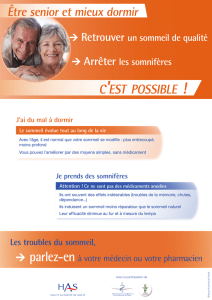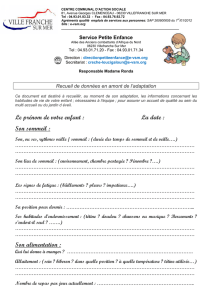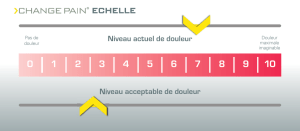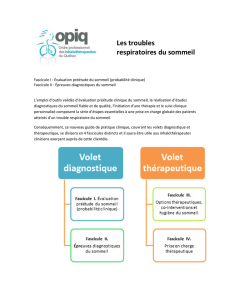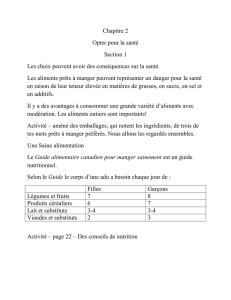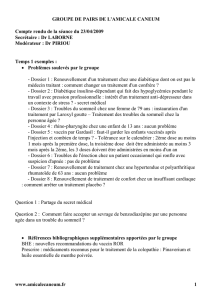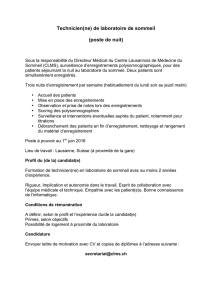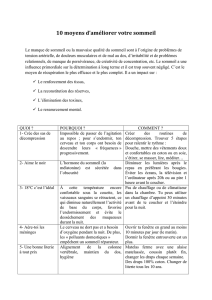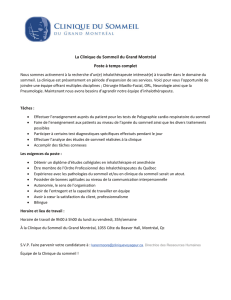Favoriser un environnement propice au rythme veille

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
http://dx.doi.org/10.1016/j.sger.2012.07.007
SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012 27
Le sommeil des personnes âgées
dossier
Favoriser un environnement
propice au rythme
veille-sommeil
L’amélioration du sommeil des personnes
âgées s’effectue sur deux plans. Elle passe
tout d’abord par des propositions au niveau de
l’institution ou de l’environnement, en regard de
chacun des éléments caractérisant le sommeil des
personnes âgées. Elle est réalisée également à
l’échelon individuel, grâce à une éducation théra-
peutique spécifi que.
ASPECT ENVIRONNEMENTAL
Un des deux mécanismes qui sous-tendent le som-
meil correspond à une accumulation de subs-
tances hypnogènes pendant l’éveil, faisant que
plus on est éveillé longtemps, plus on dort. On
peut aussi ajouter que meilleure est la qualité de
l’éveil, meilleur sera le sommeil.
Préparer le sommeil pendant l’éveil
Ainsi, multiplier tout au long de la journée les
stimulations, tant intellectuelles ou émotion-
nelles que physiques, participe à un meilleur som-
meil.
z
Cette amélioration de la qualité de l’éveil
nécessite d’éviter les demi-endormissements
pendant la journée,
comme par exemple ceux
survenant devant la télévision. En effet, s’assoupir
devant le petit écran, surtout en soirée, risque de
faire descendre la pression de sommeil, celle-ci
restant le plus naturel des inducteurs de sommeil.
Cela suppose également de gérer soigneusement
les temps de repos ou de siestes. Si ces dernières
sont incontournables, on peut les favoriser en
début d’après-midi, sans les laisser durer trop
longtemps, ce qui revient à les placer dans des
créneaux bien défi nis. Enfi n, l’activité physique,
très favorable au sommeil lent profond ou “récu-
pérateur”, peut se décliner de différentes façons,
allant du “cours de gymnastique” à la stimulation
régulière lors de séances de kinésithérapie, en
passant par la marche, celle-ci étant adaptée au
degré de validité.
Renforcer l’horloge biologique
Afi n de mieux marquer le processus circadien,
deuxième mécanisme du sommeil, on cherche à
augmenter la bonne synchronisation des rythmes
en renforçant les synchroniseurs (ou donneurs
de temps) de l’horloge biologique (tableau 1).
z
Le plus puissant des synchroniseurs étant la
lumière, il est primordial de systématiser une
bonne exposition à la lumière du jour,
et ce dès
le matin, comme ouvrir rideaux ou volets, instal-
ler le fauteuil près de la fenêtre ou idéalement à
l’extérieur si les conditions le permettent, encou-
rager l’utilisation des écrans d’ordinateur. Les
lampes de luminothérapie délivrent plus de
3000lux et, sur avis médical, peuvent être utili-
sées le matin pendant 30minutes.
z
La régularité des horaires est également
pratique soignante
z Les équipes soignantes en institution accueillant des personnes âgées, tout comme les aidants
à domicile, sont confrontées à des patients dont le sommeil est parfois perturbé z Connaître les
troubles du sommeil et le fonctionnement du cycle veille-sommeil permet d’améliorer leur repos
z Une action sur l’environnement et sur les rituels les aide à retrouver des nuits paisibles.
Fostering an environment favourable to sleep-wake rythm. Health care teams in nursing
homes for the elderly, as well as home care workers are faced with patients whose sleep is sometimes
disturbed. Understanding sleep disorders and the sleep-wake cycle functioning may help improve
patients rest. An action on the environment and rituals can help in the return to peaceful nights.
VIOLAINE LONDE
MOTS CLÉS
• Éveil nocturne
• Insomnie
• Personne âgée
• Rythme circadien
• Sommeil
• Thérapie
comportementale
KEYWORDS
• Behavioural therapy
• Circadian rhythm
• Elderly person
• Insomnia
• Nocturnal awakening
• Sleep
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012
28
Le sommeil des personnes âgées
dossier
importante,
aussi bien celle de l’heure du lever
que celle des différents repas ou collations. Peu
importe le moment où ces repas sont placés dans
la journée, celui-ci dépendant essentiellement
des contraintes de chaque institution, mais il faut
que la régularité de leurs horaires soit respectée.
De même, la régularité des différentes activités
sociales est favorable à la bonne rythmicité veille-
sommeil. Enfi n, la pratique régulière d’une acti-
vité physique, quelle qu’elle soit, est également
bénéfi que pour le processus circadien.
ASPECT INDIVIDUEL
Identifi er les différents paramètres du
sommeil du patient
Dans un premier temps, l’équipe soignante
cherche à identifi er les caractéristiques du som-
meil du patient. En le questionnant, elle pourra
savoir s’il est court ou long dormeur. Un question-
naire comme celui de Horne et Ostberg [1] per-
met de repérer sa typologie circadienne: matinale
(la personne est plutôt du matin), vespérale (plu-
tôt du soir) ou neutre.
z
Parallèlement, l’équipe interroge le patient
sur ses habitudes antérieures, comme par
exemple ses activités habituelles avant d’aller
se coucher,
la nature de son rituel de coucher
(tisane, quelques pages de lecture, légère colla-
tion…), s’il se réveille fréquemment la nuit, ce
qu’il fait dans ces moments-là, ses stratégies éven-
tuelles pour se rendormir…
Ces informations sont très utiles pour gérer les
aléas de la nuit. Les soignants sont alors les plus à
même d’ajuster leurs attentes aux caractéristiques
du sommeil des patients. Ils peuvent également
reproduire, tant que faire se peut, les différentes
habitudes. Ils pourront par exemple proposer la
tisane qui déclenchait à coup sûr le sommeil…
Les patients, rassurés par cette plus grande simi-
litude, se sentent moins en décalage par rapport
à leur sommeil passé et conservent plus volontiers
un rythme veille-sommeil bien ordonné.
z
Améliorer le sommeil passe par une meilleure
connaissance de ce qui se passe quotidienne-
ment.
L’agenda du sommeil [2] va permettre
d’objectiver le temps total de sommeil, sa réparti-
tion tout au long des 24heures, sa qualité et les
moments de plus grande somnolence dans la
journée. Indispensable lorsque les diffi cultés de
sommeil surviennent, il aide également à repérer
d’éventuels liens entre certains événements exté-
rieurs et des modifi cations du sommeil: la séance
de motricité est, par exemple, plus en faveur
d’une bonne nuit, au contraire d’une sieste qui
se serait prolongée. Ce travail d’observation du
sommeil ne peut pas être mieux fait que par les
soignants, qui sont alors plus à même de connaître
le rythme du sommeil actuel du patient. Grâce à ce
recueil précis par le personnel de nuit, l’agenda met
en évidence l’adéquation plus ou moins optimale
entre le temps passé au lit et celui effectif de som-
meil. L’équipe soignante sait alors quand elle doit
suggérer au patient de retourner dormir après
quelques minutes de conversation, ou quand il
est plus judicieux au contraire de lui proposer de
se promener quelque temps dans le couloir.
Éviter le temps excessif passé au lit
La tendance à rester au lit pendant une durée très
largement supérieure aux besoins de sommeil est
renforcée chez les personnes âgées qui aiment
avancer leur coucher (avance de phase), mais qui
présentent aussi souvent des douleurs ou une
fatigabilité plus grande. Celles-ci les conduisent à
se coucher non pas parce qu’elles ont sommeil,
mais par envie d’être allongées. Elles pourront
alors substituer à cette mise au lit des temps de
TABLEAU 1. Optimiser l’hygiène du sommeil
Action Effet
Retarder l’heure du coucher Repousse l’heure du réveil
Encourager le patient à se lever quand il n’a pas sommeil Diminue le temps passé au lit et la fragmentation du sommeil
Augmenter l’exposition à la lumière le matin Stimule l’horloge biologique
Éviter les bains tardifs le soir L’augmentation de la température interne retarde l’endormissement
Limiter les boissons contenant de la caféine Réduit l’effet stimulant de la caféine qui est cumulatif
Encourager l’exercice physique Augmente la pression de sommeil et a un effet sur l’horloge biologique
Proposer des horaires réguliers Aide le processus circadien et la pression de sommeil à se renforcer de façon harmonieuse
Suivre les besoins et les rythmes du sommeil du patient Lutter contre le rythme du patient augmente les diffi cultés de sommeil
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012 29
Le sommeil des personnes âgées
dossier
repos dans un fauteuil avec les pieds surélevés ou
toute autre position délassante.
z
Reculer l’heure du coucher se heurte sou-
vent à une réticence importante tant de la part
du patient que de celle de son entourage.
Cela
nécessite de revenir sur des schémas de pensée
très tenaces, comme «les heures avant minuit comp-
tent double» ou «il ne faut pas rater le train du som-
meil» dont la pertinence est à replacer à la lumière
des informations sur le rythme circadien.
z
Parallèlement, il est souvent indispensable
de rechercher ensemble l’activité que le
patient peut substituer à cette mise au lit.
Il
n’est pas rare que le fait de trouver cette activité
(jeu de Triominos®, broderie, mots croisés, émis-
sion de radio…) permette soudain un réel recul
du coucher. Le patient attend alors pour se mettre
au lit le moment où il a sommeil, contrairement
à son habitude, ancrée depuis des mois ou des
années, consistant à se coucher «parce que c’est
l’heure».
Par ailleurs, la connaissance du syndrome des
jambes sans repos permet aux soignants de laisser
déambuler les patients qui ressentent parfois le
besoin de bouger les jambes de façon irrépres-
sible.
Aux patients présentant une insomnie, les soi-
gnants peuvent également proposer de reprendre
un rituel favorable à l’endormissement ou au
réendormissement. Cela peut dans bien des cas
représenter une bonne alternative aux hypno-
tiques, plus particulièrement en seconde partie
de nuit où le risque d’effet résiduel dans la jour-
née suivante est majoré.
L’éducation thérapeutique
En réajustant le temps passé allongé à la période
de sommeil nécessaire, le lit redevient étroite-
ment associé au sommeil, préalable à l’améliora-
tion de ce dernier. Ce contrôle du stimulus («Si je
suis au lit, alors je dors.» et son corollaire «Je ne dors
qu’au lit... et pas devant la télévision!») renforce la
confi ance en ses propres capacités à dormir, qui
a été mise à mal quand on a passé beaucoup de
temps à chercher un sommeil qui ne vient pas.
Pour renforcer ce sentiment de relative maîtrise
de son sommeil, il est également pertinent d’ex-
pliquer au patient les différents mécanismes phy-
siologiques qui sous-tendent le sommeil en
général (la pression de sommeil et l’importance
des rythmes synchronisés par l’horloge biolo-
gique) et les caractéristiques du sommeil quand
on prend de l’âge. Celles-ci vont justifi er certaines
pratiques comme l’exposition à la lumière, l’acti-
vité physique…
Il peut en découler une véritable alliance avec
l’équipe soignante, qui permet de déterminer
conjointement des objectifs, concernant la durée
totale du sommeil, sa répartition avec une sieste
ou non, le moment et la durée de celle-ci, la
TABLEAU 2. Agir pour retrouver le sommeil
À vérifi er Action
Heure de coucher Si le patient a déjà dormi 7 ou 8heures il est probable qu’il n’ait plus besoin de sommeil → Proposer une activité
Temps des siestes et du sommeil Si le patient a déjà dormi 8-9heures dans les 24heures, il est probable qu’il n’ait plus besoin de sommeil
→ Proposer une activité
Éveil avec temps de sommeil nocturne
<4-5heures
Encourager le patient à se lever si possible et trouver une activité pendant un moment jusqu’à ce qu’il montre des
signes de somnolence (bâillements…). Refaire le rituel du sommeil pour l’aider à se rendormir
Présence de douleurs ou d’inconfort Proposer une prise en charge des douleurs. Recoucher le patient une fois que le traitement a fait effet ou plus tôt si
la position allongée le soulage
Cauchemars Encourager le patient à parler de son rêve pour le rassurer, lui proposer de se recoucher une fois qu’il s’est détendu
et qu’il ressent à nouveau les signes du sommeil
Somnambulisme (le patient ne semble
pas éveillé)
Reconduire le patient vers son lit sans trop le stimuler et l’encourager à s’allonger et à se rendormir
Agitation Essayer de trouver la source de l’agitation: douleurs, fi èvre, troubles urinaires, peur, hallucinations. Accompagner
le patient pour le rassurer. Proposer qu’il se recouche une fois qu’il est rassuré et calmé, mais ne pas insister si le
patient résiste au coucher
Plainte d’inconfort dans les jambes Possibilité d’un syndrome des jambes sans repos. Aider le patient à remuer les jambes et à marcher pour pallier les
symptômes. Communiquer les symptômes à l’équipe médicale
Ronfl ement Noter la présence des arrêts respiratoires, d’un effet de la position (ex: le ronfl ement est aggravé si le patient dort
sur le dos) et d’une nycturie. Communiquer les symptômes à l’équipe médicale
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012
30
Le sommeil des personnes âgées
dossier
fenêtre du temps passé au lit, l’heure du lever, le
rituel préalable au coucher, les stratégies si la nuit
est perturbée, sans oublier les différentes activités
de la journée selon leur impact sur le sommeil de
la nuit. Ces objectifs peuvent être régulièrement
réévalués grâce aux observations de l’agenda du
sommeil, lors d’un échange entre le patient et
l’équipe soignante.
Gérer les éveils nocturnes
z
Bien gérer les éveils nocturnes n’est pas
facile.
Très souvent le patient reste dans son lit et
ce n’est que le matin que l’équipe de jour
recueille une plainte de mauvais sommeil, alors
que le fait de se lever est très effi cace pour se réen-
dormir: la possibilité de se lever ou l’invitation à
le faire sera bénéfi que pour le patient éveillé en
milieu de nuit.
Certains patients se lèvent et cherchent de l’aide,
d’autres sont agités, enfi n quelques-uns font de
vrais épisodes de somnambulisme et sont en effet
toujours endormis.
z
Ainsi, la prise en charge des éveils nocturnes
demande une bonne connaissance de la phy-
siologie du sommeil,
des besoins de chaque
patient et de la cause de son éveil. Pour un patient
couché et endormi tôt, qui a donc déjà fait sa nuit,
le retour au lit ne va pas déclencher un sommeil
satisfaisant. À d’autres patients qui se réveillent
en plein milieu de leur nuit de sommeil, il est, au
contraire, judicieux de proposer de se recoucher.
On facilite alors l’endormissement par un temps
de détente, suivi par des éléments du rituel de
coucher qui sécurisent le patient et permettent
un réendormissement rapide (tableau 2). Un
agenda du sommeil est précieux pour bien suivre
le temps de sommeil de chaque patient et ajuster
les conseils aux besoins de chacun.
CONCLUSION
Bien dormir est primordial pour la santé et l’équi-
libre de la personne âgée. Le rôle de l’équipe
soignante est essentiel pour l’aider à préserver un
sommeil de qualité. Les connaissances en matière
de rythmes circadiens et des éléments favorisant
l’endormissement et le repos récupérateur font
partie intégrante de la prise en charge de la
personne âgée.
n
Déclaration d’intérêts:
l’auteur déclare ne pas
avoir de confl it d’intérêts
en relation avec cet article.
L’AUTEUR
Violaine Londe,
psychologue
coordonnateur Réseau
Morphée,
92380 Garches,
France.
lv.londe@neuf.fr
RÉFÉRENCES
[1] Questionnaire de typologie
circadienne de Horne et Otsberg
http://www.reseau-morphee.
fr/le-sommeil-et-ses-troubles-
informations/quel-dormeur/
soir-matin/questionnaire-de-
typologie-circadienne-de-horne-
et-ostberg
[2] www.reseau-morphee.fr/
wp-content/plugins/downloads-
manager/upload/agenda_2p.pdf
© ABK/BSIP.
L’équipe soignante cherche à identifi er les caractéristiques du sommeil du patient.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
1
/
4
100%