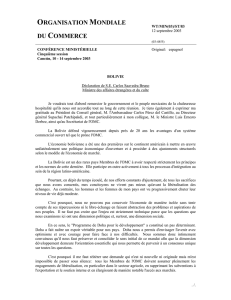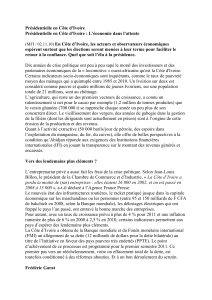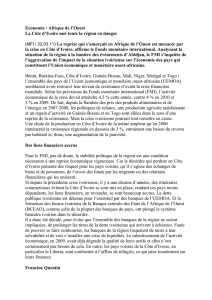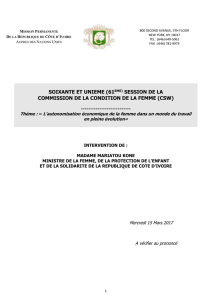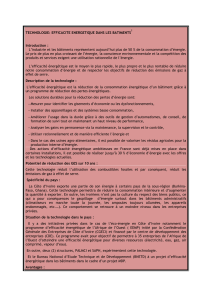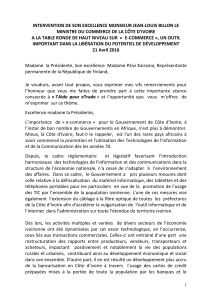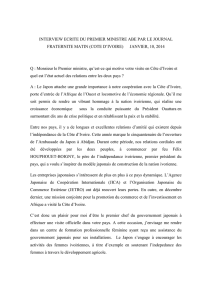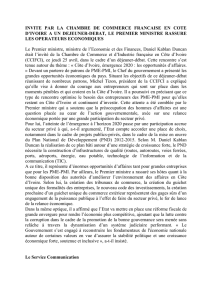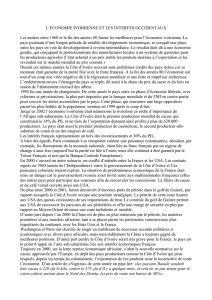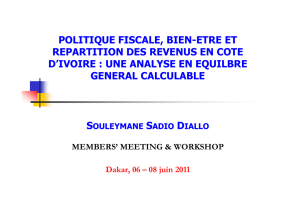ouverture commerciale et distribution des revenus en cote

OUVERTURE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION DES
REVENUS EN COTE D’IVOIRE : SIMULATION A L’AIDE
D’UN MODELE D’EQUILIBRE GENERAL CALCULABLE
DYNAMIQUE
Souleymane S. DIALLO1
Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales CIRES, Côte d’Ivoire
Seydou KONE et Monan KAMAGATE
UFR des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Cocody
RAPPORT INTERIMAIRE
(Réseau PEP, Canada)
Mai 2004
RESUME : L’objectif de ce papier des d’évaluer les effets potentiels d’une ouverture commerciale
résultants des accords de l’OMC sur la répartition des revenus et le bien être en Côte d’Ivoire. Après
avoir présenté le rôle de l’agriculture et l’ouverture commerciale dans les stratégies de développement
en Côte d’Ivoire ainsi que les enjeux et les implications du cycle de DOHA pour l’économie
ivoirienne, il présente la revue de la littérature et la méthodologie de l’étude. Puis, il présente les
scénarios de politique commerciale prévue et une description de la structure de l’économie à partir de
la MCS.
Mots Clés
: Libéralisation – Cycle de DOHA – Modèle EGC – Distribution – Côte d’Ivoire.
JEL Classification
: C68; F13; O15 ; I0
1 08 BP 1295 Abidjan, Côte d’Ivoire ; Tél : 225-22 44 43 63, Fax : 225-22 44 08 29, E-mail : ssadio_tr@yahoo.fr /

2
OUVERTURE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION DES REVENUS EN COTE
D’IVOIRE : SIMULATION A L’AIDE D’UN MODELE D’EQUILIBRE GENERAL
CALCULABLE DYNAMIQUE
1. Introduction
Durant ces deux dernières décennies, les questions relatives à la libéralisation économique avec pour
corollaires le désengagement de l’Etat du secteur productif et le démantèlement des barrières
commerciales ont dominé le débat sur le développement. Se basant sur l’idée selon laquelle une plus
grande ouverture au commerce international et le recentrage de l’Etat sur son rôle régalien était
nécessaire pour garantir l’efficacité économique et, partant, le développement économique et social,
les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ont encouragé les pays en développement en général
et africains en particulier à plus de libéralisme. Ce qui devrait se traduire dans les faits par une baisse
significative voire la suppression des restrictions aux échanges internationaux, la privatisation des
entreprises publiques et le démantèlement des structures d’encadrement des producteurs agricoles et
de commercialisation des produits d’exportation.
Pour les Etats africains qui tirent l’essentiel de leurs ressources des taxes sur le commerce extérieur et
de la taxation du secteur agricole, de telles mesures ont d’importantes implications aussi bien en
termes de recettes fiscales que de distribution des revenus et de bien – être économique pour les
ménages. Ceci est d’autant plus important que les accords sur la libéralisation des échanges initiés
dans le cadre de l’OMC viennent renforcer la tendance au désarmement douanier et à la libéralisation
intérieure entamée dans le cadre des politiques d’ajustement structurel. Les questions sur les
politiques agricoles qui étaient restées en marge des négociations multilatérales sur la libéralisation du
commerce international jusqu’en 1986, sont aujourd’hui au cœur des négociations commerciales et
cristallisent les oppositions entre pays développés et pays en développement.
En principe, le volet agricole de l’accord de l’OMC sur la libéralisation des échanges vise
principalement l’introduction d’une certaine discipline dans les échanges de produits agricoles et les
politiques de soutien. Plus concrètement, il a comme objectifs l’élimination des politiques de
protection tarifaires, de subventions à l’exportation et de soutiens à la production qui sont
considérées comme les instruments de politiques agricoles les plus distrosives du commerce
international de produits agricoles.

3
Au-delà du problème de partage des gains liés au commerce international, les préoccupations que
suscite la question de la libéralisation des échanges commerciaux, notamment ceux liés aux produits
agricoles tiennent au rôle de l’agriculture dans les économies en développement d’une part, et
l’implication des politiques commerciales sur la répartition des revenus et le bien être d’autre part.
Plusieurs études ont été menées pour évaluer l’impact des reformes commerciales sur la performance
économique et la répartition des revenus et la pauvreté dans les pays en développement ces dernières
années. Il ressort de ces travaux que, si du point de vue de la théorie économique, la libéralisation
commerciale favorise le développement économique et la réduction des inégalités de revenus, la
façon dont ces mesures affectent le bien être et la distribution des revenus est fortement liée aux
conditions spécifiques des pays qui les mettent en œuvre. En outre, même si la libéralisation
commerciale se traduit globalement par un gain de bien être, il est tout à fait possible que les
ménages les plus pauvres enregistrent une perte. Il est de ce fait important de comprendre comment
les modifications des politiques commerciales vont affecter la performance économique, la
distribution des revenus et le bien être.
L'objectif de ce travail est de tenter de quantifier, à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable
les effets potentiels des diverses mesures de libéralisation commerciale découlant du cycle de DOHA
sur la répartition des revenus en Côte d’Ivoire. Le reste du document est structuré de la manière
suivante. La section 2 présente la place du secteur agricole et le rôle de l’ouverture extérieure dans la
stratégie de développement de la Côte d’Ivoire. La section 3 donne un aperçu des enjeux du cycle de
DOHA et les implications potentielles pour l’économie ivoirienne. Les sections 4 et 5 sont
consacrées respectivement à la revue de la littérature et à la présentation de la méthodologie. Après
avoir indiqué les hypothèse de simulation (section 6), nous procédons, à la section 7 à une
description de la structure de l’économie.
2. Stratégies de développement de la Côte d’Ivoire : développement agricole et ouverture sur
l’extérieur
L’évolution de l’économie ivoirienne est marquée par trois grandes phases. La première qui s’étend
de 1960 jusqu’en 1979, est une phase de forte croissance qui a vu le PIB par tête croître au taux
moyen annuel de 5,7%. La deuxième phase qui s’étend de 1980 à 1993 est la phase de dépression
avec un taux de croissance annuel moyen négatif. Et la troisième phase est celle de la relance qui a

4
suivi la dévaluation du franc CFA en 1994. Elle se caractérise par une reprise de la croissance qui a
atteint plus de 6% en 1996 avant de replonger suite à la crise politique qui secoue le pays depuis
1999. L’agriculture qui est considérée comme l’épine dorsale de l’économie ivoirienne a joué un rôle
central dans cette évolution. Ainsi, sur la période 1960 – 1990, elle a contribué au PIB dans une
proportion moyenne annuelle de 35% et continue, à ce jour, à employer plus de 65% de la
population active (Kouassy, Diop-Boaré et Koné, 2003).
Outre le rôle clé donné à l’agriculture, la stratégie de développement de la Côte d’Ivoire se caractérise
essentiellement par l’ouverture sur l’extérieur et la forte présence de l’Etat dans l’économie. En effet,
le modèle de base adopté par la Côte d’Ivoire est fondé sur l’ouverture sur l’extérieur qui joue un rôle
central aussi bien pour l’achat des exportations agricoles que pour l’apport de capitaux et de main
d’œuvre. Le graphique 1 présente l’évolution du taux d’extraversion et le taux de croissance de la part
commerciale dans le PIB de la Côte d’Ivoire entre 1970 et 2000.
Graphique 1 : Evolution de l’ouverture commerciale entre 1970 et 2000.
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
70 75 80 85 90 95 00
OPENNESS
Ouverture commerciale
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
70 75 80 85 90 95 00
TCINSERT
Evolution de la part commerciale
Il montre que la période allant de 1970 à 1980 et celle qui a suivi la dévaluation du franc CFA en
1993, qui sont des périodes de forte croissance économique, sont également marquées par une
grande ouverture vers l’extérieure. Par contre, durant la période de crise qui va de 1980 à 1993, on a
assisté à un retournement de tendance avec une baisse significative du taux d’ouverture commerciale
en Côte d’Ivoire. Cependant, malgré les perturbations que connaît le pays depuis 1999, l’économie
ivoirienne reste marquée par une forte pénétration des importations qui varient de 34% du PIB en
2000 à 35% en 2001 alors que la somme des exportations et des importations représentait 64% et
80% du PIB en 1969 et 2001 respectivement. Le graphique 2 représente l’évolution des importations
et des exportations d’une part, et celle de la balance commerciale d’autre part.

5
Graphique 2 : Evolution des échanges extérieurs et de la balance commerciale de la Côte d’Ivoire
entre 1970 et 2000.
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
70 75 80 85 90 95 00
TCEX TCIM
Evolution des Exportations et des Importations
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
70 75 80 85 90 95 00
CURACC
Evolution de la balance commerciale
Les exportations et les importations sont essentiellement orientées vers l’Europe qui constitue le
principal client et le principal fournisseur. Bien que la part des exportations ivoiriennes en direction
de l’Europe a connu une baisse sur la décennie 1990, passant de 66,5% en 1995 à 50,6% en 1999, ce
continent absorbe plus de la moitié de ces exportations. Dans le même temps, les importations
ivoiriennes en provenance de l’Europe ont évolué de 59,31% en 1995 à un peu plus de 54% en 1999.
La Côte d’Ivoire importe essentiellement de produits pétroliers, de médicaments, des biens
d’équipement et de produits alimentaires. Sur la période 1990 – 1999, les produits pétroliers
représentaient annuellement environ 19% des importations annuelles totales contre 4% pour les
médicaments et 5% pour les produits alimentaires composés de riz et de poissons congelés pour
l’essentiel. L’évolution des principales importations ivoiriennes entre 1992 et 1999 est présentée au
tableau1.
Tableau 1 : Evolution des principaux produits d’importation*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Huiles brutes de pétrole 115,8 113,3 184 185,5 242,5 254,1 195 240,36
Médicaments 32,5 31 42,329 58,21 56,63 60,63 63,35 63,69
Pétrole partiellement raffiné 18,04 16,00 33,07 44,57 88,28 37,02 64,78 85,59
Riz blanc 21,86 27,90 42,01 52,61 44,66 64,59 81,94 66,19
Poisson congelé 26,06 29,86 55,31 68,65 72,15 87,55 110,84 103,92
Source : INS, * les montants sont milliards de FCFA
Au niveau des exportations, elles sont composées pour l’essentiel de produits agricoles. Malgré le
choix d’un système économique libéral opéré dès les premières années de l’indépendance politique en
1960, l’Etat a joué un rôle central dans l’économie ivoirienne grâce notamment à la gestion du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%