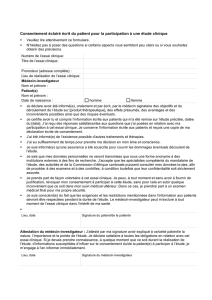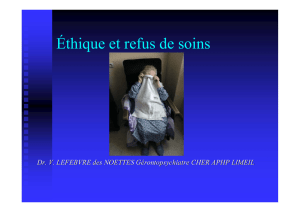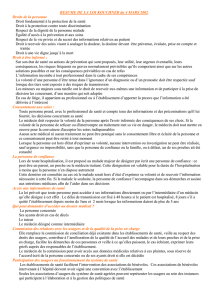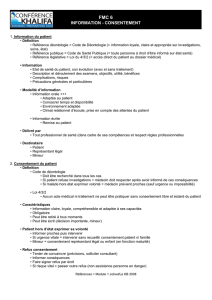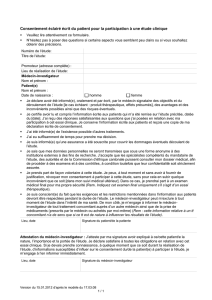essais cliniques en situation d`urgence, ne régressons pas

29
la revue du trombinoscope l Avril 2013
tribunes
La Commission européenne a publié
en juillet 2012 son nouveau projet de
règlement relatif aux essais cliniques
de médicaments à usage humain. Je
soutiens ce projet de règlement, qui se fonde
sur les principes d’harmonisation et de sim-
plification des procédures et qui garantit, dans
le même temps, un haut niveau de protection
des patients et de fiabilité des données.
Il est urgent de réviser la directive
2001/20/CE. En effet, la recherche clinique
européenne se meurt. Elle doit faire face à de
nombreux dysfonctionnements : diminution
de plus de 25% du nombre de demandes
d’essais cliniques entre 2007 et 2011, dimi-
nution du nombre de patients inclus dans
les essais cliniques, tendance croissante à
la délocalisation de la recherche clinique
européenne vers des pays tiers, augmentation
de la charge administrative et des coûts liés à
l’évaluation et à la conduite des essais clini-
ques multicentriques.
L’une des principales avancées de ce projet
de règlement est la rédaction d’un article
spécifique sur les essais cliniques en situation
d’urgence (article 32 du projet de règlement).
Dans la législation française, ces cas sont
couverts depuis 1988 et repris par la loi Jardé
de 2012, loi qui va même plus loin puisqu’elle
couvre les cas d’urgence « vitale immédiate »
et permet une dérogation supplémentaire. En
droit français, l’article L-1122-1-1 du Code
de la santé publique (CSP) dispose qu’il est
obligatoire de recueillir le consentement
préalable libre, éclairé et écrit du patient avant
la conduite de toute recherche biomédicale.
Cependant, l’article L-1122-1-2 prévoit des
dispositions dérogatoires au principe du
consentement préalable pour les essais cli-
niques en situation d’urgence. Il autorise les
médecins à inclure un patient dans un proto-
cole de recherche en situation d’urgence sans
son consentement préalable. En contrepartie,
le législateur a assorti cette dérogation de
plusieurs conditions protectrices.
Les dispositions dérogatoires prévues par
le CSP sont indispensables pour le maintien
de la recherche biomédicale en situation
d’urgence qui ne peut se plier aux règles du
consentement préalable. Il est en pratique
Essais cliniques en situation
d’urgence, ne régressons pas
par Philippe Juvin
Il y a une inadéquation entre la
fenêtre d’inclusion des patients
dans un protocole de recherche
en situation d’urgence souvent
très courte [...] et la procédure
d’information et de recueil du
consentement, nécessairement
plus longue
Philippe JUVIN
quasi impossible de respecter les dispositions
de l’article L-1122-1-1 du CSP, et ce pour
deux raisons principales. Tout d’abord, l’état
des patients qui se trouvent pour la plupart
hors d’état de consentir. En outre, il y a une
inadéquation entre la fenêtre d’inclusion
des patients dans un protocole de recherche
en situation d’urgence souvent très courte
(de quelques minutes à quelques heures
seulement) et la procédure d’information et
de recueil du consentement, nécessairement
plus longue.
À la lecture de l’exposé des motifs, l’ap-
proche du règlement européen semble très
positive pour le maintien de la recherche
clinique européenne en situation d’urgence.
Néanmoins, après une lecture plus approfon-
die, plusieurs dispositions de l’article 32 du
projet de règlement me semblent être problé-
matiques et en complète contradiction avec
les situations d’urgence auxquelles doivent
faire face les investigateurs en réanimation.
En pratique, le maintien de ces dispositions
dans le texte final représenterait un recul
inacceptable pour la France. Je citerai les deux
plus problématiques.
L’article 32.1 b) dispose qu’un essai clinique
en situation d’urgence peut être conduit sans
le consentement préalable du participant si
« aucun représentant légal n’est disponible ».
Or, cette disposition est trop restrictive car elle
ne prend pas en compte les cas d’urgences
vitales immédiates, cas dans lesquels même
lorsque la famille est présente, l’urgence est
telle qu’il est techniquement impossible pour
l’investigateur de solliciter le consentement
de la famille.
L’article 32.1 e) dispose qu’un essai clinique
en situation d’urgence peut être conduit s’il
« comporte un risque minimal, et impose une
contrainte minimale pour le participant ».
Cette disposition est irréaliste. Limiter les
cas de recherches en situation d’urgence à
celles ne comportant qu’un risque minime ne
prend pas en compte les situations concrètes
auxquelles doivent faire face les médecins
en réanimation. Cette disposition exclurait
de façon automatique toutes les recherches
sur des produits innovants. Les médicaments
utilisés dans le cadre de l’urgence sont forcé-
ment associés à des risques plus que minimes,
puisqu’il s’agit de maintenir les fonctions
vitales dans un contexte de défaillance
majeure. Pour ces cas d’urgence, il est indis-
pensable de prendre en compte la balance
risques/bénéfices.
L’enjeu sur les essais cliniques en situation
d’urgence étant de taille, je ferai tout mon
possible, au cours des négociations, pour que
ce projet de règlement s’aligne sur la loi Jardé
de 2012.
1
/
1
100%