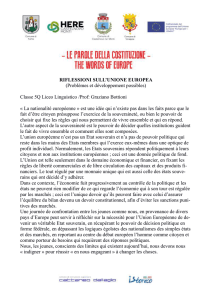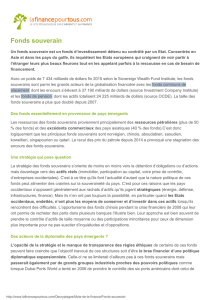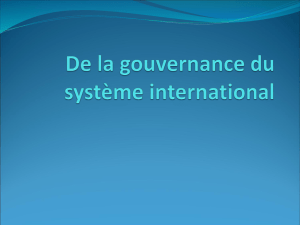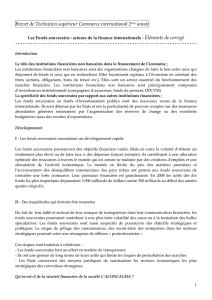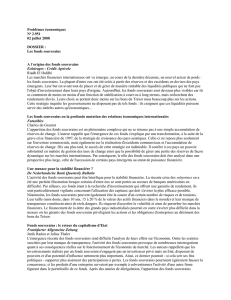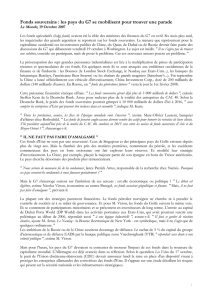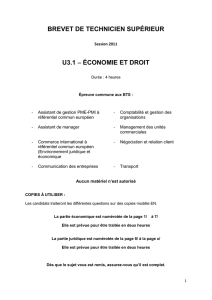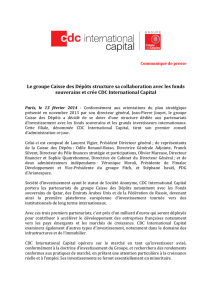Les fonds souverains changent-ils la face de l`économie mondiale ?

Diploweb.com, revue geopolitique, articles, cartes, relations internationales > Monde > Transversaux >
Les fonds souverains changent-ils la face de l’économie mondiale (...)
Les fonds souverains changent-ils la face de
l’économie mondiale ?
mardi 29 novembre 2016, par Juliette FAURE
Comment les fonds souverains sont-ils devenus des acteurs incontournables des nouvelles
dynamiques financières et géopolitiques mondiales ? Leurs ressources immenses et la
nouveauté de leur stratégie d’investissement long terme en font depuis quelques années des
pionniers du financement de l’économie mondiale. La prise de participation de fonds souverains
dans des actifs à l’étranger noue des liens stratégiques entre les pays.
AU COURS Au cours de ces dernières années, la finance mondiale s’est transformée sous l’influence
croissante des fonds souverains. Il existait seulement une vingtaine de fonds souverains en 2000 tandis
qu’ils sont aujourd’hui plus de 75 et ne cessent d’augmenter [1] : Israël, Hong Kong, la Turquie, la Grande
Bretagne et l’Indonésie ont récemment annoncé la création d’un fonds souverain. Au service d’un État, le
fonds souverain investit sur les marchés financiers pour garantir la diversification et la durabilité des
revenus publics. Ce statut hybride, acteur financier sous mandat public, est inédit et révolutionnaire
tant pour le fonctionnement et la régulation de la finance que pour les possibilités de développement des
pays. Selon le « Sovereign Wealth Fund Institute », la taille des fonds souverains a pratiquement doublé
depuis 2010 pour représenter près de 7,4 trillions de dollars en décembre 2015. [2] Une partie
considérable de la manne monétaire de la finance d’aujourd’hui est donc publique et de ce fait, répond à
des régulations et des exigences spécifiques. Cette irruption des États sur les marchés financiers a un
double effet. D’un côté, la finance doit s’adapter à un investisseur qui obéit à une logique d’État et à des
critères de transparence et de responsabilité. De l’autre côté, l’État se dote d’une nouvelle source de
financement qui lui permet de mener les missions cruciales de stabilisation du budget, d’élaboration de
politiques publiques et d’épargne intergénérationnelle. La rencontre de ces deux mondes est bienvenue.
Elle permet aux États d’avoir une influence sur les régulations et les pratiques financières ; et elle octroie
à la finance une nouvelle noblesse d’âme en servant les intérêts des citoyens. Les fonds souverains
remédient ainsi aux évolutions incontrôlées du capitalisme mondial qui ont abouti à une disjonction entre
la création de profits non régulée et les besoins croissants de financement public. Dans le même temps,
l’interaction des fonds souverains constitués en communauté d’investisseurs entretient un nouveau réseau
en finance, connoté d’une force stratégique inédite. Nouveaux acteurs hybrides des relations
internationales, quel est l’impact des fonds souverains sur les dynamiques financières et géopolitiques
mondiales ?
La présence d’une logique d’État permet d’infléchir la finalité des investissements vers des impacts
positifs pour le développement des pays (I). Les fonds souverains s’imposent comme les gendarmes de
marchés et les principaux financeurs de l’économie mondiale (II). A l’occasion de partenariats entre fonds
souverains, une dimension diplomatique nécessairement affleure, avec son potentiel de coopération et de
déstabilisation (III).

Juliette Faure
I. Aux mains d’un fonds souverain, les stratégies financières sont réindexées sur
une finalité d’intérêt public
Le fonds souverain peut servir plusieurs fonctions. Son rôle par excellence est de pallier le fameux
syndrome hollandais, autrement appelé « malédiction des ressources naturelles » par les économistes du
développement. Les fonds souverains sont généralement établis par des pays exportateurs de ressources
naturelles ou de biens de consommation. Lorsque leur balance commerciale devient largement
excédentaire, ces pays accumulent des revenus et s’exposent ainsi à plusieurs risques. Premièrement,
l’accumulation de devises crée un risque d’excès de liquidités et de volatilité de la valeur de la monnaie
locale. Deuxièmement, le pays entretient une dépendance envers ses revenus issus de l’exportation sans
être certain que ces revenus soient stables et durables. L’épuisement des ressources du pays, les
fluctuations du prix sur les marchés, la concurrence de nouveaux acteurs ou encore la diminution de la
demande sont autant de risques qui pèsent sur la longévité des revenus. Troisièmement, une économie qui
dépend d’une seule source de revenus n’est pas robuste : les profits issus de l’exportation peuvent
financer les besoins immédiats du pays sans inciter à investir dans un système de production nationale.
Pour toutes ces raisons, les pays en développement riches en matières premières ont sombré dans une
impasse économique menant paradoxalement à plus de pauvreté et d’instabilité que des pays similaires
sans ressources. Dans cette situation, le fonds souverain est un mécanisme de protection très efficace
contre la dépendance d’un pays envers ses « rentes ». En diversifiant la source des revenus, il crée un
mécanisme d’investissement et d’épargne intergénérationnel qui assure la stabilité et la durabilité des
richesses publiques. On peut citer le cas du fonds souverain malaisien, « Khazanah Nasional », qui a
réussi à utiliser les revenus pétroliers du pays pour soutenir l’industrie nationale, diversifier ses secteurs
de production ou financer des projets domestiques à impact économique et social. Suivant la même
logique, le fonds souverain coréen, « Korea Investment Corporation », utilise les revenus issus de ses
exportations commerciales pour financer l’économie du pays à long terme. En février 2016, le président
du groupe a annoncé la croissance des réserves du fonds de 85 milliards de dollars à 200 milliards d’ici
2020. [3] A terme, on peut imaginer qu’il serve à financer le coût de réunification des deux Corée.

II.Les fonds souverains : gendarmes des marchés et financeurs de l’économie
mondiale
La présence de ces investisseurs publics sur les marchés financiers impose de nouvelles régulations en
finance. La lutte contre la corruption est une des raisons fondamentales qui expliquent la prolifération des
fonds souverains. Au Nigeria par exemple, le fonds souverain a été mis en place pour s’assurer que les
revenus pétroliers soient gérés de façon transparente. Des critères légaux très clairs définissent le modèle
d’investissement du fonds et les conditions sous lesquelles les revenus sont placés ou retirés, sécurisant
ainsi le capital public du pays. Par ailleurs, les fonds souverains deviennent acteurs d’une régulation de la
qualité des investissements. Le fonds souverain norvégien, « Norges Bank Investment Management »
(NBIM), fait par exemple preuve d’un activisme d’actionnaire qui n’a pas de précédent dans l’histoire de
la finance. Le fonds s’est engagé à se retirer de tout investissement lié à la production de combustibles
fossiles. Dans les entreprises dans lesquelles il est investi, il requiert la réduction des émissions de gaz à
effet de sphère. La taille et l’importance stratégique de NBIM font de ses engagements éthiques un
véritable moyen de pression sur les pratiques financières. NBIM n’hésite pas à mettre en œuvre ses
sanctions : récemment, le fonds a mis un terme à sa participation dans l’entreprise américaine « Duke
Energy Corp. » après la révélation de son bilan de pollution. [4] Non sans une certaine ironie de l’histoire,
c’est un fonds issu de revenus pétroliers qui est aujourd’hui le champion du financement de la transition
énergétique et de la sensibilisation au changement climatique.
L’activisme d’actionnaire des fonds souverains permet également de lutter contre le problème de
l’asymétrie d’information sur les marchés financiers. Le manque de transparence des informations
délivrées par les entreprises, voire la rétention ou la manipulation d’informations (déclaration de faux
profits, dissimulation de pertes…), est une source de risque immense pour les investisseurs et une des
causes de la création de bulles financières. Pour réduire les aléas sur la valeur de leurs actifs, les fonds
souverains demandent une transparence des normes comptables et la publication d’informations
financières fiables de la part des entreprises dans lesquels ils sont investis. Cela renforce la mise en
application des normes internationales de régulation des marchés, comme les « International Financial
Reporting Standards utilisés en Europe » ou les « Generally Agreed Accounting Principles » américains.
Au-delà de ce nouveau rôle de gendarme de la finance, les fonds souverains détiennent aussi une
puissance transformative sur la finance en proposant un nouveau modèle d’investissement. L’essence de
leur stratégie repose sur l’investissement sur un horizon long terme pour garantir que les revenus
d’aujourd’hui bénéficient aux générations futures. Alors qu’un fonds de pension traditionnel a besoin de
produits qui génèrent des retours annuels pour déverser les retraites à ses contribuables chaque année,
les fonds souverains n’ont théoriquement pas d’engagement sur l’année mais plutôt sur 5, 10 voire 20 ans.
Ils ont ainsi une approche contra-cyclique par rapport à la volatilité court terme des marchés. Lors de la
panique qui a saisi les marchés début janvier 2016, les bourses ont chuté dans un mouvement général de
rétraction des investissements et vente des actions. A contre courant de cette tendance, un groupe de
fonds souverains [5] réunis au Forum Économique de Davos le 21 janvier 2016 affirmait leur engagement
contre la volatilité des marchés, en annonçant la création du nouvel indice d’investissement long-terme, le
« S&P Long-Term Value Creation Index ». Cet engagement est très prometteur. Jusqu’à présent, les
investissements long terme étaient désertés par les investisseurs traditionnels. Ils requièrent en effet un
engagement stable et pérenne et sont souvent associés à de forts coûts fixes initiaux, une faible
profitabilité immédiate et des risques qui pèsent sur leur viabilité. Dans le cas de produits illiquides
comme les infrastructures, l’investisseur est impliqué durant l’ensemble de la période d’investissement et
peut difficilement se rétracter en cours. Pour ces raisons, les investisseurs court terme ne préfèrent pas
s’y risquer. Pourtant, ce sont ces investissements qui sont la clé du financement d’une économie globale :
réseaux électriques, voies de communication, assainissement en eau ou encore financement de la
transition énergétique sont autant d’investissements cruciaux délaissés par les règles classiques de la
finance. Les fonds souverains ont une position privilégiée pour combler ce gouffre. On peut citer
l’approche de la « Caisse de dépôt et placement du Québec » (CDPQ) qui travaille directement avec le
gouvernement canadien pour concevoir et financer des projets d’infrastructures publiques et de
transports à impacts sociaux et environnementaux. De la même manière, CDPQ est membre de la

plateforme d’investissement « Resurgent Power Ventures » en coparticipation avec deux autres fonds
souverains du Koweït et d’Oman et des investisseurs privés pour financer le développement du réseau
électrique indien. La taille de la plateforme s’élève déjà à 850 millions de dollars.
III. La collaboration entre fonds souverains donne lieu à des alliances stratégiques
et diplomatiques
La collaboration de plusieurs fonds souverains au sein d’un même investissement est d’ailleurs de plus en
plus courante. Ils partagent ainsi leurs ressources et leur expertise entre pairs et montent des plateformes
de co-investissement sans avoir besoin de recourir à un gestionnaire d’actifs. Typiquement, le fonds russe
« Russian Direct Investment Fund » ne fonctionne que sur ce modèle de collaboration. Il a déjà scellé des
partenariats dans de nombreux pays dont la France, l’Italie, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis,
la Chine, l’Inde…
Un des objectifs déclarés de ces alliances est d’approfondir la coopération économique bilatérale. Ces
nouvelles alliances représentent ainsi des engagements stratégiques entre pays et redessinent une
diplomatie économique peu médiatisée. Ainsi, le fonds souverain chinois a déployé une présence
internationale impressionnante. Armée de son imposant fonds de près de 814 Md$, « China Investment
Corporation » (CIC), la puissance financière de la Chine prend de vraies allures géopolitiques. En 2014, la
Chine a établi un véhicule entièrement dédié à la construction d’infrastructures et de voies de
communication à travers l’Asie centrale. Ce nouveau fonds, au nom programmatique de « Silk Road Fund
», est doté de 40 Md$. A titre de comparaison, cela représente déjà près d’un tiers du budget de l’Union
européenne. En France, sous l’égide de la Caisse des Dépôts, le fonds souverain « Caisse des Dépôts
Capital International » a conclu avec la CIC un partenariat d’investissement pour le financement du Grand
Paris à hauteur d’1 Md€.
Certes, les fonds souverains se sont engagés à respecter les Principes de Santiago, qui stipulent que leur
stratégie d’investissement ne doit servir que des objectifs commerciaux et non stratégiques. On peut
néanmoins s’interroger sur les capacités d’influence voire d’ingérence que confère la prise de
participation financière d’un acteur souverain dans l’économie d’un autre pays. Récemment, le fonds de
pension souverain australien, « Queensland Investment Corporation » (QIC), a proposé un nouveau degré
de partenariat entre fonds. QIC a acquis une telle expertise en matière d’investissements qu’il propose
aujourd’hui ses services de gestionnaires d’actifs à d’autres fonds d’États australiens. [6] Les retours sur
ces activités bénéficient au budget de l’État : chaque année, QIC paye un dividende au Trésor. Mais
l’impact stratégique de cette activité n’est pas anodin : dans le cas hypothétique où QIC serait en rivalité
avec un État dont il gère le fonds souverain, son ingérence pourrait devenir une ascendance
problématique.
Les fonds souverains sont ainsi devenus des acteurs incontournables des nouvelles dynamiques
financières et géopolitiques mondiales.
Copyright Novembre 2016-Faure/Diploweb.
Plus
. La revue Carto, n°38, Novembre-décembre 2016, publie un remarquable dossier sur "La planète
financière", richement illustré de cartes.
. Laurent Carroué, La planète financière. Capital, pouvoirs, espace, éditions Armand Colin, 2015. Un
ouvrage de référence.

. Jean-François Gayraud, Le nouveau capitalisme criminel. Crises financières, narcobanques, trading de
haute fréquence, éditions Odile Jacob, 2014.
P.-S.
Juliette Faure a travaillé pour un think tank de fonds souverains à New York. Elle a obtenu un Master en
Relations Internationales à Columbia University à New York après avoir étudié à Sciences Po Paris et à la
Sorbonne Paris IV en philosophie.
Notes
[1]
https://www.preqin.com/docs/reports/2015-Preqin-Sovereign-Wealth-Fund-Review-Exclusive-Extract-Ju
ne-2015.pdf
[2] http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
[3] http://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2016&no=129772
[4]
http://www.wsj.com/articles/norway-sovereign-wealth-fund-to-no-longer-invest-in-duke-energy-1473271
601
[5] Canada Pension Investment Board (CPPIB), Government Investment Corporation of Singapore
(GIC), New Zealand Superannuation Fund, Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), ATP Denmark and
PGGM Netherlands.
[6] « From investor to manager – how QIC is crossing the fence », entretien avec Jim Christensen,
Managing Director, Global Multi-Asset à QIC, sur « Institutional Investor Network », 20 juin 2016.
https://www.investorintelligencenetwork.com/research/case-studies/investor-manager-%E2%80%93-ho
w-qic-crossing-fence#
1
/
5
100%